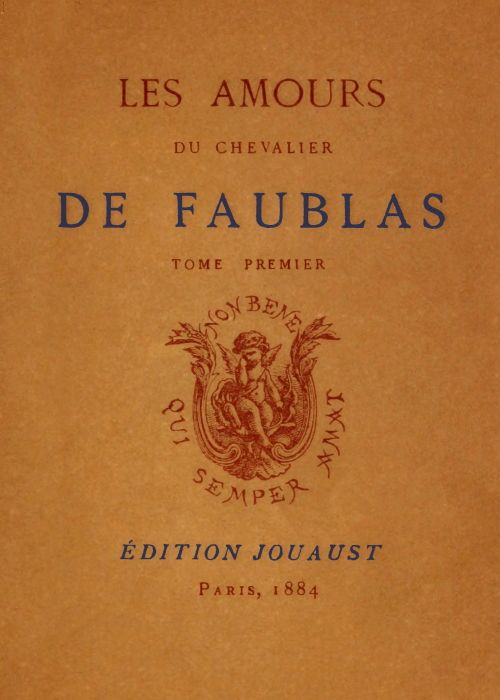
The Project Gutenberg EBook of Les amours du chevalier de Faublas, tome 1/5, by Jean-Baptiste Louvet de Couvray This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Les amours du chevalier de Faublas, tome 1/5 Author: Jean-Baptiste Louvet de Couvray Contributor: Hippolyte Fournier Illustrator: Paul Avril Release Date: April 25, 2020 [EBook #61920] Language: French Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AMOURS DU CHEVALIER DE FAUBLAS, TOME 1 *** Produced by Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries)
LES AMOURS
DU CHEVALIER
DE FAUBLAS
![[Vignette: NON BENE QUI SEMPER AMAT]](images/nonbene.png)
TOME PREMIER
PARIS, M DCCC LXXXIV
TIRAGE A PETIT NOMBRE
Plus 25 exemplaires sur papier de Chine et 25 sur papier Whatman, avec double épreuve des gravures.
Il a été fait un tirage en Grand Papier, ainsi composé:
| 10 | exemplaires | sur papier du Japon (nos 1 à 10). |
| 20 | — | sur papier de Chine (nos 11 à 30). |
| 20 | — | sur papier Whatman (nos 31 à 50). |
| 170 | — | sur papier de Hollande (nos 51 à 220). |
| —— | ||
| 220 | exemplaires, numérotés. | |
Pour ce dernier tirage, les gravures se trouvent en triple épreuve dans les exemplaires sur papier du Japon, et en double épreuve dans les exemplaires sur papier de Chine et sur papier Whatman.

PAR
LOUVET DE COUVRAY
AVEC UNE
PRÉFACE PAR HIPPOLYTE FOURNIER
Dessins de Paul Avril
GRAVÉS A L'EAU-FORTE PAR MONZIÈS
![[Marque d'imprimeur: IOVAVST]](images/jouaust.png)
PARIS
LIBRAIRIE DES BIBLIOPHILES
Rue Saint-Honoré, 338
M DCCC LXXXIV
S'il y a des personnes qui valent mieux que leur réputation, il existe aussi des œuvres littéraires qui se trouvent dans le même cas, et parmi ces dernières figurent certainement les Amours du chevalier de Faublas, de Louvet de Couvray. Depuis longtemps nous étions sollicité de les faire entrer dans notre Petite Bibliothèque Artistique; mais, nous devons l'avouer humblement, nous en rapportant beaucoup trop au mauvais renom de ce curieux roman, duquel nous ne conservions qu'un souvenir assez confus, nous avions hésité jusqu'à présent à lui donner asile. Une lecture complète et attentive nous l'a montré d'une telle innocuité, en comparaison de certains romans célèbres d'aujourd'hui, répandus par milliers, que nous n'avons plus éprouvé de scrupule à publier des Amours du chevalier de Faublas une édition tirée à très petit nombre, relevée par le mérite d'une véritable collaboration artistique, et que son prix élevé rendît inabordable aux acheteurs entre les mains desquels le roman aurait pu présenter quelque danger. Nous avons été confirmé dans notre opinion par des personnes d'un jugement sûr et d'une indiscutable honorabilité, au nombre desquelles nous citerons notre ami, M. Hippolyte Fournier, l'un des représentants les plus sérieux et les plus honnêtes de la critique contemporaine, qui a bien voulu nous offrir de présenter notre édition au public.
Dans une préface où il a discuté la valeur littéraire du Faublas et recherché les conditions dans lesquelles il s'est produit, notre érudit collaborateur s'est attaché à dissiper les injustes préventions accumulées contre une œuvre dont les détails licencieux, tout à fait accessoires, sont traités avec une délicatesse qui les garde d'être trop choquants. Placée entre la dépravation de la société finissante du XVIIIe siècle et l'agitation révolutionnaire qui portait en elle les germes d'une société nouvelle, l'époque où a vécu Louvet se trouvait quelque peu hésitante sur la question des principes, et son roman a dû s'en ressentir; mais c'est aussi parce qu'il donne un tableau fidèle des mœurs du temps qu'il est précieux à conserver. Il n'en est pas moins vrai, d'ailleurs, qu'il a été écrit sous la préoccupation constante d'une idée morale qui se fait jour à chaque instant dans le récit, pour arriver à cette conclusion: qu'un amour véritable finit par triompher de toutes les séductions et que le port de salut se trouve dans le mariage et dans la vie de famille.
Il y a eu plusieurs éditions des Amours de Faublas, tant avant qu'après la mort de Louvet. Nous avons suivi le texte de la troisième, revue par lui, et publiée l'an VI de la République, en 4 volumes in-8o, avec figures de Marillier. Elle se vendait «chez l'auteur, rue de Grenelle-Germain, vis-à-vis la rue de Bourgogne, ci-devant hôtel de Sens, no 1495». Malheureusement, elle est d'une impression assez fautive, et nous avons dû, pour rétablir quelques passages tronqués, recourir aux autres éditions.
Pour les dessins dont nous voulions orner notre publication, il fallait, avec une connaissance exacte de l'époque, beaucoup de tact et un goût fin et délicat. Nous avons trouvé ces qualités réunies chez M. Paul Avril, qui est un nouveau venu dans notre collection, mais que de précédents travaux avaient déjà signalé à l'attention des connaisseurs. Ses compositions ont été très intelligemment gravées par M. Monziès, et l'heureuse association de ces deux artistes a produit une série de gravures qu'on dirait bien plutôt des planches retrouvées du XVIIIe siècle qu'une œuvre exécutée de nos jours. Dans le choix des sujets, qui doivent être la traduction aussi exacte et aussi complète que possible de l'œuvre qu'ils accompagnent, nous avons cherché à nous tenir autant éloigné d'une pruderie trop exclusive que de la recherche des scènes légères, pour lesquelles il faut toujours qu'un éditeur s'impose la plus grande réserve.
Nous pensons donc, grâce aux soins de toute sorte apportés à la publication de l'œuvre de Louvet, en avoir donné une édition sérieuse, que sa valeur littéraire et son mérite artistique rendront également recommandable.
D. J.
Cet aimable chevalier de Faublas, un peu fou, très tendre, sincèrement épris, avec une pointe du libertinage particulier à son époque, est, selon nous, un des héros calomniés ou plutôt incompris de notre littérature.
L'opinion générale, dirigée depuis longtemps par quelques pontifes de la critique contemporaine, Jules Janin en tête, n'a voulu voir dans le personnage présenté par Louvet que le type des vices et de la mollesse dépravante du XVIIIe siècle.
Mais, nous demandera-t-on peut-être, qu'est-ce alors que Faublas, si ce n'est pas cela?
Faublas, c'est tout simplement, habillée à la mode du XVIIIe siècle, la jeunesse insouciante du lendemain qui s'en va droit devant elle les lèvres avides de baisers et pleines de sourires, c'est l'adolescent chercheur de caresses, léger et changeant sans doute, mais si aimant que toujours un souffle venu de son cœur attise l'ardeur de sa fantaisie. Voir en cet être qui ne calcule ni ne réfléchit, qui se livre tout entier, corps et âme, aux maîtresses dont les bras ne peuvent se détacher de son cou; voir en cet enfant câlin, qui devient moralement homme par le remords et la douleur, uniquement le type des vices dépravants du XVIIIe siècle, comme nous le disions tout à l'heure, c'est vraiment teinter de couleurs trop sombres la jolie figure de ce juvénile amoureux.
Toujours est-il que, considérée comme un prétexte à tableaux érotiques et à scènes immorales, l'œuvre charmante, fine et amusante de Louvet s'est vue, enserrée qu'elle a été, en outre, entre le romantisme et le naturalisme triomphants, anathématisée d'abord, puis dédaignée enfin par la société tout entière du XIXe siècle.
C'est donc à la fois un acte de justice et une heureuse inspiration de lettré que de rééditer d'une façon exceptionnellement artistique, qui le remettra forcément en lumière, un ouvrage que sa réserve d'expressions recommande aux délicats, et que son caractère propre, intéressant jusque dans le suranné qu'imprime au style l'archaïsme de certaines phrases, classe au nombre des spécimens curieux de la littérature légère de la fin du XVIIIe siècle.
Espérer que personne ne fera reproche à l'éditeur et à nous de patronner un livre longtemps mis à l'index, ce serait peu connaître la gent humaine.
Nous aurons contre nous les faux austères qui crient au scandale, qui se voilent la face à chaque occasion plus ou moins fondée, en ayant soin, bien entendu, d'écarter les doigts pour ne pas perdre un mot des ardentes pages contre lesquelles ils fulminent en public tout en les goûtant fort en particulier; nous aurons encore contre nous les cyniques de lettres qui trouveront Louvet mignard et fade, parce qu'il a évité d'être grossier. Mais le contingent des lecteurs sur les suffrages desquels nous basons le nouveau succès que ne peut manquer d'avoir Faublas verra, nous en sommes convaincu, les choses de plus haut. A travers les ivresses d'un jeune homme étourdi et sensible, pour parler le langage de Louvet, l'esprit critique de la génération actuelle, si merveilleusement développé, saura percevoir les tendances, très évidentes d'ailleurs, de l'auteur vers des conclusions beaucoup plus morales qu'on ne l'a cru jusqu'ici.
Jamais personne n'a été autant lui-même dans ses écrits que Louvet, et jamais personne, soit qu'on interroge sa vie privée, soit qu'on étudie ses œuvres, fût-ce les plus risquées, ou les actes de sa carrière politique, fût-ce les plus susceptibles de discussion, ne s'est plus instinctivement élevé, pourrait-on dire, au-dessus des idées de son temps.
Ce lecteur assidu de Voltaire et de Rousseau, cet enthousiaste de Mme Roland, cet amant violemment épris de la compagne quasi héroïque qu'il désigne discrètement dans ses mémoires sous le pseudonyme de Lodoïska, nom donné par lui à la seule héroïne sans tache du Faublas; Louvet, en un mot, tout fils de son siècle qu'il s'est montré, n'a été ni un sceptique, ni un blasé, ni un sanguinaire, ni un libertin endurci.
Né tendre, loyal, courageux, sensible et constant, il possédait un ensemble de nobles qualités qui eussent fait de lui, au XVIIe siècle, le type du parfait honnête homme, et à toute autre époque, où la vertu vraie n'était point systématiquement bafouée, il eût pu atteindre, en la méritant à tous égards, la réputation d'homme de bien.
Ce qu'il y eut de mauvais en lui vint de son temps, non de son caractère, qui fut, en maintes circonstances, supérieur à son temps.
Louvet romancier, Louvet révolutionnaire, Louvet conteur galant ou girondin traqué, apparaît, en effet, sincère dans ses convictions, généreux dans ses illusions, fidèle à son culte de tous les héroïsmes que comporte l'amour de l'humanité, à sa croyance dans les abnégations infatigables de l'amitié et de la passion partagée.
Lorsque Louvet conventionnel votera la mort de Louis XVI en demandant le sursis, en le demandant de bonne foi, avec l'espoir que la leçon donnée de la sorte à la royauté ne coûtera pas la vie au roi; lorsqu'il invectivera, non en insulteur vendu, mais en patriote indigné, le tout-puissant et rancunier Robespierre, Louvet restera bien lui-même: humanitaire en principes, énergique dans ses actes, exalté dans ses élans.
Lorsque, consacrant avec bonheur, par un mariage régulier, le lien illégitime qui l'unissait à sa «Lodoïska», il affirmera la droiture de ses intentions, la fermeté de ses sentiments, son respect de la légalité, c'est encore sous une impulsion absolument personnelle qu'il agira.
En politique, en amour, comme aussi en littérature, l'homme primitif, surgissant sans cesse chez Louvet aux côtés de l'homme social, dominera ce dernier, le conseillera, le retiendra sur la pente que le courant général rendait si glissante et si dangereuse même pour les gens de bon vouloir.
Pour apprécier sûrement son livre et sa vie, il faut dans les deux faire la part du feu, ou, ce qui serait plus exact, la part du temps: enfant du XVIIIe siècle finissant, Louvet eut les entraînements lascifs, les frivolités regrettables, les colères folles, les exaltations fâcheuses des phases diverses que marquèrent les années contenues entre 1760 et 1797, dates dont l'une rappelle sa naissance et l'autre sa mort; mais il eut également des admirations fécondes, des idées neuves et généreuses, des délicatesses exquises de cœur et d'esprit, qui, jointes au grand amour par lequel fut charmée et ennoblie sa trop courte existence remplie de si romanesques péripéties, le gardèrent foncièrement des corruptions qu'il savait si bien dépeindre, et stigmatiser à l'occasion.
Déclassé par le fait des revers de fortune qui atteignirent sa famille, dont l'origine nobiliaire n'est nullement contestée, Louvet de Couvray, après avoir passé dans la boutique de papeterie que ses parents tenaient au coin de la rue des Écrivains une enfance attristée par les préférences de son père pour un fils aîné, se trouva lancé en pleine société de l'ancien régime, à l'heure où, plus brillante, plus frivole, plus emportée que jamais vers les plaisirs des sens et de l'esprit, elle jouissait de son reste.
Heure étrange de décadence sociale, parée du charme morbide et grisant de ce qui va finir dans une dernière et trop ardente poussée de vie; heure de fièvre précédant la convulsion suprême qui allait briser cette aristocratie, sur les lèvres de laquelle se retrouvaient à la fois la grimace railleuse de Voltaire, le sourire licencieux de la Dubarry, l'outrecuidante et spirituelle impertinence de Rivarol, tandis qu'au fond, en cherchant bien, derrière le sourire, on sentait sourdre les découragements du vice, si imparfaitement voilé, d'ailleurs, par les emphatiques envolées du faux idéal de passion inventé par Rousseau.
A cette heure-là, l'œuvre de la période philosophique, en ce qu'elle eut de néfaste, était parachevée, et celle de la période révolutionnaire, avec tous ses fruits connus, était en germe.
Les causeries pétillantes de verve des salons, les aventures libertines des boudoirs, les sentimentalités des correspondances amoureuses que se préparaient à troubler les clameurs populacières de la foule ameutée autour des échafauds, les éventualités tragiques de l'exil et de l'incarcération, les liaisons faites de caprice sensuel qu'allaient remplacer les dévouements sublimes des tendresses nées de l'épreuve et de la douleur, toute cette fantasmagorie chatoyante d'un monde pimpant, étincelant, paré, philosophant et marivaudant, vivant dans un nuage de poudre à la maréchale, pivotant allègrement sur ses talons rouges au bord du plus effroyable des précipices que l'imprévoyance d'une génération puisse creuser; tel fut le milieu où s'épanouit la jeunesse de Louvet, où s'éveillèrent ses curiosités et ses ardeurs d'adolescent, ses rêves de succès littéraires.
Lorsqu'il publia, en 1787, la première partie du Faublas, qui ne devait être entièrement terminé qu'en 1789, Louvet n'avait pas vingt-huit ans.
Entré vers sa dix-septième année, comme secrétaire, chez M. Dietrick, minéralogiste distingué, le fils du papetier n'en était pas à ses débuts, du reste, lorsqu'il écrivit son célèbre roman. Déjà un triomphe éclatant avait mis en lumière Louvet, chargé, tout en rédigeant pour son maître des mémoires qui parurent imprimés dans le recueil de l'Académie, de prendre en main les intérêts d'une candidate au prix Monthyon.
Récemment fondé, ce prix allait être donné pour la première fois, lorsqu'on s'adressa au jeune secrétaire de M. Dietrick pour présenter et soutenir les droits d'une pauvre servante devenue l'appui volontaire de ses maîtresses tombées dans une affreuse misère.
Il était d'usage, alors, que les titres des concurrents fussent discutés dans les feuilles publiques. Louvet, de la plume alerte qui devait plus tard conter des aventures d'alcôve, retraça en des lignes émues l'histoire d'un cœur simple, honnête et dévoué; sa cliente fut choisie, acclamée, grâce à l'éloquence avec laquelle il avait mis en relief ses mérites, et le hasard, qui crée parfois de piquantes antithèses, fit que le nom de l'auteur des Amours de Faublas resta intimement lié au souvenir du prix de vertu décerné pour la première fois.
Est-ce à dire qu'en ce temps-là Louvet offrait, pour son compte, des conditions capables de lui faire octroyer la récompense qu'il avait charitablement obtenue pour une autre?
Son ombre sourirait finement, en se profilant railleuse dans la pénombre du passé, si cette illusion naïve pouvait nous venir.
Tout porte à croire, au contraire, que le fougueux adolescent, séparé de l'amie d'enfance objet de ses premières et de ses dernières tendresses, essayait alors de donner le change au chagrin qu'il avait de savoir Lodoïska mariée, en dépensant en menue monnaie quelque peu du trésor d'amour que, malgré tout, il ne cessa de garder pour elle.
Le chevalier de Faublas n'est pas, ainsi qu'on l'a supposé longtemps, le portrait de cet abbé de Choisy qui s'habilla et vécut en femme pendant plusieurs années, et qui devait mêler aux travaux historiques qu'il a laissés le souvenir d'une existence scandaleuse. Faublas, on n'en doute plus maintenant, c'est Louvet peint par lui-même, c'est Louvet à dix-sept ans, mignon, charmant, bien pris dans sa petite taille si favorable à ces déguisements féminins, dont il portait les atours à rendre jalouses Dorimène et Cydalise; Faublas, c'est Louvet avec ses cheveux blonds, avec ses yeux bleus langoureux ou rieurs, au regard tantôt caressant et timide comme celui d'un enfant, tantôt loyal et fier comme celui d'un gentilhomme, et plus tard fulgurant d'une noble colère, alors que le coureur de ruelles, amendé et devenu conventionnel, se dressa, éloquent et hardi, en accusateur devant Robespierre.
Et c'est justement parce que Faublas n'est autre que Louvet qu'on rencontre dans un livre licencieux au premier chef ces conclusions morales, faciles à tirer, dont nous avons précédemment souligné l'existence.
Tirer une moralité des amours du chevalier de Faublas! vous nous la baillez belle, dira peut-être la critique, si elle daigne un jour réfuter nos allégations. Où donc cette moralité-là, s'il vous plaît, a-t-elle pu, dans l'espèce, se nicher?
Serait-ce, par hasard, dans le boudoir théâtre des capitulations savantes de la marquise de B…, dans la gorgerette largement entre-bâillée de la petite de Mésanges, sur le visage mutin de Justine, dans la fameuse grotte où Mme de Lignolle devine et joue, en compagnie de Faublas, des charades d'une saveur si ultra-gauloise que le romancier est obligé d'en donner la teneur en italien, n'osant l'exprimer en français? Est-ce sur les lèvres de Sophie recevant, dans le parloir de son couvent, le premier baiser de Faublas? Oui et non.
Non, si l'on ne veut considérer que les côtés sensuels de l'œuvre. Oui, si l'on prend la peine d'en approfondir les bons vouloirs, sans s'attarder plus que de raison aux peintures.
Que voit-on, en réalité, dans les conséquences logiques des situations du Faublas? On voit l'inconduite punie, la passion malsaine purifiée par les souffrances du remords, le mariage d'amour présenté non comme un paradis destiné à être perdu, mais comme la sûre étape qui mène au paradis retrouvé.
Tandis que, bien après Louvet, les romantiques déifieront les liaisons illégitimes qui s'affichent au grand jour, et qu'actuellement le naturalisme, en réduisant l'amour à l'état d'une fonction exclusivement animale, grossièrement impérieuse, en excuse l'assouvissement bestial, l'auteur de Faublas, contemporain pourtant d'une époque plus relâchée de mœurs que la nôtre, a su se montrer moraliste d'intentions et raffiné de sentiments. On sent dans l'écrivain un respect de soi et des autres qui l'arrête à propos sur la limite qui sépare le licencieux de l'obscène, qui le maintient, sans danger que le pied lui glisse, sur le bord de l'ornière au fond de laquelle les pourceaux d'Épicure s'embourbent à plaisir.
Gentilhomme d'origine, bourgeois par l'éducation, Louvet, pas plus dans ses écrits que dans sa vie, n'a rien du bohème de lettres assoiffé de réclame et affamé d'argent. Il eut ses ambitions, sans doute; il rêva d'être quelqu'un en politique et en littérature; ce fut un besogneux, parfois, qui allongea peut-être un peu trop son livre lorsqu'il était forcé d'en vivre; mais il ne fut jamais le plat courtisan de la foule, qui, voulant par elle arriver à un lucratif triomphe, la flatte dans ses appétits et lui parle son langage. A son public, composé surtout de belles dames inconstantes et de grands seigneurs libertins, Louvet ne craindra pas de décocher l'épigramme; quand il le faut, il ne recule pas devant la nécessité de mélanger aux chaudes peintures du vice le blâme que doivent entraîner ses conséquences et ses excès.
A ces blasés exclusivement en quête de sensations et habitués à disséquer le sentiment sans l'éprouver, à ces gangrenés du scepticisme, il soulignera l'odieux du manque d'amour dans le plaisir, en ne trouvant d'excuses aux escapades de Faublas que parce que, peu ou prou, l'amour se mêle, fût-ce sans qu'il s'en doute, aux fredaines du chevalier.
Le charme de Faublas, ce qui le rend possible, ce qui le fait admissible, c'est que précisément, malgré ses mœurs déréglées, il est dénué du caractère essentiel du vicieux: la recherche de la sensation sans amour.
L'amour déborde à tout instant du cœur de l'inflammable personnage. L'amant naïf de la marquise de B…, l'heureux possesseur de la jolie Mme de Lignolle, l'époux plein de tendresse de la timide Sophie, n'est donc qu'un ébloui et qu'un enivré, ce n'est pas un corrompu.
Et cela est si vrai que l'alcôve de Coralie, l'impure experte dans la pratique du plaisir, ne le retient pas longtemps; où il court, où il vole, avec la fiévreuse impatience de l'homme et de l'amant, c'est vers cette belle Mme de B… qui l'adore au point de se faire tuer pour lui; c'est vers cette vive et touchante comtesse de Lignolle qui l'aime tant que, désespérée, elle se jette à l'eau à l'heure de son abandon; c'est vers cette charmante et candide Sophie à la vie de laquelle, un jour, il associera définitivement la sienne. Même lorsqu'entre temps il chiffonne le corsage de Justine, la piquante soubrette de Mme de B…, c'est par compassion plus que par libertinage. Un jour, n'a-t-il pas surpris dans les yeux de la jeune fille tristement fixés sur lui une larme furtive et jalouse, alors que, sans souci de sa présence, il couvrait de baisers passionnés les mains de la marquise?
Justine pleure parce qu'elle est jalouse, et elle est jalouse parce qu'elle l'aime. Que peut faire le chevalier, qui, du reste, n'a rien d'un amoureux transi? Sécher les pleurs de ces yeux qui, tout beaux qu'ils sont, ont, par-dessus tout, le mérite d'être tendres; apaiser dans un élan irréfléchi la fièvre qu'il a involontairement allumée.
S'il est sans scrupules comme son siècle, Faublas est sans préméditation dans le mal comme la jeunesse généreuse et étourdie. Malgré ses légèretés, ses emportements sensuels, malgré ses fautes, on discerne en lui les qualités d'un homme de cœur, et, si étrange que cela puisse paraître dans un tel personnage, il y a chez ce coureur d'aventures l'étoffe d'un vrai chef de famille.
Au milieu de ses égarements, Faublas reste fidèle à son rêve de félicité intime. Sophie, la fiancée de son choix, ne cesse de préoccuper sa pensée, tandis que son tempérament l'entraîne. L'épouse attendue avec sa candeur presque enfantine encore, avec son regard modeste, son front rougissant, l'émoi de son premier frisson d'amour, reste pour lui l'incarnation suprême du bonheur durable et certain.
Sans doute, c'est tardivement que Faublas se montre digne de goûter les joies honnêtes et pures qu'il convoite, mais qu'il éloigne de sa route par des folies dont la plus grave est de ne pas savoir résister au désir de posséder avant le mariage la trop confiante Sophie.
Cependant Faublas, susceptible d'un idéal qui a pour aspiration définitive une union légitime et honorable, ne porte aucune atteinte par sa manière de penser, s'il y manque par sa manière d'agir, à ce respect des lois sociales dont font aujourd'hui si bon marché les tristes et ignobles poursuivants des prostituées, héroïnes de prédilection de tant de romans contemporains.
Louvet, qui dans son livre n'insulte ni la femme, ni le mariage, ni l'amour, ne se désintéresse pas de la famille; il lui fait jouer son rôle dans cette odyssée de boudoir, qui est en même temps une peinture de mœurs si bien faite, et, quand il la montre manquant à ses devoirs, le sens moral de l'homme corrige à propos les audaces du romancier.
La scène entre Faublas et son père, lorsqu'ils se retrouvent tous deux, par hasard, chez Coralie, est un petit chef-d'œuvre de moraliste bien inspiré: forcé de rougir devant son fils qui le surprend en mauvais lieu, le baron de Faublas, déchu de son droit de contrôle paternel par la légèreté de sa propre conduite, sent se fondre dans une immense tristesse son étonnement mêlé de colère et ses bouffées de vice. Comme revenu à lui-même, il stigmatise avec conviction, devant le chevalier, cette existence de débauches qui ménage de telles rencontres! Comme il en dévoile les dangers, les dégoûts, les hontes!
Ce n'est plus le viveur titré, hautain et sceptique, impertinent et libertin, du XVIIIe siècle, qui parle par la bouche du baron de Faublas, c'est un chef de famille navré, humilié, repentant, qui se révèle vraiment père au milieu de l'abjection dont la présence de son fils lui fait comprendre, pour la première fois, toute la profondeur.
Ce n'est pas Louvet qui s'avisera de poétiser, de déifier la courtisane. La vraie femme, selon lui, c'est celle qu'on peut également aimer et estimer. Aussi donnera-t-il à sa chère compagne le nom de la seule héroïne vertueuse de son livre. Et quand nous disons la seule, nous nous trompons, car il y a encore la sœur aimable et sage du trop ardent chevalier, cette Mlle de Faublas, type charmant d'honnête personne, se détachant gracieuse et chaste sur le fond licencieux de l'époque.
A côté de ces deux femmes, le père de Sophie, défenseur implacable de l'honneur de sa fille, outragée par Faublas, vient compléter le tableau de cette famille aimante et protectrice, dont la double mission est de consoler et de diriger.
Nous ne chercherons donc pas davantage à défendre contre le grief d'immoralité une œuvre dont le côté licencieux est traité avec une légèreté de touche qui doit lui valoir la plus complète indulgence. Louvet, habile dans la périphrase, cette nécessité qui s'impose lorsque les sujets en cause sont des souvenirs d'alcôve, a eu des tours ingénieux et exquis dans Faublas. A l'inverse de Richardson, qui dira crûment dans Paméla ou la Vertu récompensée, en parlant d'un maître trop entreprenant vis-à-vis de sa servante: «Il lui mit la main dans le sein», le narrateur des aventures de Faublas tracera cette phrase délicate pour souligner les premières hardiesses du chevalier, entourant de ses bras le cou de la belle marquise de B…: «Mon heureuse main, guidée par le hasard et par l'amour, descendit un peu plus bas.»
En sachant bien dire que ne peut-on dire?
Louvet, du reste, est coutumier de ces périodes finement gazées avec lesquelles alterne, il est vrai, le terme visiblement suranné, défaut prévu plus que regrettable, étant donnée l'époque où parut le roman.
N'en est-il pas des ouvrages dont l'archaïsme complète la physionomie comme de ces objets anciens dont le moindre détail authentique, fût-il d'un goût douteux, vaut tous les perfectionnements récemment inventés, la modernité effaçant le caractère le plus intéressant des choses: celui du temps. Ce caractère-là, certes, ne manque pas au Faublas. On y voit clairement la transformation de la littérature française, telle que la produisit l'avènement de J.-J. Rousseau, et sa domination sur les esprits de la fin du siècle. La facture sobre et correcte des écrivains de la phase classique, si brillamment représentée au XVIIe siècle, et le tour spirituel, incisif, plus railleur qu'exalté, des Voltairiens proprement dits, ne se retrouvaient plus guère dans les publications emphatiques d'une époque passionnée pour le Contrat social et la Nouvelle Héloïse. Louvet, tout aimable conteur qu'il fût, ne put se défendre de cet enveloppement qui, en lui enlevant certain naturel, le range au nombre des écrivains typiques de son temps.
On a voulu voir aussi dans l'œuvre la plus célèbre de sa vie une émanation de ses rancunes de gentilhomme déclassé et de ses antagonismes de républicain sincère contre l'ancien régime. Beaucoup ont considéré Faublas comme une sorte de pamphlet. Rien de tel, à nos yeux, ne perce dans ce roman, qui n'est que la peinture vive et légère d'une société que Louvet combattit à visage découvert aux heures de crise, mais qu'il ne songea pas à insulter sournoisement aux heures de calme.
Lorsque, en 1789, l'auteur termina son livre, il était retiré tranquillement à la campagne avec Lodoïska, devenue veuve, et qui était accourue auprès de son ami pour embellir son existence en la partageant. Les joies du cœur remplissaient tous les moments des deux amants; leurs goûts modestes, en rapport avec leur mince fortune, les éloignaient de la haine envieuse, et Louvet, trop heureux pour être méchant, Louvet, qui ne pouvait présager encore qu'il serait conventionnel, ne dut avoir pour but, en écrivant Faublas, que de mettre son nom plus en lumière et de faire entrer quelque argent au logis.
Il ne semble pas, lorsqu'il parle lui-même de Faublas dans ses mémoires, qu'il ait pu avoir d'autre intention. Dans une de ces notices qu'il a datées des Grottes de Saint-Émilion, en novembre 1793, alors qu'il était poursuivi et traqué, il écrit ceci: «Enfermé dans un jardin, à quelques lieues de Paris, loin de tout importun, j'écrivais, au printemps de 1789, six petits volumes,—les derniers formant la troisième partie des aventures de Faublas,—qui devaient, précipitant encore la vente des premiers, fonder ma petite fortune. A propos de ces petits livres, j'espère que tout homme impartial me rendra la justice de convenir qu'au milieu des légèretés dont ils sont remplis on trouve dans les passages sérieux, où l'auteur se montre, un grand amour de la philosophie, et surtout des principes de républicanisme assez rares encore à l'époque où je les écrivais…»
Il est possible que ces «principes de républicanisme» aient donné le change sur les intentions d'un homme de lettres qui, en les laissant percer, obéissait à ses convictions, et non à des haines. Mais on n'y peut rien voir de décisif, et nous n'en persistons pas moins à penser que Louvet ne s'est affirmé pamphlétaire que dans ses écrits politiques, ceux-là violents et agressifs et aussi courageusement publiés que loyalement pensés.
Ayant respiré à pleins poumons l'atmosphère de son temps, Louvet, après avoir vécu les aventures de Faublas, les écrivit tout simplement, sans se douter qu'en composant son œuvre il coopérait à la formation de la singulière trilogie de héros fictifs qui sont venus personnifier, en ses nuances diverses, le sensualisme de tout un siècle.
Faublas, prenant place entre le Lovelace de Richardson et le Chérubin de Beaumarchais, est à son plan: il est la sentimentalité séductrice donnant au besoin du plaisir chez l'homme la grâce de l'amour, tandis que Chérubin, c'est le désir éclectique, ébloui jusqu'à l'aveuglement, non point raffiné, mais gourmand, et aussi brutal, dans son habileté câline, que le sensualisme à froid de Lovelace est corrompu.
De ces trois personnages, Chérubin, quoique étant de son siècle par le costume et les mœurs, est celui qui procède directement de la nature, et il pourrait être de toutes les époques par son essence. Lovelace et Faublas, au contraire, sont exclusivement de leur temps, dont ils résument, le premier, toutes les grâces et tous les vices, le second, les aspirations inconscientes vers un idéal d'amour nouveau pour l'époque et où la tendresse apparaît poétisant le désir. Avec l'ancien régime, ses élégances, ses fins soupers, ses causeries de salon, ses liaisons sans lendemain, tous deux ont disparu. Ils se sont évanouis, l'un malfaisant de parti pris, l'autre faisant le mal sans le savoir, et tous deux sont restés charmants sous leurs formes d'ombres souriantes, voluptueusement évoquées par des écrivains qui ont dû à ces créations de passer à la postérité.
Inférieur comme talent et comme célébrité à Beaumarchais et à Richardson, Louvet leur a été supérieur par la puissance d'aimer. Sa force et sa grâce, son originalité et son charme d'écrivain, sont venus de là beaucoup plus, peut-être, que des facultés spéciales d'où découle l'art d'écrire.
A une époque où la sensation était tout, Louvet a connu l'émotion tendre qui vient du cœur, il a connu les tristesses, les dévouements, les extases divines des grands sentiments, et, comme il a été plus que personne l'homme de ses écrits, il a mis dans Faublas ce qui rajeunit éternellement les œuvres, ce qui les épure, les grandit quelque petits qu'en paraissent les points de départ, quelque lointains qu'en soient les premiers succès: le reflet d'une âme aimante et d'un esprit délicat.
Moralité dans le fond, retenue dans la forme, tableaux vifs, peintures risquées sans être choquantes; tels sont, dans leur ensemble, les qualités et les attraits de l'œuvre dont la réapparition va raviver le souvenir d'un écrivain trop oublié et la physionomie de ce galant chevalier dont les aventures ont excité un véritable engouement dans la société de son temps.
Comment de nos jours l'œuvre de Louvet sera-t-elle accueillie? Favorablement, nous l'espérons: car, pour la critique du XIXe siècle, qui de plus en plus donne le pas sur toutes choses à l'analyse psychologique, l'œuvre est riche en motifs d'études de ce genre. Les émotions d'un homme qui a réellement vécu et l'esprit d'un siècle qui a prodigieusement pensé ont laissé leur empreinte à ces récits légers, qui, désencadrés de leur milieu, n'en prennent que plus de relief et de vitalité typique.
Si tout le monde n'apprécie pas le Faublas à sa juste valeur, nous sommes toujours certain que les lettrés goûteront pleinement, et c'est là l'essentiel, l'artistique édition qui leur est, d'ailleurs, particulièrement destinée, et à laquelle leur patronage ne peut manquer d'assurer le succès.
Quant à nous, c'est en toute conscience que nous avons consacré cette trop longue préface à la réhabilitation de l'œuvre de Louvet. En littérature comme dans la vie, les plus à plaindre sont les méconnus, et, si nous avons pu éclairer, même d'une faible lueur, les intentions de l'auteur de Faublas, nous aurons rempli le but que nous nous étions proposé.
Hippolyte Fournier.
LES AMOURS
DU CHEVALIER
DE FAUBLAS
Eh oui! c'est précisément parce qu'il y a déjà cinq ou six préfaces qu'il en faut encore une; ce qui rappelle le mot de cette femme d'esprit: «Il n'y a que le premier pas qui coûte.»
J'ai voulu que, dans cette édition nouvelle, les récits de mon héros ne souffrissent plus d'interruption. Les préfaces jetées à la tête de chacune des deux dernières parties, faites à des époques différentes, embarrassoient ma nouvelle distribution. Les falloit-il supprimer? Qui, moi! tuer mes préfaces! moi, commettre un parricide! D'ailleurs, n'y a-t-il pas des gens qui n'aiment pas qu'on leur retranche rien, et qui me seroient venus dire: «Il y avoit là des préfaces! Que sont devenues mes préfaces? Rendez-moi mes préfaces!» Et puis, quelle joie pour ceux de mes confrères en librairie qui, enrageant de ne pouvoir pas faire de livres, se consolent un peu en volant les livres d'autrui! Les contrefacteurs auroient dit: «Elle n'est pas complète, son édition! il y manque les préfaces!»
Afin donc que, d'une part, mon héros, quand il raconte, n'ait pas la parole coupée par des préfaces, et que, de l'autre, il ne manque à cette édition aucune des préfaces des Six Semaines, ni la préface de la Fin des Amours, ni la préface d'Une Année, je place à la tête du premier volume toutes ces préfaces à jamais amies, et, pour consacrer leur séparation première et leur éternelle réunion, je jette devant elles cette préface des préfaces.
(Ils parurent pour la première fois en 1786)
A M. BR*** FILS
Notre amitié naquit, pour ainsi dire, dans ton berceau; elle fut l'instinct de notre premier âge et l'amusement de notre adolescence: nourrie par l'habitude, fortifiée par la réflexion, elle fait le charme de notre jeunesse. Ton indulgence a toujours encouragé mes foibles talens; ce fut toi qui, le premier, m'invitas à les essayer; c'est toi qui naguère m'as pressé de descendre dans la vaste carrière où se sont égarés avant moi tant de jeunes gens présomptueux. Peut-être comme eux je m'y serai trop tôt montré; mais enfin je t'ai cru, j'ai écrit, je te dédie mon premier ouvrage.
La critique ne manquera pas de dire que, très heureusement pour les lecteurs, la mode de ces longs discours complimenteurs, toujours placés à la tête d'un livre somnifère, est depuis longtemps passée. Je répondrai qu'il ne s'agit pas ici d'un fade éloge, donné pour de bonnes raisons à quelque riche anobli, ou à quelque petit commis protecteur. Je répondrai que, si l'usage des épîtres dédicatoires n'avoit pas existé depuis longtemps, il m'eût fallu l'inventer aujourd'hui pour toi.
O mon ami! ta respectable mère, ton père bienfaisant, m'ont rendu des services qu'on ne paye point avec de l'or, des services que jamais je ne pourrois acquitter, quand même je deviendrois aussi riche que je le suis peu. Ton père et ta mère m'ont sauvé la vie: dis-leur que j'aime la vie à cause d'eux. Ils se sont efforcés de me donner un état qu'on croit noble et libre: dis-leur que l'espérance de devenir un jour, avec toi, l'appui de leur vieillesse respectée anima mon courage dans les cruelles épreuves qu'il m'a fallu subir, et me soutiendra toujours dans mes travaux. Ils se sont réunis à toi pour m'engager à cultiver les lettres: dis-leur que, si le chevalier de Faublas ne meurt pas en naissant, j'oserai le leur présenter lorsque, mûri par l'âge, instruit par l'expérience, devenu moins frivole et plus réservé, ce jeune homme me paroîtra digne d'eux.
Quant à toi, j'espère que cet hommage public, rendu par la reconnoissance à la bienfaisance et à l'amitié, te flattera d'autant plus qu'il ne fut point mendié, et que peut-être il n'étoit pas attendu.
Je suis ton ami,
Louvet.
(Il fut mis à la tête de la seconde édition, faite en 1790)
Peut-être trouvera-t-on que j'ai fait dans la Première Année de Faublas des changemens heureux; je crois pourtant que c'étoient surtout les Six Semaines qui avoient besoin d'être retouchées: de longues et nombreuses digressions y nuisoient à la rapidité du récit; celles qu'il ne falloit pas retrancher tout à fait, je les ai beaucoup abrégées; mais en même temps j'ai cru pouvoir ajouter quelques morceaux par lesquels je ne présume pas que la gaieté doive être diminuée, ni l'intérêt refroidi. Ce sera sans doute une raison de plus qui déterminera le public à préférer cette bonne édition aux détestables contrefaçons que des fripons en ont faites, et que d'autres fripons étalent ou colportent avec une impudence à laquelle il est bien temps qu'une loi tutélaire des propriétés mette un terme.
PRÉFACE, AVERTISSEMENT DES SIX SEMAINES
(Ces deux volumes furent publiés pour la première fois au printemps de 1786)
A M. TOUSTAING
Monsieur,
Votre nom, destiné à plusieurs sortes de gloire, est en même temps consigné dans les fastes de la littérature et dans les annales de l'histoire. On devroit donc le lire à la tête d'un ouvrage plus recommandable que celui-ci; mais je serois trop ingrat si je ne vous offrois point un hommage et des remercîmens publics. Que ne m'a-t-il été possible de suivre vos conseils! Faublas, pour la seconde fois soumis à votre censure[1], vous auroit, avec bien d'autres obligations, celle de se montrer déjà beaucoup plus formé. Vous paroissez croire, et vous voulez bien me dire que je pourrois, avec quelque succès, embrasser un genre plus sérieux, et que je devrois consacrer à la morale et à la philosophie mes dispositions, que vous appelez mes talens. Quelquefois je vous ai vu sourire aux espiègleries de mon Chevalier; plus souvent je vous ai entendu m'exprimer sans détour le regret que vous aviez de le trouver toujours si peu raisonnable. J'ai eu l'honneur de vous observer qu'il pourroit, comme tant d'autres enfans de bonne maison, complètement réparer, par les actions exemplaires de l'âge mûr, les erreurs peut-être excusables de son printemps. Ici j'ajouterai que, pour corriger les écarts du jeune homme, l'historien fidèle attend impatiemment que l'heure du héros soit venue; et, si cet aveu ne suffit pas pour m'obtenir grâce auprès des gens sévères, je citerai ma justification imprimée longtemps avant que je fusse né pour commettre la faute. Dans un conte philosophique écrit avec la facilité prodigieuse et l'inimitable naturel qui caractérisent les ouvrages de ce génie universel, presque toujours supérieur à son sujet, Voltaire m'a dit: «Monseigneur, vous avez rêvé tout cela; nos idées ne dépendent pas plus de nous dans le sommeil que dans la veille. Une puissance supérieure a voulu que cette file d'idées vous ait passé par la tête, pour vous donner apparemment quelque instruction dont vous ferez votre profit.»
[1] Aujourd'hui qu'il n'y a plus de censure, je dois encore rendre justice à M. Toustaing: il étoit du petit nombre de ces censeurs qui ne se faisoient point un malin plaisir de tourmenter les gens de lettres.
Je suis, etc.
Louvet de Couvray.
P.-S. Pourquoi de Couvray?—Voyez la page suivante, et vous le saurez.
Je ne sais, Monsieur, si vous êtes l'heureux propriétaire d'une figure semblable à la mienne, et si, comme moi, vous descendez de ce fameux Louvet… Je ne sais; mais il ne m'est plus permis de douter que nous avons à peu près le même âge, que nous sommes décorés d'un titre presque semblable, que nous nous glorifions d'un nom absolument pareil. Je suis surtout frappé d'un trait de ressemblance plus précieux pour nous, plus intéressant pour la patrie: c'est que nous pourrons aller ensemble à l'immortalité, puisque tous deux nous composons de très jolie prose, puisque tous deux nous nous faisons imprimer vifs.
J'aime à croire que cette parfaite analogie vous a d'abord semblé, comme à moi, très flatteuse; et cependant je suis persuadé que maintenant vous sentez, ainsi que moi, le terrible inconvénient qu'elle entraîne. A quelle marque certaine deux rivaux si ressemblans, en même temps lancés dans la vaste carrière, seront-ils reconnus et distingués? Quand le monde retentira de notre éloge commun; quand nos chefs-d'œuvre, pareillement signés, voyageront d'un pôle à l'autre, qui séparera nos deux noms confondus au temple de Mémoire? Qui me conservera ma réputation, que sans cesse vous usurperez sans vous en douter? Qui vous restituera votre gloire, que je vous volerai continuellement sans le vouloir? Quel homme assez pénétrant pourra, par une assez équitable répartition, rendre à chacun la juste portion de célébrité que chacun aura méritée? Que ferai-je pour qu'on ne vous prête pas tout mon esprit? Comment empêcherez-vous qu'on ne me gratifie de toute votre éloquence? Ah! Monsieur! Monsieur!
Il est vrai que l'ingrate fortune a mis entre nos destinées une différence pour vous tout avantageuse: vous êtes avocat-au, je ne suis qu'avocat-en; vous avez prononcé, dans une grande assemblée, un grand discours: je n'ai fait qu'un petit roman. Or, tous les orateurs conviennent qu'il est plus difficile de haranguer le public que d'écrire dans le cabinet; et tous les gens instruits sont épouvantés de l'immense intervalle qui sépare les avocats-en des avocats-au. Mais je vous observe qu'il y a encore dans l'État des milliers d'ignorans qui ne connoissent ni mon roman ni votre discours, et qui, dans leur profonde insouciance, ne se sont pas donné la peine d'apprendre quelles belles prérogatives sont attachées à ce petit mot au, dont, à votre place, je serois très fier. Ainsi, Monsieur, vous voyez bien que malgré le roman et le discours, et le en et le au, tous ces gens-là, qui ne peuvent manquer d'entendre bientôt parler de vous et de moi, nous prendroient continuellement l'un pour l'autre. Ah! Monsieur, croyez-moi, hâtons-nous d'épargner à nos contemporains ces perpétuelles méprises qui donneroient trop d'embarras à nos neveux.
D'abord j'avois imaginé que, vous trouvant le plus intéressé à prévenir les doutes de la postérité, vous voudriez bien faire comme vos nobles confrères, qui, pour la plus grande gloire du barreau, augmentent ordinairement d'un superbe surnom leur baptistère devenu trop modeste. Depuis, en y réfléchissant davantage, j'ai senti que délicatement je devois me donner ce ridicule pour vous l'épargner. Voilà ce qui me détermine. Vous pouvez, si bon vous semble, rester monsieur Louvet tout court, moi, je veux être éternellement
Louvet de Couvray[2].
[2] Oui; mais ne voilà-t-il pas que la plus impertinente des révolutions m'enlève ma noblesse d'hier! Que je suis heureux d'avoir un nom de baptême! Va donc pour Jean-Baptiste Louvet.
La seconde édition s'étant faite en 1790, j'ajoutai la note suivante.
A ELLE
J'aurois osé le lui dédier, s'il s'en fût trouvé digne.
(Ces six volumes furent publiés pour la première fois en juillet 1789)
Que de bruit pour un petit livre! Si beaucoup en ont ri, quelques-uns en ont pleuré; plusieurs l'ont imité, d'autres l'ont travesti; d'honnêtes gens l'ont contrefait, des gens honnêtes l'ont dénigré. Ainsi puissamment encouragé de toutes les manières, j'ai repris la plume avec quelque confiance, et j'ai fini.
Maintenant, Lecteur impartial, c'est à vous de m'entendre et de prononcer. Si quelquefois je suis trop gai, pardonnez-moi. Tant de romans m'avoient tant fait bâiller! Je tremblois d'être comme eux soporifique; au reste, attendez quelques années, peut-être alors j'en ferai de plus ennuyeux qui seront meilleurs. Je dis: peut-être. En effet, un romancier ne doit-il pas être l'historien fidèle de son âge? Peut-il peindre autre chose que ce qu'il a vu? O vous tous qui criez si fort, changez vos mœurs, je changerai mes tableaux.
M'accusiez-vous aussi d'immoralité? Bientôt je tâcherai de vous persuader que vous aviez tort; mais auparavant approchez, prêtez l'oreille: c'est une vérité que je vais dire, et, comme la littérature a encore ses aristocrates, il faut parler bas. En conscience, étoient-ils bien moraux, ces chefs-d'œuvre par lesquels se sont immortalisés l'Arioste et le Tasse, La Fontaine et Molière, Voltaire enfin, Voltaire et tant d'autres, beaucoup moins grands que lui, quoique plus grands que moi? Tenez, j'ai bien peur que cette condition de moralité, si rigoureusement imposée de nos jours à tout ouvrage d'imagination, ne soit un violent remède savamment employé par ceux de mes frêles contemporains qui, désespérant de pouvoir jamais rien produire, voudroient nous châtrer.
Quoi qu'il en soit, lisez mon dénouement, il me justifiera sans doute. Au surplus, je déclare, et, dès que les circonstances me le permettront, je m'engage à prouver que cet ouvrage, si frivole en ses détails, est au fond très moral; qu'il n'a peut-être pas vingt pages qui ne marchent pas directement vers un but d'utilité première, de sagesse profonde, auquel j'ai tendu sans cesse. J'avoue qu'il sera donné à peu de gens de l'apercevoir d'abord; mais je maintiens qu'avec le temps je le pourrai découvrir à tous, et le jour de mes confidences sera, je vous le promets, le jour des surprises.
Ils m'ont encore reproché de grandes négligences. Eh! quel écrivain, assez peu maître de son art, voudroit également soigner toutes les parties d'un long ouvrage? Quant à moi, je crois fermement qu'il n'y a point de naturel sans négligences, principalement dans le dialogue. C'est là que, pour être plus vrai, sacrifiant partout l'élégance à la simplicité, je serai souvent incorrect et quelquefois trivial. C'est, ce me semble, où le personnage va parler que l'auteur doit cesser d'écrire; et néanmoins je me reconnois très fautif, s'il m'est souvent arrivé de permettre que Mme de B… s'exprimât comme Justine, et Rosambert comme M. de B…
Patient Lecteur, encore un paragraphe apologétique.
Ces romans prétendus étrangers, qu'on s'arrache le matin et qui sont oubliés le soir, ne renferment, pour la plupart, que des caractères communs à presque tous les peuples de notre Europe, et des aventures de tous les pays. J'ai tâché que Faublas, frivole et galant comme la nation pour laquelle et par laquelle il fut fait, eût, pour ainsi dire, une figure françoise. J'ai tâché qu'au milieu de tous ses défauts on lui reconnût le ton, le langage et les mœurs des jeunes gens de ma patrie. C'est en France, et ce n'est qu'en France, je crois, qu'il faudra chercher les autres originaux dont j'ai trop foiblement dessiné les copies: des maris en même temps libertins, jaloux, commodes et crédules comme monsieur le marquis; des beautés séduisantes, trompées et trompeuses comme Mme de B…; des femmes à la fois étourdies et sensibles comme ma petite Éléonore, chaque jour regrettée. Enfin, je me suis efforcé de faire en sorte qu'on ne pût, sans blesser un peu la vraisemblance, imprimer sur le frontispice de ce roman-ci ce honteux mensonge: traduit de l'anglois.
Mais, pendant que j'écrivois ces futilités, un grand changement s'est fait dans mon heureuse patrie. La plus belle carrière est désormais ouverte à ceux qui ambitionneront une gloire solide, utile à leur pays, utile au monde entier. La carrière est ouverte! Pourquoi ne m'y suis-je pas déjà montré? C'est que je ne m'en crois pas encore digne[3].
[3] Il n'y avoit pas huit jours que cette espèce de préface étoit écrite, quand l'ouvrage de M. Mounier a paru. L'indignation dont il m'a rempli m'a forcé à prendre la plume. Voyez chez M. Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, à Paris, la brochure intitulée: Paris justifié.
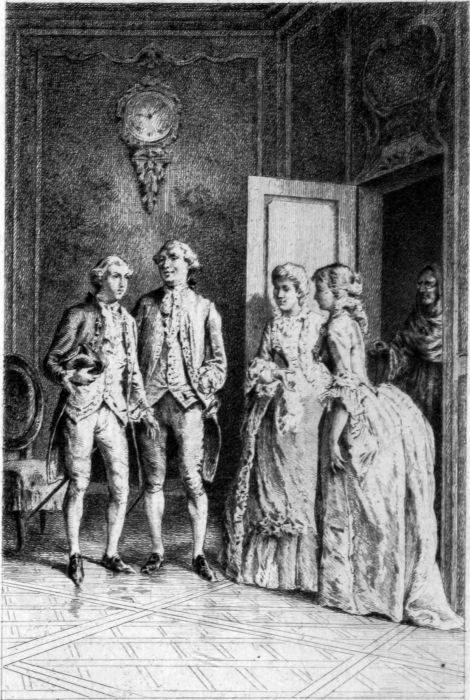
On m'a dit que mes aïeux, considérés dans leur province, y avoient toujours joui d'une fortune honnête et d'un rang distingué. Mon père, le baron de Faublas, me transmit leur antique noblesse sans altération; ma mère mourut trop tôt. Je n'avois pas seize ans, quand ma sœur, plus jeune que moi de dix-huit mois, fut mise au couvent à Paris. Le baron, qui l'y conduisit, saisit avec plaisir cette occasion de montrer la capitale à un fils pour l'éducation duquel il n'avoit rien négligé jusqu'alors.
Ce fut en octobre 1783 que nous entrâmes dans la capitale par le faubourg Saint-Marceau. Je cherchois cette ville superbe dont j'avois lu de si brillantes descriptions. Je voyois de laides chaumières très hautes, de longues rues très étroites, des malheureux couverts de haillons, une foule d'enfans presque nus; je voyois la population nombreuse et l'horrible misère. Je demandai à mon père si c'étoit là Paris: il me répondit froidement que ce n'étoit pas le plus beau quartier; que le lendemain nous aurions le temps d'en visiter un autre. Il étoit presque nuit; Adélaïde (c'est le nom de ma sœur) entra dans son couvent, où elle étoit attendue. Mon père descendit avec moi près de l'Arsenal, chez M. Duportail, son intime ami, de qui je parlerai plus d'une fois dans la suite de ces Mémoires.
Le lendemain, mon père me tint parole, en un quart d'heure une voiture rapide nous conduisit à la place Louis XV. Là, nous mîmes pied à terre; le spectacle qui frappa mes yeux les éblouit de sa magnificence. A droite, la Seine à regret fugitive; sur la rive, de vastes châteaux; de superbes palais à gauche; une promenade charmante derrière moi; en face, un jardin majestueux. Nous avançâmes, je vis la demeure des rois. Il est plus aisé de se figurer ma comique stupéfaction que de la peindre. A chaque pas, des objets nouveaux attiroient mon attention; j'admirois la richesse des modes, l'éclat de la parure, l'élégance des manières. Tout à coup je me rappelai ce quartier de la veille, et mon étonnement s'accrut; je ne comprenois pas comment il se pouvoit qu'une même enceinte renfermât des objets si différens. L'expérience ne m'avoit pas encore appris que partout les palais cachent des chaumières, que le luxe produit la misère, et que de la grande opulence d'un seul naît toujours l'extrême pauvreté de plusieurs.
Nous employâmes plusieurs semaines à visiter ce que Paris a de plus remarquable. Le baron me montroit une foule de monumens célèbres chez l'étranger, presque ignorés de ceux qui les possèdent. Tant de chefs-d'œuvre m'étonnèrent d'abord, et bientôt ne m'inspirèrent plus qu'une froide admiration. Sait-on bien, à quinze ans, ce que c'est que la gloire des arts et l'immortalité du génie? Il faut des beautés plus animées pour échauffer un jeune cœur.
C'étoit au couvent d'Adélaïde que je devois rencontrer l'objet adorable par qui mon existence alloit commencer. Le baron, qui chérissoit ma sœur, alloit presque tous les jours la demander au parloir. Toutes les demoiselles bien nées savent qu'au couvent on a de bonnes amies; beaucoup de belles dames assurent qu'il est rare d'en trouver ailleurs; quoi qu'il en soit, ma sœur, naturellement sensible, eut bientôt choisi la sienne. Un jour elle nous parla de Mlle Sophie de Pontis, et nous fit de cette jeune personne un éloge que nous crûmes exagéré. Mon père fut curieux de voir la bonne amie de sa fille; je ne sais quel doux pressentiment fit palpiter mon cœur lorsque le baron pria Adélaïde d'aller chercher Mlle de Pontis. Ma sœur y courut, elle amena… Figurez-vous Vénus à quatorze ans! Je voulus avancer, parler, saluer; je restai le regard fixe, la bouche ouverte, les bras pendans. Mon père s'aperçut de mon trouble et s'en amusa. «Du moins vous saluerez», me dit-il. Mon trouble s'augmenta; je fis la révérence la plus gauche. «Mademoiselle, poursuivit le baron, je vous assure que ce jeune homme a eu un maître à danser.» Je fus tout à fait déconcerté. Le baron fit à Sophie un compliment flatteur; elle y répondit modestement et d'une voix altérée qui retentit jusqu'à mon cœur. J'ouvrois de grands yeux étonnés, je prêtois une oreille attentive; ma langue embarrassée demeuroit toujours suspendue. Mon père, avant de sortir, embrassa sa fille, et salua Mlle de Pontis. Moi, dans un transport involontaire, je saluai ma sœur, et j'allois embrasser Sophie. La vieille gouvernante de cette demoiselle, conservant plus de présence d'esprit que moi, m'avertit de ma méprise; le baron me regarda d'un air étonné; le front de Sophie se couvrit d'une aimable rougeur, et pourtant un léger sourire effleura ses lèvres de rose.
Nous revînmes chez M. Duportail: on se mit à table; je mangeai comme un amoureux de quinze ans, c'est-à-dire vite et longtemps. Après dîner je prétextai une indisposition légère, et je me retirai dans mon appartement. Là, je me rappelai librement Sophie et tous ses charmes. «Que de grâces, que de beauté! me disois-je; sa charmante figure est pleine d'esprit, et son esprit, j'en suis sûr, répond à sa figure. Ses grands yeux noirs m'ont inspiré je ne sais quoi…; c'est de l'amour sans doute. Ah! Sophie, c'est de l'amour, et pour la vie!» Revenu de ce premier transport, je me souvins d'avoir vu dans plusieurs romans les effets prodigieux d'une rencontre imprévue; le premier coup d'œil d'une belle avoit suffi pour captiver les sentimens d'un amant tendre; et l'amante elle-même, frappée d'un trait vainqueur, s'étoit sentie entraînée par un penchant irrésistible. Cependant j'avois lu de longues dissertations dans lesquelles des philosophes profonds nioient le pouvoir de la sympathie, qu'ils appeloient une chimère. «Sophie, m'écriai-je, je sens bien que je vous aime; mais avez-vous partagé mon trouble et mes agitations?» L'air dont je m'étois présenté n'étoit pas très propre à m'inspirer beaucoup de confiance; mais sa jolie voix, d'abord altérée, qu'elle avoit eu peine à rassurer par degrés! ce doux sourire par lequel elle avoit paru applaudir à ma méprise et me consoler de ma privation!… L'espérance entra dans mon cœur, il me parut très possible qu'en fait de tendresse la philosophie radotât, et que les romans seuls eussent raison.
Je m'étois approché, par hasard, de ma fenêtre: je vis le baron et M. Duportail se promener à grands pas dans le jardin. Mon père parloit avec feu, son ami sourioit de temps en temps; tous deux, par intervalles, jetoient les jeux sur mes croisées; je jugeai qu'il étoit question de moi dans leur entretien, et que déjà peut-être mon père avoit soupçonné ma passion naissante. Cette idée m'inquiéta beaucoup moins pourtant que celle du départ de mon père que je croyois prochain. Quitter ma Sophie sans savoir quand je pourrois jouir du bonheur de la revoir! mettre plus de cent lieues entre elle et moi! je n'y pus penser sans frémir. Mille réflexions douloureuses m'occupèrent toute la soirée: je soupai tristement, j'ignorois encore les plaisirs de l'amour, et déjà je ressentois ses inquiétudes mortelles.
Une partie de la nuit se passa dans les mêmes agitations. Je m'endormis enfin, dans l'espérance de voir ma Sophie le lendemain. Son image vint embellir mes songes; l'amour, propice à mes vœux, daigna prolonger un si doux sommeil. Il étoit tard quand je m'éveillai: je n'appris pas sans chagrin qu'on m'avoit laissé reposer, parce que mon père étoit sorti dès le matin et ne devoit rentrer que le soir. Je me désolois tout bas de ne pouvoir faire une visite à ma sœur, quand M. Duportail entra; il me fit mille amitiés, et me demanda si j'étois content de la capitale: je l'assurai que je ne craignois rien tant que de la quitter. Il me déclara que je n'aurois pas ce déplaisir; que mon père, jaloux de donner une éducation très soignée à l'unique héritier de son nom et de veiller de très près au bonheur d'une fille qu'il aimoit, avoit résolu de se fixer à Paris pendant quelques années, et que, pour y vivre d'une manière convenable à un homme de sa qualité, il alloit faire sa maison. Cette bonne nouvelle me causa une joie que je ne pus dissimuler; M. Duportail en modéra l'excès en m'apprenant qu'on avoit commencé par me choisir un honnête gouverneur et un fidèle domestique. A l'instant même on annonça M. Person.
Je vis entrer un petit monsieur sec et blême, dont la mine justifioit pleinement la mauvaise humeur que m'avoit inspirée son titre. Il s'avança d'un air grave et composé, puis, d'un ton lent et mielleux, il commença: «Monsieur, votre figure…» Content du mot qu'il avoit dit, il s'arrêta, cherchant le mot qu'il alloit dire…, «votre figure répond de votre personne.» Je répliquai fort sèchement à ce doux compliment. Privé du bonheur de voir Sophie, je ne trouvois d'autres ressources que le plaisir de m'occuper d'elle, et monsieur l'abbé venoit m'enlever cette consolation! Je résolus de le pousser à bout; dès la première journée j'y réussis passablement.
Le soir, mon père daigna me confirmer de sa propre bouche les arrangemens qu'il se proposoit; il me signifia, en même temps, que désormais je ne sortirois plus qu'avec mon gouverneur. C'étoit m'avertir de l'intérêt que j'avois à le ménager: ma situation devenoit critique, et mon amour, irrité par les obstacles, sembloit s'accroître avec ma gêne. J'avois fait d'assez bonnes études; mon gouverneur, présomptueux, s'étoit chargé du pénible emploi de les perfectionner; heureusement j'eus lieu de m'apercevoir, aux premières leçons, que le disciple valoit au moins l'instituteur. «Monsieur l'abbé, lui dis-je, vous êtes capable d'enseigner autant que je suis curieux d'apprendre. Pourquoi nous gêner mutuellement? Croyez-moi, laissons là des livres sur lesquels nous pâlirions gratis; allons voir ma sœur à son couvent, et, si Mlle Sophie de Pontis vient au parloir, vous verrez comme elle est jolie.» L'abbé voulut se fâcher; mais, profitant de l'avantage que j'avois sur lui: «Vous n'aimez pas l'exercice, à ce que je vois, lui répliquai-je: eh bien! restons ici; mais ce soir, je déclare à monsieur le baron l'extrême désir que je me sens d'avancer dans mes études, et l'insuffisance absolue de celui qui s'est chargé de m'éclairer dans mes travaux: si vous niez, je demande un examen que mon père lui-même nous fera subir.» L'abbé fut atterré de la force de mes derniers argumens. Il fit une grimace épouvantable, prit sa petite canne et son humble chapeau; nous volâmes au couvent.
Adélaïde vint au parloir accompagnée seulement de sa gouvernante, qu'on appeloit Manon. Cette fille étoit un vieux domestique de ma mère, et nous avoit élevés; je la priai de nous laisser: elle m'obéit sans peine. Restoit le maudit petit gouverneur, qu'il n'étoit pas possible d'éloigner. Ma sœur se plaignit qu'on eût laissé passer plusieurs jours sans la venir voir; elle m'étonna en m'apprenant que le baron l'avoit négligée autant que moi; nous pensâmes qu'il falloit qu'il fût bien préoccupé de ses projets nouveaux pour avoir oublié sa chère fille. «Mais vous, Faublas, me dit Adélaïde, qui vous a retenu ces jours-ci? Boudez-vous votre sœur et sa bonne amie? vous seriez un ingrat: Mlle de Pontis est sortie; revenez nous voir demain, surtout prenez garde aux méprises, et Sophie tâchera de faire votre paix avec sa vieille gouvernante, qui ne vous a pas encore bien pardonné vos distractions.» Je dis à ma sœur qu'il falloit obtenir mon congé de monsieur l'abbé, que la rage du travail possédoit sans relâche. Adélaïde, croyant que je parlois sérieusement, adressa à mon grave instituteur les plus vives instances, que j'excitois par les miennes. Il soutint le persiflage plus paisiblement que je ne l'aurois cru; je remarquai même que, lorsque je parlai de revenir, il m'observa qu'il étoit encore de bonne heure: cette complaisance me réconcilia tout à fait avec lui.
Mon père m'attendoit chez M. Duportail pour nous conduire dans un hôtel fort beau, qu'il venoit de louer faubourg Saint-Germain. Je fus mis le soir même en possession de l'appartement qu'il m'y avoit marqué. Je trouvai là Jasmin, ce domestique dont on m'avoit parlé. C'étoit un grand garçon de bonne mine, il me plut au premier coup d'œil.
«Boudez-vous votre sœur et sa bonne amie? vous seriez un ingrat», m'avoit dit Adélaïde. Je me répétai cent fois ce reproche, et le commentai de cent manières différentes. Il avoit donc été question de moi, on m'avoit donc attendu, j'avois donc été désiré? Que la nuit me parut longue, que la matinée fut mortelle! quel tourment d'entendre sonner les heures, et de ne pouvoir hâter celle qui nous rapproche de l'objet aimé!
Il arriva enfin le moment si désiré! je vis ma sœur, je vis Sophie, non moins belle et plus jolie que la première fois. Il y avoit dans sa simple parure je ne sais quoi de plus adroit et de plus séduisant. Dans cette seconde visite, mes yeux détaillèrent pour ainsi dire ses charmes, et plus d'une fois nos regards se rencontrèrent pendant cet examen si doux. J'admirai sa longue chevelure noire, qui contrastoit singulièrement avec sa peau fine, d'une blancheur éblouissante; sa taille élégante et légère, que j'aurois embrassée de mes dix doigts; les grâces enchanteresses répandues sur toute sa personne, son pied mignon, dont j'ignorois le favorable augure; et ses yeux surtout, ses beaux yeux qui sembloient me dire: «Ah! que nous aimerons l'heureux mortel qui saura nous plaire!»
Je fis à Mlle de Pontis un compliment qui dut d'autant plus la flatter qu'il étoit aisé de s'apercevoir que je ne l'avois pas préparé. La conversation fut d'abord générale, la gouvernante de Sophie s'en mêla; je vis qu'on ménageoit la vieille, et qu'elle aimoit à causer; je trouvai charmans les sots contes qu'elle nous fit. Cependant Person s'entretenoit avec ma sœur, et moi, d'une voix basse et tremblante, je faisois à ma Sophie cent questions et cent complimens. La vieille continuoit de raconter ses belles histoires que nous n'écoutions plus. Elle s'aperçut enfin qu'en parlant beaucoup elle ne parloit à personne; elle se leva brusquement, et me dit: «Monsieur, vous me faites commencer une narration, et vous n'en écoutez pas la fin, cela est très malhonnête.» Sophie, en me quittant, me consola par un regard tendre.
Nous entendîmes le bruit d'une voiture, c'étoit celle du baron; il entra, Adélaïde se plaignit de la rareté de ses visites; il allégua, d'un ton assez contraint, les embarras d'un établissement nouveau. Il causa quelques minutes d'un air préoccupé, et se leva ensuite brusquement avec quelques signes d'impatience; il retournoit à l'hôtel, il m'y ramena.
Nous trouvâmes à la porte un équipage brillant. Le suisse dit au baron qu'un gros monsieur noir l'attendoit depuis plus d'une heure, et qu'une cholie tame venoit d'arriver à l'instant. Mon père parut aussi joyeux que surpris; il monta avec empressement: je voulus le suivre, il me pria d'entrer chez moi. Jasmin, à qui je demandai s'il connoissoit le gros monsieur noir et la cholie tame, me répondit que non.
Curieux de pénétrer le mystère et piqué de ce que c'en étoit un pour moi, je me mis en sentinelle à l'une des fenêtres de mon appartement, qui donnoit sur la rue. Je n'y restai pas longtemps sans voir sortir un gros homme vêtu de noir, qui parloit seul et paroissoit content. Un quart d'heure après je vis une jeune dame s'élancer légèrement dans sa voiture; le baron, beaucoup moins ingambe, voulut sauter aussi lestement, il pensa se rompre le col; je fus effrayé; mais les éclats de rire qui partoient de la voiture me rassurèrent pleinement. Je m'étonnai que mon père, naturellement colère, ne donnât aucun signe d'humeur; il monta paisiblement, mit la tête à la portière, me vit à ma croisée, et parut un peu confus. Je l'entendis ordonner aux domestiques de m'avertir qu'il sortoit pour affaire, et que je pouvois me dispenser de l'attendre à souper. Je fis part de ma curiosité à Jasmin, qui paroissoit mériter ma confiance; il questionna, sans affectation, les domestiques du baron. Je sus le même soir que mon père fréquentoit les spectacles et lisoit les papiers publics; il venoit de prendre une maîtresse à l'Opéra et un intendant dans les Petites Affiches! j'en conclus qu'il falloit que le baron fût bien riche pour se charger de ce double fardeau. Au reste, cette réflexion ne me toucha que foiblement. J'aimois, j'avois l'espérance de plaire; au printemps de la vie connoît-on d'autres biens?
En peu de temps je rendis à ma sœur des visites fréquentes; Mlle de Pontis l'accompagnoit presque toujours au parloir. La vieille gouvernante ne se fâchoit plus parce que je la laissois finir ses histoires, et d'ailleurs Adélaïde avoit soin de lui faire de petits présens. M. Person n'étoit plus cet instituteur sévère, possédé, comme tant d'autres confrères, de la rage d'enseigner ce qu'il ignoroit. C'étoit, comme tant d'autres aussi, un petit pédant couleur de rose, toujours bien régulièrement coiffé, minutieux dans sa parure, relâché dans sa morale, développant avec les femmes une érudition profonde, affectant avec les hommes de n'effleurer que la superficie. Aussi doux et complaisant qu'il s'étoit d'abord montré intraitable et dur, il paroissoit n'avoir d'autres désirs que de prévenir les miens, et, quand je parlois d'aller au couvent, je le trouvois aussi empressé que moi.
Cependant mon père, livré aux plaisirs bruyans de la capitale, recevoit beaucoup de monde chez lui. Je fus caressé du beau sexe; on me fit des agaceries que je ne compris pas. Certaine douairière surtout essaya sur moi le pouvoir de ses charmes flétris; on se donna des airs enfantins, on épuisa les minauderies fines: je n'entendis seulement pas ce que ce manège signifioit. D'ailleurs je ne voyois dans le monde entier que Sophie; l'amour innocent et pur m'enflammoit pour elle, et j'ignorois encore qu'il existoit un autre amour.
Depuis plus de quatre mois je voyois Sophie presque tous les jours, l'habitude d'être ensemble étoit devenue pour nous un besoin. On sait que l'amour, quand il s'ignore lui-même ou quand il cherche à se déguiser, invente des noms caressans pour suppléer aux noms plus doux qu'il soupçonne et qu'il attend. Sophie m'appeloit son jeune cousin, j'appelois Sophie ma jolie cousine. La tendresse qui nous animoit brilloit dans nos moindres actions, nos regards l'exprimoient; ma bouche n'en avoit point encore hasardé l'aveu; et ma sœur ne devinoit pas ou gardoit le secret de sa bonne amie. Aveuglément livré aux premières impulsions de la nature, j'étois loin de soupçonner son but secret. Content de parler à Sophie, heureux de l'entendre et de baiser quelquefois sa jolie main, je désirois davantage; je n'aurois pu dire ce que je désirois. Le moment approchoit où l'une des plus charmantes femmes de la capitale alloit dissiper les ténèbres qui m'environnoient et m'initier aux plus doux mystères de Vénus.
Nous étions dans cette saison bruyante où règnent à la ville les plaisirs avec la folie; Momus avoit donné le signal de la danse, on touchoit aux jours gras. Le jeune comte de Rosambert, depuis trois mois compagnon de mes exercices, et que mon père combloit d'honnêtetés, me reprochoit depuis quelques jours la vie tranquille et retirée que je menois: devois-je, à mon âge, m'enterrer tout vivant dans la maison de mon père, et borner mes promenades à de sottes visites chez des béguines, pour y voir, qui? ma sœur! N'étoit-il pas temps de sortir de mon enfance, que l'on vouloit prolonger éternellement? et ne devois-je pas me hâter d'entrer dans le monde, où, avec ma figure et mon esprit, je ne pouvois manquer d'être favorablement accueilli? «Tenez, ajouta-t-il, je veux demain vous conduire à un bal charmant où je vais régulièrement quatre fois par semaine, vous y verrez bonne compagnie.» J'hésitois encore. «Il est sage comme une fille! poursuivit le comte; eh mais, craignez-vous que votre honneur ne coure quelque hasard? Habillez-vous en femme, sous des habits qu'on respecte il sera bien à couvert.» Je me mis à rire sans savoir pourquoi. «En vérité, reprit-il, cela vous iroit au mieux! Vous avez une figure douce et fine, un léger duvet couvre à peine vos joues; cela sera délicieux,… et puis… tenez, je veux tourmenter certaine personne… Chevalier, habillez-vous en femme, nous nous amuserons,… cela sera charmant!… vous verrez, vous verrez!»
L'idée de ce travestissement me plut. Il me parut fort agréable d'aller voir Sophie sous les habits de son sexe. Le lendemain, un habile tailleur que le comte de Rosambert avoit fait avertir m'apporta un habit d'amazone complet, tel que le portent les dames angloises quand elles montent à cheval. Un élégant coiffeur me donna le coup de peigne moelleux, et posa sur ma tête virginale le petit chapeau de castor blanc. Je descendis chez mon père; dès qu'il m'aperçut, il vint à moi d'un air d'inquiétude, puis s'arrêtant tout d'un coup: «Bon! dit-il en riant, j'ai d'abord cru que c'étoit Adélaïde!» Je lui observai qu'il me flattoit beaucoup. «Non, je vous ai pris pour Adélaïde, et je cherchois déjà quel motif lui avoit fait quitter son couvent sans ma permission, pour venir ici dans cet étrange équipage. Au reste, gardez-vous d'être fier de ce petit avantage: une jolie figure est dans un homme le plus mince des mérites.» M. Duportail étoit là. «Vous vous moquez, Baron, s'écria-t-il; ne savez-vous pas…?» Mon père le regarda, il se tut.
Ce fut mon père qui le premier témoigna le désir d'aller au couvent, il m'y conduisit. Adélaïde ne me reconnut qu'après quelques momens d'examen. Le baron, enchanté de l'extrême ressemblance qu'il y avoit entre ma sœur et moi, nous accabloit de caresses et nous embrassoit tour à tour. Cependant Adélaïde se repentoit d'être venue seule au parloir. «Que je suis fâchée, dit-elle, de n'avoir point amené ma bonne amie! comme nous aurions joui de sa surprise! Mon cher papa, permettez-vous que je l'aille chercher?» Le baron y consentit. En rentrant, Adélaïde dit à Sophie: «Ma bonne amie, embrassez ma sœur.» Sophie, interdite, m'examinoit, elle s'arrêta confondue. «Embrassez donc mademoiselle», dit la vieille gouvernante, trompée par la métamorphose. «Mademoiselle, embrassez donc ma fille», répéta le baron, que la scène amusoit. Sophie rougit et s'approcha en tremblant; mon cœur palpitoit. Je ne sais quel secret instinct nous conduisit, je ne sais avec quelle adresse nous dérobâmes notre bonheur aux témoins intéressés qui nous observoient; ils crurent que dans cette douce étreinte nos joues seulement s'étoient rencontrées,… mes lèvres avoient pressé les lèvres de Sophie!… Lecteurs sensibles qui vous êtes attendris quelquefois avec l'amante de Saint-Preux[4], jugez quel plaisir nous goûtâmes:… c'étoit aussi le premier baiser de l'amour.
[4] Dans la Nouvelle Héloïse.
A notre retour nous trouvâmes à l'hôtel M. de Rosambert qui m'attendoit. Le baron sut bientôt de quoi il s'agissoit, et me permit, plus aisément que je ne l'aurois cru, de passer la nuit entière au bal. Sa voiture nous y conduisit. «Je vais, me dit le comte, vous présenter à une jeune dame qui m'estime beaucoup; il y a deux grands mois que je lui ai juré une ardeur éternelle, et plus de six semaines que je la lui prouve.» Ce langage étoit pour moi tout à fait énigmatique; mais déjà je commençois à rougir de mon ignorance: je souris d'un air fin, pour faire croire à Rosambert que je le comprenois. «Comme je vais la tourmenter! continua-t-il; ayez l'air de m'aimer beaucoup, vous verrez quelle mine elle fera! Surtout ne vous avisez pas de lui dire que vous n'êtes pas fille… Oh! nous allons la désoler!»
Dès que nous parûmes dans l'assemblée, tous les regards se fixèrent sur moi: j'en fus troublé, je sentis que je rougissois, je perdis toute contenance. Il me vint d'abord dans l'esprit que quelque partie de mon ajustement mal arrangée ou que mon maintien emprunté m'avoient trahi; mais bientôt, à l'empressement général des hommes, au mécontentement universel des femmes, je jugeai que j'étois bien déguisé. Celle-ci me jetoit un regard dédaigneux, celle-là m'examinoit d'un petit air boudeur; on agitoit les éventails, on se parloit tout bas, on sourioit malignement; je vis que je recevois l'accueil dont on honore, dans un cercle nombreux, une rivale trop jolie qu'on y voit pour la première fois.
Une très belle femme entra, c'étoit la maîtresse du comte; il lui présenta sa parente, qui sortoit, disoit-il, du couvent. La dame (elle s'appeloit la marquise de B…) m'accueillit très obligeamment; je pris place auprès d'elle, et les jeunes gens firent un demi-cercle autour de nous. Le comte, bien aise d'exciter la jalousie de sa maîtresse, affectoit de me donner une préférence marquée. La marquise, apparemment piquée de sa coquetterie et bien résolue de l'en punir en lui dissimulant le dépit qu'elle en ressentoit, redoubla pour moi de politesse et d'amitié. «Mademoiselle, avez-vous du goût pour le couvent? me dit-elle.—Je l'aimerois bien, Madame, s'il s'y trouvoit beaucoup de personnes qui vous ressemblassent.» La marquise me témoigna par un sourire combien ce compliment la flattoit; elle me fit plusieurs autres questions, parut enchantée de mes réponses, m'accabla de ces petites caresses que les femmes se prodiguent entre elles, dit à Rosambert qu'il étoit trop heureux d'avoir une telle parente, et finit par me donner un baiser tendre que je lui rendis poliment. Ce n'étoit pas ce que Rosambert vouloit ni ce qu'il s'étoit promis. Désolé de la vivacité de la marquise, et plus encore de la bonne foi avec laquelle je recevois ses caresses, il se pencha à son oreille, et lui découvrit le secret de mon déguisement. «Bon! quelle apparence!» s'écria la marquise, après m'avoir considéré quelques momens. Le comte protesta qu'il avoit dit la vérité. Elle me fixa de nouveau. «Quelle folie! cela ne se peut pas.» Et le comte renouvela ses protestations. «Quelle idée! reprit la marquise en baissant la voix; savez-vous ce qu'il dit? il soutient que vous êtes un jeune homme déguisé!» Je répondis timidement, et bien bas, qu'il disoit la vérité. La marquise me lança un regard tendre, me serra doucement la main, et, feignant de m'avoir mal entendu: «Je le savois bien, dit-elle assez haut, cela n'avoit pas l'ombre de vraisemblance»; puis, s'adressant au comte: «Mais, Monsieur, à quoi cette plaisanterie ressemble-t-elle?—Quoi! reprit celui-ci très étonné, mademoiselle prétend…—Comment, si elle le prétend! mais voyez donc! un enfant si aimable! une aussi jolie personne!—Quoi! dit encore le comte…—Ho! Monsieur, finissez, reprit la marquise avec une humeur très marquée, vous me croyez folle ou vous êtes fou.»
Je crus de bonne foi qu'elle ne m'avoit pas compris, je baissai la voix. «Je vous demande pardon, Madame, je me suis peut-être mal expliqué; je ne suis pas ce que je parois être, le comte vous a dit la vérité.—Je ne vous crois pas plus que lui», répondit-elle en affectant de parler encore plus bas que moi; elle me serra la main. «Je vous assure, Madame…—Taisez-vous, vous êtes une friponne, mais vous ne me ferez pas prendre le change plus que lui»; et elle m'embrassa de nouveau. Rosambert, qui ne nous avoit pas entendus, demeura stupéfait. La jeunesse qui nous environnoit paroissoit attendre avec autant de curiosité que d'impatience la fin et l'explication d'un dialogue aussi obscur pour elle; mais le comte, retenu par la crainte de déplaire à sa maîtresse en se couvrant lui-même de ridicule, se flattant d'ailleurs que je finirois bientôt le quiproquo, se mordoit les lèvres et n'osoit plus dire un seul mot. Heureusement la marquise vit entrer la comtesse de ***, son amie; je ne sais ce qu'elle lui dit à l'oreille, mais aussitôt la comtesse s'attacha à Rosambert et ne le quitta plus.
Cependant le bal étoit commencé, je figurois dans une contredanse, le hasard voulut que la comtesse et Rosambert se trouvassent assis derrière la place que j'occupois. La jeune dame lui disoit: «Non, non, tout cela est inutile, je me suis emparée de vous pour toute la soirée, je ne vous cède à personne. Plus jalouse qu'un sultan, je ne vous laisse parler à qui que ce soit, vous ne danserez pas ou vous danserez avec moi, et, si vous pensez tout ce que vous me dites d'obligeant, je vous défends de dire un mot, un seul mot, à la marquise ni à votre jeune parente.—Ma jeune parente! interrompit le comte, si vous saviez…—Je ne veux rien savoir, je prétends seulement que vous restiez là. Hé! mais, ajouta-t-elle légèrement, j'ai peut-être des projets sur vous, allez-vous faire le cruel?» Je n'en entendis pas davantage, la contredanse finissoit. La marquise ne m'avoit pas perdu de vue un moment; je voulus me reposer, je trouvai une place auprès d'elle; nous commençâmes, reprîmes, quittâmes et reprîmes vingt fois une conversation fort animée, souvent interrompue par ses caresses, et dans laquelle je vis bien qu'il falloit lui laisser une erreur qui paroissoit lui plaire.
Le comte ne cessoit de nous observer avec une inquiétude très marquée; la marquise ne paroissoit pas s'en apercevoir. «Mon intention, me dit-elle enfin, n'est pas de passer ici la nuit entière, et, si vous m'en croyez, vous ménagerez votre santé. Acceptez chez moi une collation légère; il est plus de minuit, M. le marquis ne tardera pas à me venir joindre; nous irons souper chez moi, ensuite je vous reconduirai moi-même chez vous. Au reste, ajouta-t-elle d'un air négligé, c'est un singulier homme que M. de B… Il lui prend de temps en temps des caprices de tendresse pour moi, il a des accès de jalousie fort ridicules, des airs d'attention dont je le dispenserois volontiers; quant à la fidélité qu'il me jure, je n'y crois pas plus que je ne m'en soucie, cependant je ne serois pas fâchée de la mettre à l'épreuve: il va vous voir, il vous trouvera charmante. Vous ne recommencerez pas alors ce petit conte de votre déguisement: c'est une jolie plaisanterie, mais nous l'avons épuisée; aussi, loin de la répéter devant M. de B…, vous voudrez bien, s'il ne vous répugne pas de m'obliger un peu, vous voudrez bien lui faire quelques avances.» Je demandai à la marquise ce que c'étoit que des avances. Elle rit de bon cœur de l'ingénuité de ma question, et puis, me regardant d'un air attendri: «Écoutez, me dit-elle, vous êtes femme, cela est clair, ainsi toutes les caresses que je vous ai faites ce soir ne sont que des amitiés; mais, si vous étiez effectivement un jeune homme déguisé, et que, le croyant, je vous eusse traité de la même manière, cela s'appelleroit des avances, et des avances très fortes.» Je lui promis de faire des avances au marquis. «Fort bien, souriez à ses propos, regardez-le d'un certain air; mais ne vous avisez pas de lui serrer la main comme je vous fais, et de l'embrasser comme je vous embrasse; cela ne seroit ni décent ni vraisemblable.»
Nous en étions là quand le marquis arriva. Il me parut jeune encore; il étoit assez bien fait, mais d'une taille fort petite, et ses manières ressembloient à sa taille; sa figure avoit de la gaieté, mais de cette gaieté qui fait qu'on rit toujours aux dépens de celui qui l'inspire. «Voici Mlle Duportail, lui dit la marquise (je m'étois donné ce nom), c'est une jeune parente du comte, vous me remercierez de vous l'avoir fait connoître, elle veut bien venir souper avec nous.» Le marquis trouva que j'avois la physionomie heureuse, il me prodigua des éloges ridicules, je l'en remerciai par des complimens outrés. «Je suis très content, me dit-il d'un air pesant qu'il croyoit fin, que vous me fassiez l'honneur de souper chez moi, Mademoiselle; vous êtes jolie, très jolie, et ce que je vous dis là est certain, car je me connois en physionomie.» Je répondis par le plus agréable sourire. «Ma chère enfant, me disoit la marquise de l'autre côté, j'ai engagé votre parole, vous êtes trop polie pour me dédire; au reste, je vous débarrasserai du marquis dès qu'il vous ennuiera.» Elle me serra la main; le marquis la vit. «Ho! que je voudrois, dit-il, tenir une de ces petites mains-là dans les miennes!» Je lui lançai une œillade meurtrière. «Partons, Mesdames, partons», s'écria-t-il d'un air léger et conquérant. Il sortit pour appeler ses gens.
Le comte, qui l'entendit, vint à nous, quelques efforts que la comtesse eût faits pour le retenir. Il me dit d'un ton sérieusement ironique: «Monsieur se trouve sans doute fort bien sous ses habits galans, il ne compte pas apparemment désabuser la marquise?» Je répondis sur le même ton, mais en baissant la voix: «Mon cher parent, voudriez-vous sitôt détruire votre ouvrage?» Il s'adressa à la marquise: «Madame, je me crois en conscience obligé de vous avertir encore une fois que ce n'est point Mlle Duportail qui aura le bonheur de souper chez vous, mais bien le chevalier de Faublas, mon très jeune et très fidèle ami.—Et moi, Monsieur, lui répondit-on, je vous déclare que vous avez trop compté sur ma patience ou sur ma crédulité. Ayez la bonté de cesser cet impertinent badinage, ou décidez-vous à ne me revoir jamais.—Je me sens le courage de prendre l'un et l'autre parti, Madame; je serois désolé de troubler vos plaisirs par mes indiscrétions, ou de les gêner par mes importunités.»
Le marquis rentroit au moment même; il frappa sur l'épaule de Rosambert, et, le retenant par le bras: «Quoi! tu ne soupes pas avec nous? tu nous laisses ta parente? Sais-tu qu'elle est jolie ta parente? sais-tu que sa physionomie promet?» Il baissa la voix: «Mais entre nous je crois la petite personne un peu… vive.—Ho! oui, très jolie et très vive, reprit le comte avec un sourire amer, elle ressemble à bien d'autres»; et puis, comme s'il eût pressenti le sort prochain de ce bon mari: «Je vous souhaite une bonne nuit, lui dit-il.—Quoi! penses-tu, reprit le marquis, que je garde ta parente pour… Écoute donc, si elle le vouloit bien!…—Je vous souhaite une bonne nuit», répéta le comte, et il sortit en éclatant de rire. La marquise soutint que M. de Rosambert devenoit fou, je trouvai qu'il étoit fort malhonnête. «Point du tout, me dit confidemment le marquis, il vous aime à la rage, il a vu que je vous faisois ma cour, il est jaloux.»
En cinq minutes nous fûmes à l'hôtel du marquis; on servit aussitôt: je fus placé entre la marquise et son galant époux qui ne cessoit de me dire ce qu'il croyoit de très jolies choses. Trop occupé d'abord à satisfaire l'appétit tout à fait mâle que la danse m'avoit donné, je n'employai pour lui répondre que le langage des yeux. Dès que ma faim fut un peu calmée, j'applaudis sans ménagement à toutes les sottises qu'il lui plut de me débiter, et ses mauvais bons mots lui valurent mille complimens dont il fut enchanté. La marquise, qui m'avoit toujours considéré avec la plus grande attention, et dont les regards s'animoient visiblement, s'empara d'une de mes mains: curieux de voir jusqu'où s'étendroit le pouvoir de mes charmes trompeurs, j'abandonnai l'autre au marquis. Il la saisit avec un transport inexprimable. La marquise, plongée dans des réflexions profondes, sembloit méditer quelque projet important; je la voyois successivement rougir et trembler, et, sans dire un seul mot, elle pressoit légèrement ma main droite engagée dans les siennes. Ma main gauche étoit dans une prison moins douce; le marquis la serroit de manière à me faire crier. Charmé de sa bonne fortune, tout fier de son bonheur, tout étonné de l'adresse avec laquelle il trompoit sa femme en sa présence même, il poussoit de temps en temps de longs soupirs dont j'étois étourdi, et des éclats de rire dont le plafond retentissoit; ensuite, craignant de se trahir, cherchant à étouffer ce rire éclatant que la marquise auroit pu remarquer, peut-être aussi croyant me faire une gentillesse, il me mordoit les doigts.
La belle marquise sortit enfin de sa rêverie pour me dire: «Mademoiselle Duportail, il est tard, vous deviez passer la nuit entière au bal, on ne vous attend pas chez vous avant huit ou neuf heures du matin, restez chez moi; j'offrirois à toute autre un appartement d'amie, vous pouvez disposer du mien; je dois, ajouta-t-elle d'un ton caressant, vous servir aujourd'hui de maman, je ne veux pas que ma fille ait une autre chambre que la mienne, je vais lui faire dresser un lit près du mien…—Et pourquoi donc faire dresser un lit? interrompit le marquis; on est fort bien deux dans le vôtre; quand je vais vous y trouver, moi, est-ce que je vous gêne? j'y dors tout d'un somme, et vous aussi.» Et, finissant, il me donna amoureusement par-dessous la table un grand coup de genou qui me froissa la peau: je répondis à cette galanterie sur-le-champ de la même manière, et si vigoureusement qu'il lui échappa un grand cri. La marquise se leva d'un air alarmé. «Ce n'est rien, lui dit-il, ma jambe a accroché la table.» J'étouffois de rire, la marquise n'y tint pas plus que moi, et son cher époux, sans savoir pourquoi, se mit à rire plus fort que nous deux.
Quand notre excessive gaieté fut un peu modérée, la marquise me renouvela ses offres. «Acceptez la moitié du lit de madame, crioit le marquis, acceptez, je vous le dis, vous y serez bien, vous verrez que vous y serez bien. Je vais revenir tout à l'heure; mais acceptez.» Il nous quitta. «Madame, dis-je à la marquise, votre invitation m'honore autant qu'elle me flatte; mais est-ce à Mlle Duportail ou à M. de Faublas que vous la faites?—Encore cette mauvaise plaisanterie du comte, petite friponne! et c'est vous qui la répétez! Ne vous ai-je pas dit que je ne vous croyois pas?—Mais, Madame…—Paix, paix! reprit-elle en posant son doigt sur ma bouche; le marquis va rentrer, qu'il ne vous entende pas dire de pareilles folies. Cette charmante enfant! (elle m'embrassa tendrement) comme elle est timide et modeste! mais comme elle est maligne! Allons, petite espiègle, venez»: elle me tendit la main, nous passâmes dans son appartement.
Il étoit question de me mettre au lit. Les femmes de la marquise voulurent me prêter leur ministère; je les priai, en tremblant, d'offrir à leur maîtresse leurs services, dont je saurois bien me passer. «Oui, dit la marquise attentive à tous mes mouvemens, ne la gênez pas, c'est un enfantillage de couvent; laissez-la faire.» Je passai promptement derrière les rideaux; mais je me trouvai dans un grand embarras quand il fallut me dépouiller de ces habits dont l'usage m'étoit si peu familier. Je cassois les cordons, j'arrachois les épingles; je me piquois d'un côté, je me déchirois de l'autre; plus je me hâtois, et moins j'allois vite. Une femme de chambre passa près de moi au moment où je venois d'ôter mon dernier jupon. Je tremblai qu'elle n'entr'ouvrît les rideaux; je me précipitai dans le lit, émerveillé de la singulière aventure qui m'avoit conduit là, mais ne soupçonnant pas encore qu'on pût avoir, en couchant deux, d'autre désir que de causer ensemble avant de s'endormir. La marquise ne tarda pas à me suivre; la voix de son mari se fit entendre: «Ces dames me permettront bien d'assister à leur coucher? Quoi! déjà au lit!» Il voulut m'embrasser, la marquise se fâcha sérieusement; il ferma lui-même les rideaux, et, nous rendant le souhait que lui avoit fait le comte, il nous cria de la porte: «Une bonne nuit!»
Un silence profond régna quelques instans. «Dormez-vous déjà, belle enfant? me dit la marquise d'une voix altérée.—Ho! non, je ne dors pas!» Elle se précipita dans mes bras, et me pressa contre son sein. «Dieux! s'écria-t-elle avec une surprise bien naturellement jouée si elle étoit feinte, c'est un homme!» et puis, me repoussant avec promptitude: «Quoi! Monsieur, il est possible?…—Madame, je vous l'ai dit, répliquai-je en tremblant.—Vous me l'avez dit, Monsieur; mais cela étoit-il croyable? Il s'agissoit bien de dire! il ne falloit pas rester chez moi…, ou du moins il ne falloit pas empêcher qu'on vous dressât un autre lit…—Madame, ce n'est pas moi! c'est monsieur le marquis.—Mais, Monsieur, parlez donc plus bas… Monsieur, il ne falloit pas rester chez moi, il falloit vous en aller.—Hé bien, Madame, je m'en vais…» Elle me retient par le bras: «Vous vous en allez! où cela, Monsieur, et quoi faire? réveiller mes femmes, risquer un esclandre…, peut-être montrer à tous mes gens qu'un homme est entré dans mon lit; qu'on me manque à ce point?—Madame, je vous demande pardon, ne vous fâchez pas, je m'en vais me jeter dans un fauteuil.—Oui, dans un fauteuil! oui… sans doute, il le faut!… Mais voyez la belle ressource (en me retenant toujours par le bras). Fatigué comme il est! par le froid qu'il fait! s'enrhumer, détruire sa santé!… Vous mériteriez que je vous traitasse avec cette rigueur… Allons, restez là; mais promettez-moi d'être sage.—Pourvu que vous me pardonniez, Madame.—Non, je ne vous pardonne pas! mais j'ai plus d'attention pour vous que vous n'en avez pour moi. Voyez comme sa main est déjà froide!» et par pitié elle la posa sur son col d'ivoire. Guidé par la nature et par l'amour, cette heureuse main descendit un peu; je ne savois quelle agitation faisoit bouillonner mon sang. «Aucune femme éprouva-t-elle jamais l'embarras où il me met? reprit la marquise d'un ton plus doux.—Ah! pardonnez-moi donc, ma chère maman…—Oui, votre chère maman! vous avez bien des égards pour votre maman, petit libertin que vous êtes!» Ses bras, qui m'avoient repoussé d'abord, m'attiroient doucement. Bientôt nous nous trouvâmes si près l'un de l'autre que nos lèvres se rencontrèrent; j'eus la hardiesse d'imprimer sur les siennes un baiser brûlant. «Faublas, est-ce là ce que vous m'avez promis?» me dit-elle d'une voix presque éteinte. Sa main s'égara, un feu dévorant circuloit dans mes veines… «Ah! Madame, pardonnez-moi, je me meurs!—Ah! mon cher Faublas,… mon ami!…» Je restois sans mouvement. La marquise eut pitié de mon embarras qui ne pouvoit lui déplaire,… elle aida ma timide inexpérience… Je reçus, avec autant d'étonnement que de plaisir, une charmante leçon que je répétai plus d'une fois.
Nous employâmes plusieurs heures dans ce doux exercice; je commençois à m'endormir sur le sein de ma belle maîtresse, quand j'entendis le bruit d'une porte qui s'ouvroit doucement: on entroit, on s'avançoit sur la pointe du pied; j'étois sans armes dans une maison que je ne connoissois point; je ne pus me défendre d'un mouvement d'effroi. La marquise, qui devina ce que c'étoit, me dit tout bas de prendre sa place et de lui céder la mienne; j'obéis promptement: à peine m'étois-je tapi sur le bord du lit qu'on entr'ouvrit les rideaux du côté que je venois de quitter. «Qui vient me réveiller ainsi?» dit la marquise. On hésita quelques instans, ensuite on s'expliqua sans lui répondre. «Et quelle est cette fantaisie? continua-t-elle. Quoi! Monsieur, vous choisissez aussi mal votre temps, sans attention pour moi, sans respect pour l'innocence d'une jeune personne qui, peut-être, ne dort pas, ou qui pourroit se réveiller? Vous n'êtes guère raisonnable, je vous prie de vous retirer.» Le marquis insistoit, en balbutiant à sa femme de comiques excuses. «Non, Monsieur, lui dit-elle, je ne le veux point, cela ne sera point, je vous assure que cela ne sera point, je vous supplie de vous retirer.» Elle se jeta hors du lit, le prit par le bras et le mit à la porte.
Ma belle maîtresse revint à moi en riant. «Ne trouvez-vous pas mon procédé bien noble? me dit-elle; voyez ce que j'ai refusé à cause de vous.» Je sentis que je lui devois un dédommagement, je l'offris avec ardeur, on l'accepta avec reconnoissance; une femme de vingt-cinq ans est si complaisante quand elle aime! la nature a tant de ressources dans un novice de seize ans!
Cependant tout est borné chez les foibles humains: je ne tardai pas à m'endormir profondément. Quand je me réveillai, le jour pénétroit dans l'appartement malgré les rideaux; je songeai à mon père… Hélas! je me souvins de ma Sophie! une larme s'échappa de mes yeux, la marquise s'en aperçut. Déjà capable de quelque dissimulation, j'attribuai au chagrin de la quitter la pénible agitation que j'éprouvois; elle m'embrassa tendrement. Je la vis si belle! l'occasion étoit si pressante!… Quelques heures de sommeil avoient ranimé mes forces,… l'ivresse du plaisir dissipa les remords de l'amour.
Il fallut enfin songer à nous séparer. La marquise me servit de femme de chambre. Elle étoit si adroite que ma toilette eût été bientôt faite si nous avions pu sauver les distractions! Quand nous crûmes qu'il ne manquoit plus rien à mon ajustement, la marquise sonna ses femmes. Le marquis attendoit depuis plus d'une heure qu'il fît jour chez madame. Il me complimenta sur ma diligence. «Je suis sûr, me dit-il, que vous avez passé une excellente nuit»; et, sans me donner le temps de répondre: «Elle paroît fatiguée pourtant! elle a les yeux battus! Voilà ce que c'est que cette danse! on s'en donne par-dessus les yeux, et le lendemain on n'en peut plus! je le dis tous les jours à la marquise qui n'en tient compte: allons, il faut réparer les forces de cette charmante enfant, après cela nous la reconduirons chez elle.»
Ce nous la reconduirons étoit très propre à m'inquiéter. Je témoignai au marquis qu'il suffiroit que la marquise prît cette peine; il insista. La marquise se joignit à moi pour lui faire perdre cette idée; il nous répondit que M. Duportail ne pouvoit trouver mauvais qu'il lui ramenât sa fille, puisque la marquise seroit avec nous, et qu'il étoit curieux de connoître l'heureux père d'une aussi aimable enfant. Quelques efforts que nous fissions, nous ne pûmes l'empêcher de nous accompagner.
Je commençois à craindre que cette aventure, qui avoit eu de si heureux commencemens, ne finît fort mal. Je ne vis rien de mieux à faire que de donner au cocher du marquis la véritable adresse de M. Duportail. «Chez M. Duportail, près de l'Arsenal», lui dis-je. La marquise sentoit mon embarras et le partageoit; aucun expédient ne s'étoit encore présenté à mon esprit, quand nous arrivâmes à la porte de mon prétendu père.
Il étoit chez lui; on lui dit que le marquis et la marquise de B… lui ramenoient sa fille. «Ma fille! s'écria-t-il avec la plus vive agitation; ma fille!» Il accourut vers nous. Sans lui donner le temps de dire un seul mot, je me jetai à son col. «Oui! lui dis-je, vous êtes veuf, et vous avez une fille.—Parlez plus bas encore, reprit-il avec vivacité, parlez plus bas, qui vous l'a dit?—Eh! mon Dieu! ne m'entendez-vous pas? C'est moi qui suis votre fille. Gardez-vous de dire non devant le marquis.» M. Duportail, plus tranquille, mais non moins étonné, sembloit attendre qu'on s'expliquât. «Monsieur, lui dit la marquise, Mlle Duportail a passé une partie de la nuit au bal, et l'autre partie chez moi.—Êtes-vous fâché, Monsieur, lui dit le marquis qui remarquoit son étonnement, que mademoiselle ait passé une partie de la nuit chez moi? Vous auriez tort, car elle a couché dans l'appartement de madame, dans son lit même, avec elle, on ne pouvoit la mettre mieux. Êtes-vous fâché que je l'aie accompagnée jusqu'ici? J'avoue que ces dames ne le vouloient pas, c'est moi…—Je suis très sensible, répondit enfin M. Duportail, tout à fait revenu de sa première surprise, et d'ailleurs bien instruit par les discours du marquis; je suis très sensible aux bontés que vous avez eues pour ma fille; mais je dois vous déclarer devant elle (il me regarda, je tremblois) que je suis fort étonné qu'elle ait été au bal déguisée de cette façon-là.—Comment! déguisée, Monsieur! interrompit la marquise.—Oui, Madame, un habit d'amazone; cela convient-il à ma fille? ou du moins ne devoit-elle pas me demander mon avis ou ma permission?»
Ravi de l'ingénieuse tournure que mon nouveau père avoit prise, j'affectai de paroître humilié. «Ah! je croyois que le papa le savoit, dit le marquis; Monsieur, il faut pardonner cette petite faute. Mademoiselle votre fille a la physionomie la plus heureuse; je vous le dis, et je m'y connois! Mademoiselle votre fille…, c'est une charmante personne, elle a enchanté tout le monde, ma femme surtout; oh! tenez, ma femme en est folle.—Il est vrai, Monsieur, dit la marquise avec un sang-froid admirable, que mademoiselle m'a inspiré toute l'amitié qu'elle mérite.» Je me croyois sauvé, lorsque mon véritable père, le baron de Faublas, qui ne se faisoit jamais annoncer chez son ami, entra tout à coup. «Ah! ah! dit-il en m'apercevant…» M. Duportail courut à lui les bras ouverts: «Mon cher Faublas, vous voyez ma fille, que M. le marquis et Mme la marquise de B… me ramènent.—Votre fille? interrompit mon père.—Hé! oui, ma fille! vous ne la reconnoissez pas sous cet habit ridicule? Mademoiselle, ajouta-t-il avec colère, passez dans votre appartement, et que personne ne vous surprenne plus dans cet équipage indécent.»
Je fis, sans dire mot, une révérence à M. de B…, qui paroissoit me plaindre, et une à la marquise, qui me voyoit à peine: car, au nom de mon père, elle avoit été si troublée que je craignois qu'elle ne se trouvât mal. Je me retirai dans la pièce voisine, et je prêtai l'oreille. «Votre fille? répéta encore le baron.—Eh! oui, ma fille! qui s'est avisée d'aller au bal avec les habits que vous lui avez vus. Monsieur le marquis vous dira le reste.» Et effectivement, monsieur le marquis répéta à mon père tout ce qu'il avoit dit à M. Duportail; il lui affirma que j'avois couché dans l'appartement de sa femme, dans son lit même, avec elle. «Elle est fort heureuse, dit mon père en regardant la marquise… Fort heureuse, répéta-t-il, qu'une si grande imprudence n'ait pas eu des suites fâcheuses.—Eh! quelle si grande imprudence a donc commise cette chère enfant? répliqua la marquise, que j'avois vue déconcertée, mais dont les forces s'étoient ranimées promptement. Quoi! parce qu'elle a pris un habit d'amazone?—Sans doute, interrompit le marquis, ce n'est qu'une vétille; et vous, Monsieur (en s'adressant à mon père d'un ton fâché), permettez-moi de vous dire qu'au lieu de vous permettre sur le compte de la jeune personne des réflexions qui peuvent lui nuire, vous feriez bien mieux de vous joindre à nous pour obtenir que son père lui pardonne.—Madame, dit M. Duportail à la marquise, je le lui pardonne à cause de vous (en s'adressant au marquis), mais à condition qu'elle n'y retournera plus.—En habit d'amazone soit, répondit celui-ci, mais j'espère que vous nous la renverrez avec ses habits ordinaires; nous serions trop privés de ne plus voir cette charmante enfant.—Assurément, dit la marquise en se levant, et, si monsieur son père veut nous rendre un véritable service, il l'accompagnera.»
M. Duportail reconduisit la marquise jusqu'à sa voiture, en lui prodiguant les remercîmens qu'il étoit présumé lui devoir.
Leur départ me soulagea d'un pesant fardeau. «Voilà une bien singulière aventure! dit M. Duportail en rentrant.—Très singulière, répondit mon père; la marquise est une fort belle femme, le petit drôle est bien heureux.—Savez-vous, répliqua son ami, qu'il a presque pénétré mon secret? Quand on m'a annoncé ma fille, j'ai cru que ma fille m'étoit rendue, et quelques mots échappés m'ont trahi.—Eh bien! il y a un remède à cela; Faublas est plus raisonnable qu'on ne l'est ordinairement à son âge; pour qu'il fût prodigieusement avancé, il ne lui manquoit que quelques lumières qu'il a sans doute acquises cette nuit: il a l'âme noble et le cœur excellent; un secret qu'on devine ne nous lie pas, comme vous savez; mais un honnête homme se croiroit déshonoré s'il trahissoit celui qu'un ami lui a confié; apprenez le vôtre à mon fils; point de demi-confidence, je vous réponds de sa discrétion.—Mais des secrets de cette importance!… il est si jeune!…—Si jeune! mon ami, un gentilhomme l'est-il jamais, quand il s'agit de l'honneur? Mon fils, déjà dans son adolescence, ignoreroit un des devoirs les plus sacrés de l'homme qui pense! un enfant que j'ai élevé auroit besoin de l'expérience de son père pour ne pas faire une bassesse!…—Mon ami, je me rends.—Mon cher Duportail, croyez que vous ne vous en repentirez jamais. J'espère d'ailleurs que cette confidence, devenue presque nécessaire, ne sera pas tout à fait inutile. Vous savez que j'ai fait quelques sacrifices pour donner à mon fils une éducation convenable à sa naissance et proportionnée aux espérances qu'il me fait concevoir: qu'il reste encore un an dans cette capitale pour s'y perfectionner dans ses exercices, cela suffit, je crois; ensuite il voyagera, et je ne serois pas fâché qu'il s'arrêtât quelques mois en Pologne.—Baron, interrompit M. Duportail, le détour dont votre amitié se sert est aussi ingénieux que délicat; je sens toute l'honnêteté de votre proposition, qui m'est très agréable, je vous l'avoue.—Ainsi, reprit le baron, vous voudriez bien donner à Faublas une lettre pour le bon serviteur qui vous reste dans ce pays-là; Boleslas et mon fils feront de nouvelles recherches. Mon cher Lovzinski, ne désespérez pas encore de votre fortune; si votre fille existe, il n'est pas impossible qu'elle vous soit rendue. Si le roi de Pologne…» Mon père parla plus bas, et tira son ami à l'autre bout de l'appartement: ils y causèrent plus d'une demi-heure, après quoi, tous deux s'étant rapprochés de la porte contre laquelle j'étois placé, j'entendis le baron qui disoit: «Je ne veux pas lui demander les détails de son aventure; probablement ils sont assez plaisans: je ne les entendrois pas avec l'air de sévérité qui conviendroit; sans doute il vous contera de point en point son histoire, vous m'en ferez part: au reste, je crois que nous venons de voir un sot mari.—Il n'est pas le seul, mon ami, répondit M. Duportail.—On le sait bien, répliqua le baron; mais il n'en faut rien dire.»
Je les entendis s'approcher de ma porte, j'allai me jeter dans un fauteuil. Le baron me dit en entrant: «Ma voiture est là, faites-vous reconduire à l'hôtel, allez vous reposer, et désormais je vous défends de sortir avec cet habit.—Mon ami, me dit M. Duportail, qui me suivit jusqu'à la porte, un de ces jours nous dînerons ensemble tête-à-tête; vous savez une partie de mon secret, je vous apprendrai le reste; mais surtout de la discrétion. Songez, d'ailleurs, que je vous ai rendu service.» Je l'assurai que je ne l'oublierois pas et qu'il pouvoit être tranquille. Dès que je fus rentré chez moi, je me mis au lit et m'endormis profondément.
Il étoit fort tard quand je me réveillai: M. Person et moi nous fûmes au couvent. Avec quelle douce émotion je revis ma Sophie! Sa contenance modeste, son innocence ingénue, l'accueil timide et caressant qu'elle me fit, un petit air d'embarras que lui donnoit encore le souvenir du baiser de la veille, tout en elle inspiroit l'amour, mais l'amour tendre et respectueux. Cependant l'image des charmes de la marquise me poursuivoit jusqu'au parloir; mais que d'avantages précieux sa jeune rivale avoit sur elle! Il est vrai que les plaisirs de la nuit dernière se représentoient vivement à mon imagination échauffée; mais combien je leur préférois ce moment délicieux où j'avois trouvé, sur les lèvres de Sophie, une âme nouvelle! La marquise régnoit sur mes sens étonnés; mon cœur adoroit Sophie.
Le lendemain, je me souvins que la marquise m'attendoit chez elle; je me souvins aussi que le baron m'avoit dit: «Je vous défends de sortir avec cet habit.» D'ailleurs, comment me présenter chez la marquise sans être au moins accompagné d'une femme de chambre? Il ne falloit pas songer au comte, qui sans doute n'étoit pas tenté de m'y conduire; et le marquis ne trouveroit-il pas singulier qu'une jeune personne sortît toute seule? Impatient de revoir ma belle maîtresse, mais retenu par la crainte de déplaire à mon père, je ne savois à quoi me résoudre. Jasmin vint me dire qu'une femme d'un certain âge, envoyée par Mlle Justine, demandoit à me parler. «Je ne sais quelle est cette demoiselle Justine; mais faites entrer.—Mlle Justine m'a chargée de vous présenter ses respects, me dit la femme, et de vous remettre ce paquet et cette lettre.» Avant d'ouvrir le paquet, je pris la lettre, dont l'adresse étoit simplement: A Mademoiselle Duportail. J'ouvris avec empressement, et je lus:
Donnez-moi de vos nouvelles, ma chère enfant; avez-vous passé une bonne nuit? Vous aviez besoin de repos; je crains fort que les fatigues du bal et la scène désagréable que monsieur votre père vous a faite n'aient altéré votre santé. Je suis désolée que vous ayez été grondée à cause de moi; croyez que cette scène trop longue m'a fait souffrir autant que vous. Monsieur le marquis parle de retourner au bal ce soir, je ne m'y sens pas disposée, et je crois que vous n'en avez pas plus d'envie que moi. Cependant, comme il faut qu'une maman ait de la complaisance pour sa fille, surtout quand elle en a une aussi aimable que vous, nous irons au bal si vous le voulez. Je n'ai point oublié que l'habit d'amazone vous est interdit, et j'ai pensé que peut-être vous n'aviez point d'autre habit de bal, parce que ce n'est point un meuble de couvent, c'est pour cela que je vous envoie l'un des miens: nous sommes à peu près de la même taille, je crois qu'il vous ira bien.
Justine m'a dit que vous aviez besoin d'une femme de chambre, celle qui vous remettra ma lettre est sage, intelligente et adroite: vous pouvez la prendre à votre service, et lui donner toute votre confiance, je vous réponds d'elle.
Je ne vous invite point à dîner avec moi, je sais que M. Duportail dîne rarement sans sa fille; mais, si vous aimez votre chère maman autant qu'elle vous aime, vous viendrez dans la soirée, le plus tôt que vous pourrez. Monsieur le marquis ne dîne point chez lui; venez de bonne heure, mon enfant, je serai seule toute l'après-dînée, vous me ferez compagnie. Croyez que personne ne vous aime autant que votre chère maman.
La Marquise de B…
P. S. Je n'ai point la force de vous mander toutes les folies que le marquis veut que je vous écrive de sa part. Au reste, grondez-le bien quand vous le verrez, il vouloit ce matin envoyer en son nom chez M. Duportail. J'ai eu toutes les peines du monde à lui faire comprendre que cela n'étoit pas raisonnable, et qu'il étoit plus décent que ce fût moi qui vous écrivisse.
Je fus enchanté de cette lettre. «Monsieur, me dit la femme intelligente qui me l'apportoit, Justine est la femme de chambre de madame la marquise de B…, et, si mademoiselle le veut bien, je serai la sienne aujourd'hui et demain. Au reste, monsieur ou mademoiselle peut également se fier à moi; quand Mlle Justine et Mme Dutour se mêlent d'une intrigue, elles ne la gâtent pas; c'est pour cela qu'on m'a choisie.—Fort bien, lui dis-je, Madame Dutour, je vois que vous êtes instruite, vous m'accompagnerez tantôt chez la marquise.» J'offris à ma duègne un double louis qu'elle accepta. «Ce n'est pas qu'on ne m'ait déjà bien payée, me dit-elle; mais monsieur doit savoir que les gens de ma profession reçoivent toujours des deux côtés.»
Dès que le baron eut dîné, il partit pour l'Opéra, suivant sa coutume. Mon coiffeur étoit averti: un panache blanc fut mis à la place du petit chapeau. Mme Dutour me revêtit parfaitement du charmant habit de bal que Mme de B… m'envoyoit, et qui m'alloit merveilleusement bien; ma ressemblance avec Adélaïde devenoit plus frappante; mon gouverneur ému redoubloit pour moi d'attentions et de soins. Je pris des gants, un éventail, un gros bouquet; je volai au rendez-vous que la marquise m'avoit donné.
Je la trouvai dans son boudoir, mollement couchée sur une ottomane: un déshabillé galant paroit ses charmes au lieu de les cacher. Elle se leva dès qu'elle m'aperçut. «Qu'elle est jolie dans cet équipage, Mlle Duportail! que cette robe lui sied bien!» et, dès que la porte se fut fermée: «Que vous êtes charmant, mon cher Faublas! que votre exactitude me flatte! Mon cœur me disoit bien que vous trouveriez le moyen de me venir joindre ici malgré vos deux pères.» Je ne lui répondis que par mes vives caresses; et, la forçant de reprendre l'attitude qu'elle avoit quittée pour me recevoir, je lui prouvois déjà que ses leçons n'étoient pas oubliées, lorsque nous entendîmes du bruit dans la pièce voisine. Tremblant d'être surpris dans une situation qui n'étoit pas équivoque, je me relevai brusquement, et, grâce à mes habits très commodes, je n'eus besoin que de changer de posture pour que mon désordre fût réparé. La marquise, sans paroître troublée, ne rétablit que ce qui pressoit le plus: tout cela fut l'affaire d'un moment. La porte s'ouvrit; c'étoit le marquis. «Je comprenois bien, lui dit-elle, Monsieur, qu'il n'y avoit que vous qui puissiez entrer ainsi chez moi sans vous faire annoncer; mais je croyois qu'au moins vous frapperiez à cette porte avant de l'ouvrir: cette chère enfant avoit des inquiétudes secrètes à confier à sa maman; un moment plus tôt vous la surpreniez!… On n'entre pas ainsi chez des femmes!—Bon! reprit le marquis, je la surprenois! Eh bien! je ne l'ai point surprise, ainsi il n'y a pas tant de mal à tout cela; d'ailleurs, je suis bien sûr que cette chère enfant me le pardonne: elle est plus indulgente que vous; mais convenez que son père a bien raison de ne pas vouloir qu'elle porte cet habit d'amazone, elle est à croquer comme la voilà!»
Il reprit avec moi ce mauvais ton de galanterie qui nous avoit déjà tant amusés; il trouva que j'étois parfaitement bien remise, que j'avois les yeux brillans, le teint fort animé, et même quelque chose d'extraordinaire et d'un très bon augure dans la physionomie. Ensuite il nous dit: «Belles dames, vous allez au bal aujourd'hui?» La marquise répondit que non. «Vous vous moquez de moi, je suis revenu tout exprès pour vous y conduire.—Je vous assure que je n'irai pas.—Hé! pourquoi donc? ce matin vous disiez…—Je disois que j'y pourrois aller par complaisance pour Mlle Duportail; mais elle ne s'en soucie pas; elle craint de retrouver là le comte de Rosambert, qui s'est fort mal comporté la dernière fois.» J'interrompis la marquise. «Certainement son procédé avec moi est assez malhonnête pour que désormais je craigne de le rencontrer autant que je me plaisois autrefois à me trouver avec lui.—Vous avez raison, me dit le marquis: le comte est un de ces petits merveilleux qui croient qu'une femme n'a des yeux que pour eux; il est bon que ces messieurs apprennent quelquefois qu'il y a dans le monde des gens qui les valent bien…» Je compris son idée, et, pour justifier ses propos, je lui lançai à la dérobée un coup d'œil expressif… «Et qui valent peut-être mieux», ajouta-t-il aussitôt en renforçant sa voix, en s'élevant sur la pointe du pied, et en prenant son élan pour faire une lourde pirouette qu'il acheva très malheureusement. Sa tête alla frapper contre la boiserie trop dure, qui ne lui épargna une chute pesante qu'en lui faisant au front une large meurtrissure. Honteux de son malheur, mais voulant le dissimuler, il parut insensible à la douleur qu'il ressentoit. «Charmante enfant, me dit-il avec plus de sang-froid, mais en faisant de temps en temps de laides grimaces qui le trahissoient, vous avez raison d'éviter le comte; mais n'ayez pas peur de le rencontrer ce soir. Il y a bal masqué: la marquise a justement deux dominos; elle vous en prêtera un, elle prendra l'autre; nous irons au bal, vous reviendrez souper avec nous; et, si vous n'avez pas été trop mal couchée avant-hier…—Ho! oui, cela sera charmant! m'écriai-je avec plus de vivacité que de prudence; allons au bal.—Avec mes dominos que le comte connoît? interrompit la marquise plus réfléchie que moi.—Eh! oui, Madame, avec vos dominos. Il faut donner à cette enfant le plaisir du bal masqué, elle n'a jamais vu cela; le comte ne vous reconnoîtra pas, il n'y sera peut-être pas même.» La marquise paroissoit incertaine; je la voyois balancer entre le désir de me garder encore la nuit prochaine et la crainte d'aller, en présence du marquis, s'offrir aux sarcasmes du comte. «Pour moi, reprit d'un ton mystérieux le commode mari, je vous y conduirai bien; mais j'ai quelques affaires, je ne pourrai pas rester avec vous; je vous laisserai là, pour revenir à minuit vous chercher.» Cette raison du marquis, plus que toutes ses instances, détermina la marquise; elle refusa quelque temps encore, mais d'un ton qui m'annonçoit assez qu'il falloit la presser et qu'elle alloit consentir.
Cependant la contusion que le marquis s'étoit faite devenoit plus apparente, et sa bosse grossissoit à vue d'œil. Je lui demandai d'un air étonné ce qu'il avoit au front; il y porta la main. «Ce n'est rien, me dit-il avec un rire forcé; quand on est marié, on est exposé à ces accidens-là.» Je me souvins du supplice qu'il m'avoit fait éprouver quand ma main étoit dans les siennes, et, résolu de me venger, je tirai de ma bourse une pièce de monnoie, je la lui appliquai sur le front, et me voilà serrant de toutes mes forces pour aplatir la bosse. Le patient pressoit ses flancs de ses poings fermés, grinçoit des dents, souffloit douloureusement et faisoit d'horribles contorsions. «Elle a, dit-il avec peine, elle a de la vigueur dans le poignet.» Je redoublai d'efforts; il fit enfin un cri terrible, et, m'échappant avec violence, il seroit tombé à la renverse, si je ne l'avois promptement retenu. «Ah! la petite diablesse! elle m'a presque ouvert le crâne.—La petite espiègle l'a fait exprès, dit la marquise, qui se contraignoit beaucoup pour ne pas rire.—Vous croyez qu'elle l'a fait exprès? Hé bien, je vais l'embrasser pour la punir.—Pour me punir, soit.» Je présentai la joue de bonne grâce; il se crut le plus heureux des hommes: si j'avois voulu l'écouter, je n'aurois cessé de mettre, au même prix, son courage à l'épreuve.
«Finissons ces folies, dit la marquise en affectant un peu d'humeur, et pensons à ce bal, puisqu'il y faut aller.—Ho! madame se fâche! répondit le marquis; soyons sages, me dit-il tout bas, il y a un peu de jalousie.» Il nous regarda d'un air de satisfaction. «Vous vous aimez bien toutes les deux, poursuivit-il; mais si vous alliez vous brouiller un jour à cause de moi!… cela seroit bien singulier!…—Allons-nous au bal, ou n'y allons-nous pas?» interrompit la marquise. Elle se mit à sa toilette: on lui apporta ses dominos, qu'elle ne voulut point mettre; elle en envoya chercher deux autres dont nous nous affublâmes gaiement. «Vous connoissez le mien, dit le marquis, je le prendrai pour vous aller chercher; je ne crains pas d'être reconnu, moi!» Il nous conduisit au bal, et nous promit de revenir à minuit précis.
Dès que nous parûmes à la porte de la salle, la foule des masques nous environna: on nous examina curieusement, on nous fit danser; mes yeux furent d'abord agréablement flattés de la nouveauté du spectacle. Les habits élégans, les riches parures, la singularité des costumes grotesques, la laideur même des travestissemens baroques, la bizarre représentation de tous ces visages cartonnés et peints, le mélange des couleurs, le murmure de cent voix confondues, la multitude des objets, leur mouvement perpétuel, qui varioit sans cesse le tableau en l'animant, tout se réunit pour surprendre mon attention bientôt lassée. Quelques nouveaux masques étant entrés, la contredanse fut interrompue, et la marquise, profitant du moment, se mêla dans la foule; je la suivis en silence, curieux d'examiner la scène en détail. Je ne tardai pas à m'apercevoir que chacun des acteurs s'occupoit beaucoup à ne rien faire, et bavardoit prodigieusement sans rien dire. On se cherchoit avec empressement, on s'observoit avec inquiétude, on se joignoit avec familiarité, on se quittoit sans savoir pourquoi; l'instant d'après on se reprenoit de même en ricanant. L'un vous étourdissoit du bruyant éclat de sa voix glapissante; l'autre, d'un ton nasillard, bredouilloit cent platitudes qu'à peine il comprenoit lui-même; celui-ci balbutioit un bon mot grossier qu'il accompagnoit de gestes ridicules; celui-là faisoit une question sotte, à laquelle on répondoit par une plus sotte plaisanterie. Je vis pourtant des gens cruellement tourmentés, qui certainement auroient acheté bien chèrement l'avantage d'échapper aux propos malins, aux regards persécuteurs. J'en vis d'autres bien ennuyés, dont apparemment l'objet principal avoit été de passer la nuit au bal, de quelque manière que ce fût, et qui n'y restoient sans doute que pour se ménager la petite consolation d'assurer le lendemain qu'ils s'étoient beaucoup amusés la veille. «Voilà donc ce que c'est qu'un bal masqué! dis-je à la marquise; ce n'est donc que cela? Je ne suis pas étonné qu'ici de braves gens puissent être bafoués par des faquins, et des gens d'esprit mystifiés par des sots; je ne resterois sûrement pas, si je n'étois point avec vous.—Taisez-vous, me répondit-elle, nous sommes suivis, et peut-être reconnus; ne voyez-vous pas le masque qui s'attache à nos pas? Je crains bien que ce ne soit le comte; sortons de la foule et ne vous étonnez pas.»
C'étoit en effet M. de Rosambert; nous n'eûmes pas de peine à le reconnoître: car, ne prenant pas même celle de déguiser sa voix, il eut seulement l'attention de parler assez bas pour qu'il n'y eût que la marquise et moi qui pussions l'entendre. «Comment se portent madame la marquise et sa belle amie?» nous demanda-t-il avec un intérêt affecté. Je n'osois répondre. La marquise, sentant qu'il seroit inutile d'essayer de lui faire croire qu'il se trompoit, aima mieux soutenir une conversation délicate, qu'elle auroit peut-être heureusement terminée par son adresse, si le comte eût été moins instruit. «Quoi! c'est vous, Monsieur le comte? Vous m'avez reconnue? Cela m'étonne! je croyois que vous aviez juré de ne plus me voir et de ne me parler jamais.—Il est vrai que je vous l'avois promis, Madame, et je sais combien cette assurance que je vous ai donnée vous a mise à votre aise.—Je ne vous entends pas, et vous m'entendez mal; si je ne voulois pas vous voir, qui me forceroit à vous parler? pourquoi serois-je venue ici chercher votre rencontre?—Chercher ma rencontre, Madame! quoique l'aveu soit très flatteur, je conviens que j'aurois eu peut-être la sottise de le croire sincère, si cette chère enfant que voilà…—Monsieur, interrompit la marquise, n'avez-vous pas amené la comtesse?… Elle est très aimable, la comtesse!… qu'en dites-vous?—Je dis, Madame, qu'elle est surtout très officieuse!…» La marquise l'interrompit encore en jouant le dépit. «Elle est très aimable, la comtesse!… Monsieur, vous auriez dû l'amener…—Oui, Madame, et vous lui auriez apparemment encore confié l'honnête emploi qu'elle a si généreusement accepté, si complaisamment rempli?—Quoi! c'est peut-être moi qui l'ai chargée de vous occuper toute la soirée, de vous engager à me faire une mauvaise querelle, à me répéter cent fois une maussade plaisanterie, à me pousser à bout, enfin, de manière que je sois forcée de vous dire des choses désagréables, que vous n'avez pas manqué de prendre à la lettre, et dont je me serois repentie, si vous étiez venu hier, comme je l'espérois, solliciter votre pardon?—Mon pardon! vous me l'auriez accordé, Madame! Ah! que vous êtes généreuse! Mais soyez tranquille, je n'abuserai pas de tant de bontés, je craindrois trop de vous embarrasser beaucoup, et de faire aussi bien de la peine à ma jeune parente, qui nous écoute si attentivement, et qui a de si bonnes raisons pour ne rien dire.—Hé! Monsieur, lui répliquai-je aussitôt, que pourrois-je vous dire!—Rien, rien que je ne sache ou que je ne devine.—Je conviens, Monsieur de Rosambert, que vous savez quelque chose que madame ne sait pas; mais, ajoutai-je en affectant de lui parler bas, ayez donc un peu plus de discrétion; la marquise n'a pas voulu vous croire avant-hier; que vous coûte-t-il de lui laisser seulement encore aujourd'hui une erreur qui ne laisse pas d'être piquante?—Fort bien, s'écria-t-il, la tournure n'est pas maladroite! Vous, si novice avant-hier! aujourd'hui si manégé! Il faut que vous ayez reçu de bien bonnes leçons.—Que dites-vous donc, Monsieur? reprit la marquise un peu piquée.—Je dis, Madame, que ma jeune parente a beaucoup avancé en vingt-quatre heures; mais je n'en suis pas étonné, on sait comment l'esprit vient aux filles.—Vous nous faites donc la grâce de convenir enfin que Mlle Duportail est de son sexe!—Je ne m'aviserai plus de le nier, Madame; je sens combien il seroit cruel pour vous d'être détrompée. Perdre une bonne amie! et ne trouver à sa place qu'un jeune serviteur! la douleur seroit trop amère.—Ce que vous dites là est tout à fait raisonnable, répliqua la marquise avec une impatience mal déguisée; mais le ton dont vous le dites est si singulier! Expliquez-vous, Monsieur; cette enfant, que vous m'avez présentée vous-même comme votre parente, est-elle (en parlant très bas) Mlle Duportail ou M. de Faublas? Vous me forcez à vous faire une question bien extraordinaire; mais enfin, dites sérieusement ce qu'il en est.—Ce qu'il en est, Madame, je pouvois hasarder de le dire avant-hier; mais aujourd'hui c'est à moi à vous le demander.—Moi! répondit-elle sans se déconcerter, je n'ai là-dessus aucune espèce de doute. Son air, ses traits, son maintien, ses discours, tout me dit qu'elle est Mlle Duportail, et d'ailleurs j'en ai des preuves que je n'ai pas cherchées.—Des preuves!—Oui, Monsieur, des preuves; elle a soupé chez moi avant-hier…—Je le sais bien, Madame, et même elle étoit encore chez vous hier à dix heures du matin.—A dix heures du matin, soit; mais enfin nous l'avons reconduite chez elle.—Chez elle! faubourg Saint-Germain?—Non, près de l'Arsenal. Et monsieur son père…—Son père? le baron de Faublas?—Mais point du tout, M. Duportail… M. Duportail nous a beaucoup remerciés, le marquis et moi, de lui avoir ramené sa fille.—Le marquis et vous, Madame? Quoi! le marquis vous a accompagnés chez M. Duportail?—Oui, Monsieur; qu'y a-t-il de si étonnant à cela?—Et M. Duportail a remercié le marquis?—Oui, Monsieur.»
Ici le comte partit d'un éclat de rire. «Ah! le bon mari! s'écria-t-il tout haut; l'aventure est excellente. Ah! l'honnête homme de mari!» Il se préparoit à nous quitter. Je crus qu'il falloit, pour l'intérêt de la marquise et pour le mien propre, essayer de modérer son excessive gaieté. «Monsieur, lui dis-je en baissant la voix, ne pourroit-on pas avoir avec vous une explication plus sérieuse?» Il me regarda en riant. «Une explication sérieuse entre nous, ce soir, ma chère parente? (Il souleva un peu mon masque.) Non, vous êtes trop jolie, je vous laisse aimer et plaire; d'ailleurs, il est juste que je profite aujourd'hui de mes avantages; l'explication sera pour demain, si vous le voulez bien.—Pour demain, Monsieur? à quelle heure, et dans quel endroit?—L'heure, je ne saurois vous la fixer, cela dépendra des circonstances. N'allez-vous pas souper chez la marquise? Demain il sera peut-être midi quand le très commode marquis vous reconduira chez le très complaisant M. Duportail; vous serez probablement fatigué, je ne veux point user d'un tel avantage, il faudra vous laisser le temps de vous reposer; je passerai chez vous dans la soirée. Je ne vous dis point adieu, j'aurai le plaisir de vous revoir une fois encore avant que l'heure du berger sonne pour vous.» Il nous salua et sortit de la salle.
La marquise fut très contente de son départ. «Il nous a porté de rudes coups, me dit-elle; mais nous ne pouvions guère nous défendre mieux.» Je lui observai que le comte avait eu l'attention de baisser la voix chaque fois qu'il lui avoit lancé quelque vive épigramme, et qu'ayant seulement l'intention de nous tourmenter beaucoup, il avoit paru du moins ne la vouloir pas compromettre jusqu'à un certain point. «Je ne m'y fie pas, me répondit-elle: il sait que vous avez passé la nuit chez moi; il est piqué; le retour qu'il vous annonce n'est pas d'un bon augure, sans doute il nous prépare une attaque plus forte. Partons, ne l'attendons pas, n'attendons pas le marquis.»
Nous nous disposions à sortir, lorsque deux masques nous arrêtèrent. L'un des deux dit à la marquise: «Je te connois, beau masque.—Bonsoir, Monsieur de Faublas», me dit l'autre. Je ne répondis point. «Bonsoir, Monsieur de Faublas», répéta-t-il. Je sentis qu'il falloit recueillir mes forces et payer d'audace: «Tu n'as pas l'art de deviner, beau masque, tu te trompes de nom et de sexe.—C'est que l'un et l'autre sont fort incertains.—Tu deviens fou, beau masque.—Point du tout: les uns te baptisent Faublas et te soutiennent beau garçon; les autres vous nomment Duportail et jurent que vous êtes très jolie fille.—Duportail ou Faublas, lui répliquai-je fort interdit, que t'importe?—Distinguons, beau masque. Si vous êtes une jolie demoiselle, il m'importe à moi; si tu es un beau garçon, il importe à la jolie dame que voilà (en montrant la marquise).» Je demeurai stupéfait. Il reprit: «Répondez-moi, Mademoiselle Duportail; parle donc, Monsieur de Faublas.—Décide-toi à me donner l'un ou l'autre nom, beau masque.—Ah! si je ne considère que mon intérêt personnel et les apparences, vous êtes Mlle Duportail; mais, si j'en crois la chronique scandaleuse, tu es M. de Faublas.»
La marquise ne perdoit pas un mot de ce dialogue; mais, déjà trop pressée par l'inconnu qui l'avoit attaquée, elle ne pouvoit me secourir. Je ne sais si mon trouble ne m'alloit pas trahir, lorsqu'il s'éleva dans la salle une grande rumeur: on se précipitoit vers la porte, les masques se pressoient en foule autour d'un masque qui venoit d'entrer; ceux-ci le montroient au doigt, ceux-là poussoient de longs éclats de rire, et tous ensemble crioient: «C'est M. le marquis de B… qui s'est fait une bosse au front!» Dès que les deux démons qui nous persécutoient eurent entendu ces joyeuses exclamations, ils nous quittèrent pour aller grossir le nombre des rieurs. «Enfin les voilà partis! me dit ma belle maîtresse un peu étonnée; mais, parmi ces cris redoublés, n'entendez-vous pas le nom du marquis? Je parie que c'est un nouveau tour qu'on a joué à mon pauvre mari.»
Cependant le tumulte alloit toujours croissant; nous approchâmes, nous entendîmes des voix confuses qui disoient: «Bonsoir, Monsieur le marquis de B…, qu'avez-vous donc au front, Monsieur le marquis? depuis quand cette bosse vous est-elle venue?» Et bientôt, dans les transports de leur turbulente gaieté, tous les masques répétoient: «C'est M. le marquis de B… qui s'est fait une bosse au front!» A force de coudoyer nos voisins, nous parvînmes à joindre le masque tant bafoué: ce n'étoit ni le domino jaune du marquis, ni sa petite taille, et cependant c'étoit le marquis lui-même. Nous vîmes qu'on avoit attaché entre ses deux épaules un petit morceau de papier, sur lequel étoient tracés en caractères bien lisibles ces mots dont nos oreilles étoient remplies: C'est M. le marquis de B… qui s'est fait une bosse au front… Il nous reconnut tout d'un coup. «Je ne comprends rien à ceci, nous dit-il tout hors de lui; allons-nous-en.» Toujours poursuivi par les huées dérisoires d'une folle jeunesse, toujours porté par les flots tumultueux de la foule empressée, il eut autant de peine à regagner la porte qu'il en avoit éprouvé pour pénétrer jusqu'au milieu de la salle.
Nous le suivîmes de près. «Parbleu! nous dit le marquis, si confondu qu'il n'avoit pas la force de prendre sa place dans la voiture, je ne comprends rien à cela; jamais je ne me suis si bien déguisé, et tout le monde m'a reconnu!» La marquise lui demanda quel avoit été son dessein. «Je voulois, lui répondit-il, vous surprendre agréablement; dès que je vous ai vues dans la salle du bal, je suis retourné à l'hôtel, où j'ai fait part de mes projets à Justine, votre femme de chambre, et à celle de cette charmante enfant: car je les ai trouvées ensemble. J'ai pris un domino nouveau, je me suis fait apporter des souliers dont les talons très hauts devoient, en me grandissant beaucoup, me rendre méconnoissable; Justine a présidé à ma toilette. (Tandis qu'il parloit, la marquise détachoit habilement l'étiquette perfide et la fourroit dans sa poche.) Demandez à Justine, elle vous dira que je n'ai jamais été si bien déguisé: car elle me l'a répété cent fois, et cependant tout le monde m'a reconnu!»
La marquise et moi, nous devinâmes aisément que nos femmes de chambre nous avoient bien servis. «Mais, reprit le marquis après un moment de réflexion, comment ont-ils vu que j'avois une bosse au front? Aviez-vous conté mon accident?—A personne, je vous assure.—Cela est bien singulier! ma figure est couverte d'un masque, et l'on voit ma bosse; je me déguise beaucoup mieux qu'à l'ordinaire, et tout le monde me reconnoît!» Le marquis ne cessoit de témoigner son étonnement par des exclamations semblables, tandis que la marquise et moi, nous nous félicitions tout bas de l'heureuse adresse de nos femmes, qui nous avoient épargné si comiquement les scènes fâcheuses auxquelles nous auroient exposés le déguisement de son mari et la vengeance de mon rival.
Quel fut notre étonnement, lorsqu'en arrivant à l'hôtel nous apprîmes que le comte nous y attendoit depuis quelques minutes. Il vint à nous d'un air gai: «J'étois sûr, Mesdames, que vous ne resteriez pas longtemps à ce bal: c'est une assez triste chose qu'un bal masqué! ceux qui ne nous connoissent pas nous y ennuient; ceux qui nous connoissent nous y tourmentent!—Oh! interrompit le marquis, je n'ai pas eu le temps de m'y ennuyer, moi! tu vois comme je suis déguisé?—Hé bien?—Hé bien! dès que je suis entré, tout le monde m'a reconnu.—Comment! tout le monde!—Oui, oui, tout le monde; ils m'ont d'abord entouré: Hé! bonsoir, Monsieur le marquis de B…; et d'où vous vient cette bosse au front, Monsieur le marquis? Et ils me serroient! et ils me poussoient! et des rires! et des gestes! et un bruit! je crois que j'en resterai sourd; je veux être pendu si jamais j'y retourne. Mais comment ont-ils su que j'avois cette bosse au front?—Parbleu, elle se voit d'une lieue!—Mais mon masque?—Cela ne fait rien. Tenez, moi, j'ai été reconnu aussi.—Bon! reprit le marquis d'un air consolé.—Oui, continua le comte, mon aventure est assez drôle; j'ai rencontré là une fort jolie dame, qui m'estimoit beaucoup, mais beaucoup, la semaine passée.—J'entends, j'entends, dit le marquis.—Cette semaine elle m'a éconduit d'une manière si plaisante!… Imaginez que j'ai été au bal avec un de mes amis qui s'étoit fort joliment déguisé.» La marquise, effrayée, l'interrompit. «Monsieur le comte soupe sans doute avec nous? lui dit-elle de l'air du monde le plus flatteur.—Si cela ne vous embarrasse pas trop, Madame…—Quoi! interrompit le marquis, vas-tu faire des façons avec nous? Crois-moi, essaye plutôt de faire ta paix avec ta jeune parente qui t'en veut beaucoup.—Moi! Monsieur, point du tout! j'ai toujours pensé que M. de Rosambert étoit homme d'honneur; je le crois trop galant homme pour abuser des circonstances…—Il ne faut abuser de rien, me répondit le comte; mais il faut user de tout.—Qu'est-ce que c'est que des circonstances? s'écria le marquis, qu'entend-elle par des circonstances? Quelles circonstances y a-t-il?… Rosambert, tu me diras cela; mais conte-nous donc ton histoire.—Volontiers.—Messieurs, interrompit encore la marquise, on vous a déjà dit que le souper étoit servi.—Oui, oui, allons souper, répondit le marquis, tu nous conteras ton malheur à table.» La marquise alors s'approcha de son mari, et lui dit à mi-voix: «Y songez-vous bien, Monsieur, de vouloir qu'on raconte une histoire galante devant cette enfant?—Bon! bon! lui répondit-il, à son âge on n'est pas si novice»; et, s'adressant au comte: «Rosambert, tu nous conteras ton aventure; mais tu gazeras tout cela de manière que cette enfant…, tu m'entends bien?»
La marquise nous plaça de manière que le comte étoit entre elle et moi, et que je me trouvois, moi, entre le comte et le marquis. Un regard prompt de ma belle maîtresse m'avertit d'apporter à notre situation critique l'attention la plus scrupuleuse, de ne parler qu'avec ménagement, d'agir avec la plus grande circonspection. Le marquis mangeoit beaucoup et parloit davantage; je ne répondois que par monosyllabes aux douces phrases qu'il m'adressoit. Le comte enchérissoit sur les éloges du marquis; il me prodiguoit d'un ton railleur les complimens les plus outrés, assuroit malignement que personne au monde n'étoit plus aimable que sa jeune parente, demandoit au marquis ce qu'il en pensoit, et, préludant avec la marquise par de légères épigrammes, il protestoit qu'elle seule, jusqu'à présent, savoit précisément combien Mlle Duportail méritoit d'être aimée. La marquise, également adroite et prompte, répondoit vite et toujours bien; mesurant la défense à l'attaque, elle éludoit sans affectation ou se défendoit sans aigreur, déterminée à ménager un ennemi qu'elle ne pouvoit espérer de vaincre; aux questions pressantes elle opposoit les aveux équivoques, elle atténuoit les allégations fortes par les négations mitigées, et repoussoit les sarcasmes plus amers qu'embarrassans par des récriminations plus fines que méchantes: très intéressée à pénétrer les secrets desseins du comte, dont la vengeance étoit si facile, elle l'examinoit souvent d'un œil observateur; puis, essayant de le fléchir en l'intéressant, elle l'accabloit de politesses et d'attentions, prétextoit une forte migraine, traînoit languissamment les doux accens de sa voix presque éteinte, et de ses regards supplians sollicitoit sa grâce, qu'elle ne pouvoit obtenir.
Dès que les domestiques eurent servi le dessert et se furent retirés, le comte commença une attaque plus chaude, qui nous jeta, la marquise et moi, dans une mortelle anxiété.
Le Comte.
Je vous disois, Monsieur le marquis, qu'une jeune dame m'honoroit, la semaine passée, d'une attention toute particulière…
La Marquise, tout bas.
Quelle fatuité! (Haut.) Encore une bonne fortune! la matière est si usée!
Le Comte.
Non, Madame: une infidélité subite, avec des circonstances nouvelles qui vous amuseront…
La Marquise.
Point du tout, Monsieur, je vous assure.
Le Marquis.
Bon! les femmes disent toujours qu'une histoire galante les ennuie! Rosambert, conte-nous la tienne.
Le Comte.
Cette dame étoit au bal…, je ne sais plus quel jour… (A la marquise.) Madame, aidez-moi donc, vous y étiez aussi…
La Marquise, vivement.
Le jour, Monsieur? hé! qu'importe le jour? Pensez-vous d'ailleurs que j'aie remarqué?…
Le Marquis.
Passons, passons, le jour n'y fait rien.
Le Comte.
Hé bien, j'allai à ce bal avec un de mes amis, qui s'étoit déguisé le plus joliment du monde, et que personne ne reconnut.
Le Marquis.
Que personne ne reconnut! il étoit bien habile celui-là! Quel habit avoit-il donc?
La Marquise, très vivement.
Un habit de caractère, apparemment?
Le Comte.
Un habit de caractère!… Mais, non… (En regardant la marquise.) Cependant je le veux bien, si vous le voulez: un habit de caractère, soit. Personne ne le reconnut; personne, excepté la dame en question, qui devina que c'étoit un fort beau garçon.
(Ici la marquise sonna un domestique, le retint quelque temps sous différens prétextes: le marquis, impatienté, le renvoya; le comte reprit.)
La dame, charmée de sa découverte… Mais je ne veux plus rien dire, parce que le marquis la connoît.
Le Marquis, riant.
Cela se peut: d'abord, j'en connois beaucoup; mais cela ne fait rien, continue.
La Marquise.
Monsieur le comte, on donnoit hier une pièce nouvelle.
Le Comte.
Oui, Madame; mais permettez-moi de finir mon histoire.
La Marquise.
Point du tout: je veux savoir ce que vous pensez de la pièce.
Le Comte.
Permettez, Madame…
Le Marquis.
Eh! Madame, laissez-le donc nous raconter!…
Le Comte.
Pour abréger, vous saurez que mon jeune ami plut beaucoup à la dame; que ma présence ne tarda pas à la gêner, et le moyen qu'elle imagina pour se débarrasser de moi…
La Marquise.
C'est un roman que cette histoire-là.
Le Comte.
Un roman, Madame! Ah! tout à l'heure, si l'on m'y force, je convaincrai les plus incrédules. Le moyen qu'elle imagina fut de me détacher une jeune comtesse, son intime amie, femme très adroite, très obligeante, qui s'empara de moi tellement…
Le Marquis.
Comment! on t'a donc bien joué?
Le Comte.
Pas mal, pas mal, mais beaucoup moins que le mari, qui arriva…
Le Marquis.
Il y a un mari!… Tant mieux!… J'aime beaucoup les aventures où figurent des maris comme j'en connois tant! Hé bien! le mari arriva… Qu'avez-vous donc, Madame?
La Marquise.
Un mal de tête affreux!… Je suis au supplice… (Au comte.) Monsieur, remettez de grâce à un autre jour le récit de cette aventure.
Le Marquis.
Eh! non, conte, conte donc: cela la dissipera.
Le Comte.
Oui, je finis en deux mots.
Mlle Duportail, au marquis tout bas.
M. de Rosambert aime beaucoup à jaser, et ment quelquefois passablement.
Le Marquis.
Je sais bien, je sais bien; mais cette histoire est drôle: il y a un mari, je parie qu'on l'a attrapé comme un sot.
Le Comte, sans écouter la marquise qui veut lui parler.
Le marquis arriva, et ce qu'il y eut d'étonnant, c'est qu'en voyant la figure douce, fine, agréable, fraîche, du jeune homme si joliment déguisé, le mari crut que c'étoit une femme…
Le Marquis.
Bon!… oh! celui-là est excellent! oh! l'on ne m'auroit pas attrapé comme cela, moi; je me connois trop bien en physionomie.
Mlle Duportail.
Mais cela est incroyable!
La Marquise.
Impossible! M. de Rosambert nous fait des contes… qu'il devroit bien finir, car je me sens fort incommodée.
Le Comte.
Il le crut si bien qu'il lui prodigua les complimens, les petits soins, et même il en vint jusqu'à lui prendre la main et à la lui serrer doucement… (au marquis) tenez, à peu près comme vous faites à présent à ma cousine.
(Le marquis étonné quitta promptement ma main, qu'il tenoit en effet.)
«Il l'a fait exprès, me dit-il: je crois qu'il voudroit que la marquise s'aperçût de notre intelligence.—Qu'il est jaloux! qu'il est méchant et menteur!… lui répliquai-je;… comme un avocat.» (Le comte, toujours sourd aux instances que la marquise avoit eu le temps de renouveler, reprit:)
Tandis que le bon mari, d'un côté, épuisoit les lieux communs de la vieille galanterie, et pressoit la main chérie,… la dame, non moins vive, mais plus heureuse…
La Marquise.
Eh! Monsieur, quelles femmes avez-vous donc connues?… Vous nous peignez celle-là sous des couleurs… Ne se peut-il pas que, trompée, comme son mari, par les apparences…
Le Comte.
Cela eût été très possible; mais je crois que cela n'étoit pas. Au reste, vous allez en juger vous-même, écoutez jusqu'au bout.
La Marquise.
Monsieur, s'il faut absolument que vous racontiez cette histoire, je vous prie au moins de songer que vous devez quelques ménagemens (en regardant Mlle Duportail) à certaines personnes qui vous écoutent.
Le Marquis.
Rosambert, Madame a raison; gaze un peu cela, à cause de cette enfant (en montrant Mlle Duportail).
Le Comte.
Oui… oui!… La dame fort émue…
La Marquise.
Monsieur, de grâce, abrégez des détails qui ne sont pas honnêtes.
Mlle Duportail, d'un ton fort brusque.
Il est minuit, Monsieur.
Le Comte, fort doucement.
Je le sais bien, Mademoiselle, et, si cette conversation vous ennuie, je ne dirai qu'un mot… pour l'achever.
Le Marquis, à Mlle Duportail.
Il est très piqué contre vous. Les amitiés que vous me faites!… Il est jaloux comme un tigre!
La Marquise.
Monsieur le comte, à propos, pendant que j'y pense, avez-vous obtenu du ministre?…
Le Comte.
Oui, Madame, j'ai obtenu tout ce que je voulois; mais laissez-moi…
Le Marquis.
Ah! ah! qu'est-ce que tu sollicitois donc?
Le Comte.
Une petite pension de dix mille livres pour le jeune vicomte de G…, mon parent; il y a déjà plusieurs jours… Pour revenir à mon aventure…
Le Marquis.
Oui, oui, revenons-y.
La Marquise.
Il doit être bien content de vous, le vicomte?
Le Comte.
La dame fort émue…
La Marquise.
Monsieur le comte, répondez-moi donc.
Le Comte.
Oui, Madame, il est très content… La dame fort émue…
La Marquise.
Et son cher oncle le commandeur?
Le Comte.
En est fort aise aussi, Madame; mais vous vous intéressez prodigieusement…
La Marquise.
Oui, tout ce qui regarde mes amis me touche sensiblement; et cette affaire me tourmentoit à cause de vous: si vous m'en aviez parlé plus tôt, j'aurois pu vous y servir…
Le Comte.
Madame, je suis très sensible…; mais permettez-moi…
La Marquise.
A-t-il en effet rendu quelque service à l'État, le vicomte?
Le Comte, en riant.
Oui, Madame; sans lui, le duc de *** n'avoit pas d'héritier, la maison s'éteignoit.
La Marquise.
Mais, si l'on récompense aussi magnifiquement tous ceux qui servent l'État de cette manière, je ne m'étonne plus de l'embarras où est le trésor royal.
Le Comte.
Très bien, Madame. Cependant permettez…
La Marquise.
Enfin, n'importe; si jamais pareille occasion se présente, employez-moi, ou bien nous nous brouillerons mortellement.
Le Comte.
Madame, je vous rends grâce… Permettez qu'enfin je reprenne le récit de mon aventure.
La Marquise.
Oh! si vous vous adressiez à d'autres, je ne vous le pardonnerois pas, je vous en avertis.
Le Marquis.
Allons, voilà qui est dit: laissez-le donc finir son histoire.
Le Comte.
La dame, fort émue, prodiguoit au jeune Adonis…
La Marquise.
Quelle migraine j'ai!
Le Comte.
Prodiguoit au jeune Adonis…
La Marquise, tirant le marquis à part et lui parlant à mi-voix:
Monsieur, je vous le répète, il n'est pas décent de conter devant cette enfant…
Le Marquis.
Bon! bon! elle en sait plus qu'on ne croit! La petite personne est futée, allez! je me connois en physionomie!
Le Comte.
Monsieur le marquis, je ne pourrai jamais finir ce récit, on m'interrompt à tout moment; mais je vais rentrer chez moi, et demain matin je vous enverrai tous les détails par écrit.
La Marquise.
Bonne plaisanterie!
Le Comte, au marquis.
Non, je vous l'enverrai, parole d'honneur, et je mettrai les lettres initiales de chaque nom,… à moins qu'on ne me laisse finir ce soir.
Le Marquis.
Eh bien! allons donc, finis.
La Marquise.
A la bonne heure, finissez; mais songez…
Le Comte.
La dame, fort émue, prodiguoit au jeune Adonis les confidences flatteuses, les doux propos, les petits baisers tendres… C'étoit vraiment une scène à voir. On ne peut la peindre;… mais on pourroit la jouer… Tenez, jouons-la.
Le Marquis.
Tu badines!
La Marquise.
Quelle folie!
Mlle Duportail.
Quelle idée!
Le Comte.
Jouons-la: Madame sera la dame en question; moi, je suis le pauvre amant bafoué… Ah! c'est qu'il nous manquera une comtesse!… (A la marquise.) Mais madame a des talens précieux, elle peut bien remplir à la fois deux rôles difficiles.
La Marquise, avec une colère contrainte.
Monsieur…
Le Comte.
Je vous demande pardon, Madame, ce n'est qu'une supposition.
Le Marquis.
Mais sans doute; il ne faut pas que cela vous fâche.
La Marquise, d'une voix éteinte et les larmes aux yeux.
Il s'agit bien des rôles qu'on m'offre, Monsieur;… mais c'est qu'il est bien cruel que je me plaigne depuis une heure d'être fort mal, sans qu'on daigne y faire la moindre attention. (Au comte, en tremblant.) Peut-on, Monsieur, sans vous offenser, vous observer qu'il est tard et que j'ai besoin de repos?
Le Comte, un peu touché.
Je serois désolé de vous importuner, Madame.
La Marquise.
Vous ne m'importunez pas, Monsieur; mais je vous répète que je suis malade, et fort malade.
Le Marquis.
Eh mais, comment ferons-nous? où couchera Mlle Duportail?
La Marquise, vivement.
En vérité! Monsieur, il semble qu'il n'y ait pas un appartement dans cet hôtel!»
Effrayé de la tournure que l'entretien venoit de prendre, je m'approchai du comte. «Charmante enfant, me dit-il tout bas, laissez-moi: tout ce que vous me direz ne vaut pas ce que je suis curieux de savoir au juste, et ce que je vais apprendre tout à l'heure.
Le Marquis.
Il y a des appartemens, Madame; mais cette enfant n'aura-t-elle pas peur toute seule?
Le Comte, avec vivacité.
Pas plus que la dernière fois.
Le Marquis, brusquement, en montrant la marquise.
Mais la dernière fois elle a couché avec madame!
Le Comte.
Ah!
La Marquise, troublée, balbutie.
Elle a couché dans mon appartement,… et moi…
Le Marquis.
Elle a couché dans votre lit, avec vous. Je le sais bien, puisque j'ai moi-même fermé les rideaux; ne vous en souvenez-vous pas?
(La marquise confondue ne répondit pas, le marquis continua en affectant de parler bas:)
Ne vous souvenez-vous pas que je suis venu dans la nuit?…
(La marquise porta la main à son front, jeta un cri de douleur, et s'évanouit.)
Je n'ai jamais pu découvrir si cet évanouissement étoit bien naturel; mais je sais que, dès que le marquis nous eut quittés pour aller dans son appartement chercher lui-même une eau qu'il disoit souveraine en pareil cas, la marquise reprit ses sens, rassura promptement Justine et la Dutour, accourues pour la secourir, leur ordonna de nous laisser; et que, s'adressant au comte: «Monsieur, lui dit-elle, avez-vous donc juré de me perdre?—Non, Madame, j'ai voulu m'instruire de quelques détails que j'ignorois, vous prouver qu'on ne me joue pas impunément, et vous forcer de convenir que, si je suis capable de me venger…—De vous venger? interrompit-elle; et de quoi?—Je sais pourtant, continua-t-il, maître de mon ressentiment, ne pas porter la vengeance trop loin. Maintenant, Madame, vous voilà tranquille, à une condition cependant. Je sens, ajouta-t-il en nous regardant malignement, je sens que je vais vous affliger tous deux: vous vous étiez promis une nuit heureuse, heureuse autant que celle d'avant-hier; mais vous, Monsieur, vous m'avez trop peu ménagé pour que je m'intéresse au succès de vos projets galans; et vous, Madame, vous n'espérez pas, sans doute, que, ministre complaisant de vos plaisirs, je puisse voir comme un mari…—Moi, Monsieur! s'écria-t-elle, je n'espère rien de vous, mais je croyois aussi n'en avoir rien à craindre; et, quelle que soit ma conduite, d'où vous viendroit donc, je vous en supplie, le droit que vous vous attribuez de l'éclairer?» Rosambert ne répondit à cette question que par un sourire amer. «Que, ministre complaisant de vos plaisirs, poursuivit-il, je puisse voir comme un mari… chargez-vous de choisir l'épithète… je puisse voir M. de Faublas passer dans vos bras en ma présence même!—M. de Faublas dans mes bras!—Ou Mlle Duportail dans votre lit: n'est-ce pas la même chose? Eh mais, Madame, je croyois que là-dessus nous étions d'accord. Croyez-moi, le temps est cher, ne le perdons pas à disputer plus longtemps sur les mots, composons. Que cette charmante enfant m'accorde l'honneur de l'accompagner; que je la reconduise chez son père tout à l'heure, à cette condition je me tais.»
Le marquis entra, tenant un flacon. «Je suis très sensible à vos soins, lui dit la marquise; mais vous voyez que je suis un peu moins mal: je voudrois être tout à fait bien, afin de pouvoir garder Mlle Duportail.—Comment? s'écria le marquis.—Je suis toujours fort incommodée, il est impossible que cette chère enfant passe la nuit chez moi.—Eh bien, Madame, n'y a-t-il pas, comme vous le disiez tout à l'heure, un appartement dans cet hôtel?—Oui, Monsieur, mais vous m'avez fait une objection à laquelle je me rends: cette enfant auroit peur. D'ailleurs la laisser ainsi toute seule…, je ne le souffrirai pas.—Elle ne sera pas seule, Madame; sa femme de chambre est ici.—Sa femme de chambre,… sa femme de chambre!… Eh bien! Monsieur, puisqu'il faut tout vous dire, M. Duportail ne veut pas que mademoiselle sa fille couche ici.—Qui vous l'a dit, Madame?—Monsieur le comte vient de m'annoncer seulement tout à l'heure que M. Duportail l'a prié de passer ici pour lui ramener sa fille.—Pourquoi donc ne nous as-tu pas dit cela tout de suite, toi?—Mais, répondit Rosambert en riant, c'est que je n'ai pas voulu troubler votre joie pendant le souper.—M. Duportail envoie chercher sa fille! reprit le marquis; croit-il qu'elle est mal ici? pourquoi d'ailleurs te charger de cette commission? il nous doit une visite et des remerciemens: quand il seroit venu lui-même!… Je le verrai; je veux savoir quelles raisons… Je le verrai.»
Je fis une profonde révérence à la marquise: elle se leva et vint à moi pour m'embrasser. M. de Rosambert se jeta entre elle et moi. «Madame, vous êtes si incommodée! ne vous dérangez pas»; et, la prenant doucement par le bras, il la força de s'asseoir; ensuite il prit ma main d'un air galant, et le marquis ne vit qu'avec le regret le plus vif Mlle Duportail et la Dutour s'éloigner dans la voiture du comte.
Au détour de la première rue, M. de Rosambert ordonna à son cocher d'arrêter. «Je connois ce visage-là, me dit-il en regardant ma prétendue femme de chambre, je ne crois pas que le ministère de cette brave femme vous soit agréable chez M. de Faublas; ainsi nous nous dispenserons de la promener jusque-là.» La Dutour descendit sans répliquer un seul mot, et nous continuâmes notre route. Je fis remarquer au comte que nous étions libres enfin, qu'il avoit trop abusé de l'embarras de ma position, et qu'il ne pouvoit se dispenser de m'accorder une prompte satisfaction. «Je ne vois ce soir que Mlle Duportail, me répondit-il: demain, si le chevalier de Faublas a quelque chose à me dire, il me trouvera chez moi. Nous ferons ensemble un déjeuner de garçon, je dirai librement à mon ami ce que je pense de sa conduite, et, s'il est raisonnable, j'espère le convaincre sans peine qu'il ne doit pas être si mécontent de la mienne.» Cependant nous arrivâmes à la porte de l'hôtel; ce fut M. Person lui-même qui me l'ouvrit: il m'apprit que le baron avoit attendu mon retour avec plus d'inquiétude que de colère, et que, désespérant enfin de me revoir ce soir, il ne s'étoit couché qu'après avoir recommandé vingt fois à Jasmin d'aller, dès qu'il seroit jour, me chercher au bal ou chez le marquis de B…
Je me retirai dans mon appartement, où, rappelant à mon esprit les divers événemens de cette journée si peu tranquille, je fus moins étonné d'avoir pu la passer tout entière sans m'occuper de ma Sophie; et, comme pour réparer ce long oubli, je répétai vingt fois son nom chéri. J'avoue pourtant que celui de la marquise vint aussi quelquefois sur mes lèvres; j'avoue que d'abord il me parut dur d'être réduit à pousser d'inutiles soupirs dans mon lit solitaire; mais je pris le parti d'offrir à ma Sophie le sacrifice de mes plaisirs, quelque involontaire qu'il eût été, et je m'endormis presque consolé du célibat auquel la vengeance du comte m'avoit condamné.
J'allai, dès qu'il fit jour, présenter mes devoirs au baron. Il me dit avec beaucoup de douceur: «Faublas, vous n'êtes plus un enfant, je vous laisse une honnête liberté, j'espère que vous n'en abuserez pas. J'espère que vous ne passerez jamais les nuits ailleurs que dans cet hôtel; songez que je suis père, et que, si mon fils m'aime, il doit craindre de m'inquiéter.»
Je me hâtai de me rendre chez M. de Rosambert, qui déjà m'attendoit. Dès qu'il m'aperçut, il vint à moi en riant, et, sans me laisser le temps de dire un seul mot, il se jeta à mon col. «Que je vous embrasse, mon cher Faublas! votre aventure est délicieuse; plus je m'en occupe, et plus elle m'amuse.» Je l'interrompis brusquement: «Je ne suis pas venu pour recevoir vos complimens…» Le comte me pria d'un ton plus sérieux de m'asseoir. «Vous pourriez, me dit-il, m'en vouloir encore! je vous reverrois dans les mêmes dispositions! Allons donc, mon jeune ami, vous êtes fou. Quoi! une ingrate beauté vous favorise et me délaisse; c'est moi qu'on sacrifie, c'est à vous qu'on m'immole, et vous vous fâchez? Je ne punis que par une inquiétude momentanée les galantes tromperies du couple adroit qui me joue, et c'est par le sang de son ami que M. de Faublas prétend venger les petites tribulations de Mlle Duportail? je vous jure que cela ne sera pas. Mon cher Faublas, j'ai sur vous l'avantage de six années d'expérience; je sais très bien qu'à seize ans on ne connoît que sa maîtresse et son épée; mais à vingt-deux un homme du monde ne se bat plus pour une femme.»
Je donnai quelques signes d'étonnement qu'il remarqua. «Croyez-vous au véritable amour? ajouta-t-il aussitôt; c'est encore une des illusions de l'adolescence, je vous en avertis. Moi, je n'ai vu partout que la galanterie. Qu'est-ce d'ailleurs que votre aventure? une bonne fortune, et rien de plus: et d'une histoire comique nous ferions une tragédie! nous nous égorgerions pour une belle dame qui me quitte aujourd'hui, et qui demain vous plantera là! Chevalier, gardez votre courage pour une occasion plus importante; on ne peut désormais soupçonner le mien. Il est trop vrai que le fatal concours des circonstances nous force quelquefois à verser le sang d'un ami: puisse l'honneur, l'inflexible honneur, ne vous réduire jamais à cette horrible extrémité!… Mon cher Faublas, j'avois à peu près votre âge quand la marquise de Rosambert, dont je suis le fils unique, achevoit sa trente-troisième année; elle étoit si fraîche encore qu'on ne lui eût pas donné plus de vingt-cinq ans: dans le monde on l'appeloit ma sœur aînée. Avec les agrémens de la jeunesse, elle avoit conservé ses goûts, elle aimoit les assemblées nombreuses et les plaisirs bruyans. Une nuit que je l'avois conduite au bal de l'Opéra, on l'y insulta publiquement. J'accourus aux cris de la marquise, qui venoit d'ôter son masque: déjà l'insolent inconnu l'avoit suppliée d'excuser sa méprise, et se perdoit dans la foule. Je le joignis, je l'obligeai de se démasquer: je reconnus le jeune Saint-Clair, Saint-Clair compagnon de mon enfance, et de tous mes amis le plus cher. «Je ne croyois pas que ce fût la marquise de Rosambert.» Voilà tout ce qu'il me dit. C'étoit beaucoup, sans doute… Hélas! un murmure général nous fit comprendre que ce n'étoit pas assez, l'honneur vouloit du sang: nous nous battîmes. Saint-Clair succomba, je tombai sans connoissance auprès de mon ami mourant. Pendant plus de six semaines une horrible fièvre brûla mon sang et troubla ma raison. Dans mon délire affreux je ne voyois que Saint-Clair; sa plaie saignoit sous mes yeux, les convulsions de la mort agitoient ses membres tremblans; et cependant il me regardoit d'un air attendri, d'une voix éteinte il m'adressoit de touchans adieux; dans ses derniers momens, il ne paroissoit sensible qu'à la douleur de quitter le barbare qui venoit de l'immoler. Longtemps cette affreuse image me poursuivit, longtemps on trembla pour ma vie; enfin la nature, secondée des efforts de l'art, opéra ma guérison; mais je recouvrai ma raison sans perdre mes remords. Le temps, qui console de tout, a séché mes pleurs; mais jamais, jamais le souvenir de cet affreux combat ne s'effacera de ma mémoire… Chevalier, je ne me verrois qu'avec peine obligé de me battre avec un inconnu; jugez si j'irai, sans raison, exposer ma vie pour menacer la vôtre… Ah! si jamais l'inflexible honneur nous y forçoit, mon cher Faublas, je vous le jure, votre victoire ne seroit ni pénible ni glorieuse; j'ai trop éprouvé qu'en pareil cas celui qui meurt n'est pas le plus malheureux.»
Rosambert me tendit les bras, je l'embrassai de bon cœur; son trouble se dissipa peu à peu. «Déjeunons», me dit-il, et, reprenant sa première gaieté: «Vous veniez me faire une querelle, ingrat, quand vous me devez mille remerciemens.—Je vous dois…?—Sans doute: n'est-ce pas moi qui vous ai fait connoître la marquise? Il est vrai que je ne prévoyois pas le malin tour qu'on me joueroit: j'aurois pu pressentir une infidélité; mais deviner qu'elle auroit lieu si promptement, avec des circonstances si singulières! (Il se mit à rire.) Oh! mais plus j'y pense, plus je crois devoir vous féliciter. Elle est délicieuse, votre aventure! et puis vous entrez dans le monde par la belle porte! La marquise est jeune, belle, pleine d'esprit, considérée à la ville, bienvenue à la cour, intrigante en diable; elle jouit d'un crédit immense et sert ses amis chaudement.» Je témoignai au comte que je n'emploierois jamais de tels moyens pour aller à la fortune. «Et vous avez tort, me répondit-il: combien de gens d'un vrai mérite ne se sont pourtant avancés que par là! Mais laissons cela; ne me donnerez-vous pas quelques détails sur cette nuit joyeuse, de laquelle vous vous étiez bien trouvé sans doute, puisque, sans moi, vous auriez fait le lendemain?»
Je ne me fis pas presser. «Ah! la rusée marquise! s'écria le comte après m'avoir entendu. Ah! la fine dame! comme elle a filé son bonheur! et son honnête époux, le cher marquis, le plus doux, le plus crédule, le plus complaisant des commodes maris dont la France abonde! en vérité, il me feroit croire que certains hommes ont été mis dans ce bas monde tout exprès pour servir à l'amusement de leur prochain. Mais sa femme! sa femme!…—Est très aimable.—Je le sais bien, je le savois même avant vous, et nous nous serions coupé la gorge à cause d'elle! Ah!—Je conviens, Rosambert, que nous aurions mal fait.—Très mal; et puis c'est qu'une telle incartade auroit été d'un exemple fort dangereux.—Comment?—Tenez, Faublas, dans le cercle borné de chacune des sociétés particulières qui composent ce que la bonne compagnie appelle le monde, il y a nombre d'intrigues qui se croisent, une foule d'intérêts qui se contrarient. Tel est le mari de celle-ci qui est l'amant de celle-là, tel est aujourd'hui sacrifié qui demain vous immole: les hommes sont entreprenans, ils attaquent sans cesse; les femmes sont foibles, elles cèdent toujours: il résulte de là que le célibat devient un état fort doux, que le joug du mariage paroît moins insupportable; la jeunesse s'amuse, l'État se peuple, et tout le monde est content. Eh bien! si la jalousie alloit répandre aujourd'hui son noir poison, si les maris qu'on attrape s'armoient pour réparer l'honneur de leurs fragiles moitiés, si les amans qu'on délaisse s'égorgeoient pour se disputer un cœur volage, vous verriez une désolation générale; la ville et la cour deviendroient un vaste champ de carnage. Combien de femmes crues sages seroient tout à coup veuves! que de beaux enfans réputés légitimes pleureroient leurs pères! que de charmans bâtards végéteroient abandonnés! La génération présente passeroit après avoir fait, mais avant d'avoir élevé sa postérité.—Quel tableau vous faites, Rosambert! Vous peignez la galanterie; mais l'amour tendre et respectueux…—N'existe plus; il ennuyoit les femmes, les femmes l'ont tué.—Vous n'estimez donc guère les femmes?—Moi! je les aime… comme elles veulent être aimées.—Ah! lui répliquai-je avec la plus grande vivacité, je vous pardonne vos blasphèmes, vous ne connoissez pas ma Sophie.» Il me demanda l'explication de ces derniers mots; mais je la lui refusai avec cette discrétion qui, surtout dans sa naissance, accompagne le véritable amour.
Cependant nous déjeunions comme on dîne; le vin de Champagne n'étoit pas épargné, et l'on sait que Bacchus est le père de la gaieté. Il me parut que le comte, s'il estimoit peu les femmes, les aimoit beaucoup et se plaisoit à parler d'elles. Plein du système qu'il soutenoit, il l'appuyoit du scandaleux récit des anecdotes galantes du jour. Rosambert m'embarrassoit sans me persuader; à chaque exemple qu'il me donnoit, je répondois toujours qu'une exception, loin de détruire la règle, la prouvoit. «Mais vous ne savez donc pas, me dit-il avec chaleur, vous ne savez donc pas à quel point la bonne moitié des individus de ce sexe tant honoré porte chaque jour l'entier oubli de cette modestie naturelle, de cette pudeur innée que vous lui supposez?» Il se leva avec vivacité, et, riant de toutes ses forces: «Parbleu! tenez,… vous n'avez pas disposé de votre journée,… venez avec moi, venez… Je vais de ce pas vous présenter à une belle dame… Nous en trouverons chez elle beaucoup d'autres,… elles sont jolies, vous serez le maître de les estimer toutes, et tant qu'il vous plaira.»
Tous deux en pointe de vin, nous montâmes dans un honnête fiacre qui s'arrêta devant une maison d'assez belle apparence; mais les airs cavaliers de la maîtresse du logis, le ton leste dont le comte la traitoit, l'accueil non moins leste dont elle m'honora, tout me fit soupçonner que j'étois engagé dans une partie de filles. J'en demeurai convaincu quand la brave dame, de qui le comte paroissoit très connu, et qui vouloit, disoit-elle poliment, me déniaiser, m'eut montré toutes les curiosités de sa maison. M. de Rosambert prenoit la peine de m'expliquer tout lui-même. «Voilà, me dit-il, le cabinet de bains; c'est ici que se blanchissent et se parfument les gentilles recrues que la ville et les campagnes fournissent journellement à cette active entremetteuse. Dans cette armoire vous voyez plusieurs flacons d'une eau très astringente dont le grand mérite est de réparer toute espèce de brèche faite à ce que les vierges appellent leur vertu. Beaucoup de demoiselles bien nées s'en servent discrètement, et vont ensuite, la première nuit des noces, offrir au mortel heureux qui les épouse un honneur tout neuf. A côté, remarquez l'essence à l'usage des monstres; elle produit un effet tout contraire: aussi ne s'en sert-on jamais. Hélas! il est passé, le temps des miniatures, et dans tout Paris, je gage, on ne trouveroit plus une seule petite femme qui eût besoin de cette eau-là. En revanche, si celle que vous voyez en ces flacons plus grands est aussi bonne qu'on le prétend, il s'en fera bientôt une prodigieuse consommation. Vous verrez accourir chez le docteur Guibert de Préval une foule de clercs de procureurs, quelques robins, beaucoup de grands seigneurs, une partie de nos militaires, et presque tous nos abbés: c'est le fameux spécifique.
«Vous savez, Faublas, ce que c'est qu'un cabinet de toilette. Celui-ci n'a rien de remarquable. Passons.
«C'est ici la salle de bal: on n'y danse pas, mais on s'y déguise. Vous prenez cela pour une armoire, c'est une porte de communication; elle rend dans une maison qui a son entrée dans une autre rue. Une femme de qualité a-t-elle de secrets besoins qu'elle soit pressée de satisfaire, elle entre par là, se déguise en suivante, montre ses appas sous la bure, et reçoit les vigoureux embrassemens d'un rustre grossier déguisé en prélat, ou d'un gros prélat si naturellement travesti qu'on le prend pour un rustre. Ainsi l'on se rend mutuellement service, et, comme personne ne se reconnoît, on n'a d'obligation à personne.
«Maintenant entrons dans l'infirmerie: que le mot ne vous alarme pas! Ouvrez, si bon vous semble, ces brochures licencieuses, considérez ces peintures obscènes: elles furent mises ici pour allumer l'imagination de ces vieux débauchés que la mort a frappés d'avance dans l'endroit le plus sensible; et c'est encore avec ces petits faisceaux de genêt parfumés qu'on les ressuscite. Vous concevez qu'un pareil moyen seroit trop violent pour le beau sexe: aussi lui a-t-on réservé ces pastilles; elles sont tellement irritantes qu'une femme qui en a mangé prend d'abord ce qu'on appelle la rage d'amour; au reste, on ne les emploie ordinairement que contre quelques jolies villageoises froides par tempérament et vertueuses de bonne foi: nos honnêtes femmes qui ont du monde et de l'éducation ne résistent jamais assez pour qu'on soit réduit à les attaquer avec ces armes-là.
«Venez, venez, approchez-vous: parmi les plantes curieuses du Jardin du Roi, n'avez-vous pas remarqué celle-ci? c'est cela que bien des pauvres filles ont appelé leur consolateur. Vous n'imaginez pas à combien de dévotes madame en a fourni. Cette dernière pièce se nomme le Salon de Vulcain: il n'y a rien de remarquable que cet infernal fauteuil, une malheureuse qu'on y jette s'y trouve renversée sur le dos, ses bras restent ouverts, ses jambes s'écartent mollement: on la viole sans qu'elle puisse opposer la moindre résistance. Vous frémissez, Faublas, et pour cette fois vous avez raison: je suis jeune, ardent, libertin, peu scrupuleux si vous voulez; mais, en vérité, je crois que je ne pourrois jamais me résoudre à asseoir de force une pauvre vierge dans ce fauteuil-là.»
Le comte ajouta: «Si nous étions venus plus tôt, on nous auroit donné deux petites bourgeoises; mais, faute de mieux, voyons le sérail.» C'étoit ainsi qu'il appeloit la salle où se trouvoient rassemblées beaucoup de nymphes, qui toutes passèrent devant nous en briguant l'honneur du mouchoir. Rosambert prit la plus jolie, j'eus la singulière fantaisie de choisir la plus laide.
«En attendant, me dit le comte, qu'on ait servi le dîner que j'ai demandé, nous pouvons, chacun de notre côté, commencer avec notre belle un bout de conversation; à table nous formerons la partie carrée.» Né curieux, je me sentis l'envie d'examiner un peu en détail la nymphe que je m'étois choisie; il me parut important de savoir quelle différence il y avoit entre une belle marquise et une laide courtisane. Le sujet étoit peu digne de mon attention: la recherche m'amusa d'abord uniquement par les objets de comparaison qu'elle m'offrit; insensiblement j'y pris feu, et machinalement je songeai à pousser l'examen aussi loin qu'il pouvoit aller. La nymphe s'aperçut de mes heureuses dispositions; et, ne me laissant pas le temps de réfléchir davantage, elle m'invita à tenter l'attaque, et se prépara fièrement à la soutenir; mais tout à coup, sans que j'eusse besoin d'expliquer mes intentions pacifiques, la guerrière expérimentée vit qu'il n'y auroit pas entre nous la plus légère escarmouche. Elle se releva nonchalamment, et, me regardant avec attention: «Tant mieux, dit-elle, ç'auroit été dommage!» Il est impossible de se figurer combien je fus frappé du sens très clair que présentoient ces mots: «Ç'auroit été dommage!» Je n'examinai pas ce que Rosambert deviendroit, je m'enfuis de cette infâme maison en jurant que je n'y retournerois de ma vie.
Le comte étoit chez moi le lendemain à dix heures du matin; il venoit savoir quelle terreur panique m'avoit saisi, et m'assura que mon aventure, s'étant répandue dans cette maison, avoit singulièrement diverti tous ceux qui s'y trouvoient. «Quoi! Rosambert! cette fille me dit: «Ç'auroit été dommage!» et vous appelez ma terreur une terreur panique!—Oh! cela est différent; la nymphe a un peu tronqué l'aventure,… elle se gardoit bien de nous apprendre… Le ç'auroit été dommage! change entièrement l'histoire… Il est d'un bon genre, le ç'auroit été dommage!… Eh bien, Faublas, cette femme qui vous félicite froidement d'avoir échappé à un danger qu'elle vous invitoit à courir, l'estimez-vous?—Vous me faites là une plaisante question, Rosambert; eh! que pourriez-vous conclure de ma réponse contre son sexe en général?—Vous esquivez, mon ami: vous êtes donc incorrigible? Eh bien, estimez, estimez, puisque vous le voulez absolument; moi, je vais me coucher.—Comment! vous coucher? d'où venez-vous donc?—Que voulez-vous? dans le monde il faut s'amuser de tout. J'ai trouvé là le commandeur de ***, le petit chevalier de M…, l'abbé de D…: nous avons fait toute la soirée et toute la nuit un vacarme, une orgie! cela étoit délicieux! mais je vais me coucher.»
J'étois à peine habillé quand mon père monta chez moi; il me dit que M. Duportail m'attendoit à dîner. Il ajouta: «Vous passerez ensemble toute la soirée; je soupe dans ce quartier-là, j'irai vous prendre chez lui, je vous ramènerai.»
Je me hâtai de sortir, car j'étois pressé de voir ma jolie cousine. Elle vint au parloir avec ma sœur. «Que vous êtes heureux! me dit vivement Adélaïde; vous allez au bal, vous y passez les nuits, vous y avez fait la connoissance d'une fort jolie dame!—Et qui vous a dit tout cela?—M. Person, qui n'a pas de secrets pour nous.» Sophie baissoit les yeux et gardoit le silence. Ma sœur continua ainsi: «Dites-nous donc quelle est cette dame;… et un bal masqué, cela doit être beau!—Fort ennuyeux, je vous assure; et, quant à cette dame, elle est jolie, mais beaucoup moins,… oh! beaucoup moins que ma jolie cousine.» Sophie, toujours muette, toujours les yeux baissés, ne paroissoit occupée que de quelques breloques qui manquoient au cordon de sa montre; mais la rougeur dont son front s'étoit couvert la trahit. Je vis que notre conversation la touchoit d'autant plus qu'elle affectoit de s'y intéresser moins. «Vous avez du chagrin, ma jolie cousine?—Répondez donc, Mademoiselle, lui dit sa vieille gouvernante.—Non, Monsieur; mais c'est que,… c'est que j'ai mal dormi cette nuit.—Oui, dit encore la vieille, cela est vrai: mademoiselle, depuis trois ou quatre jours, s'accoutume à ne pas dormir… C'est une fort mauvaise habitude, fort mauvaise, on en meurt très bien; moi qui vous parle, j'ai connu Mlle…, tenez, Mlle Storch… Vous n'avez pas connu cela, vous, Mademoiselle, vous êtes trop jeune. Dame! il y a bien quarante-cinq ans que cela est arrivé… Mlle Storch…»
La vieille avoit ainsi commencé son histoire, et, si je ne voulois pas être privé du bonheur de voir ma jolie cousine, il falloit en écouter tranquillement la longue narration. Sophie m'épargna ce déplaisir pour m'en causer un plus vif. Elle se leva; sa gouvernante lui demanda avec humeur ce qu'elle avoit; elle répondit qu'elle se sentoit fort incommodée: sa voix trembloit. «Voilà comme vous faites toujours, répliqua la vieille, on n'a jamais le temps de parler à personne. Monsieur le chevalier, venez demain, vous verrez comme cela est intéressant, et qu'on a bien raison de dire qu'il faut que les jeunes personnes dorment.—Mon frère, vous permettez que je suive ma bonne amie?—Oui, ma chère Adélaïde, oui… Ayez bien soin d'elle!» Sophie, en me saluant, leva enfin les yeux; elle laissa tomber sur moi un regard douloureux qui pénétra dans mon cœur pour y éveiller le remords.
Il étoit temps de me rendre à l'invitation de M. Duportail. Après lui avoir renouvelé mes remercîmens, je lui racontai toute mon aventure, sans oublier le déjeuner de Rosambert; mais je me gardai bien de lui apprendre où notre gaieté nous avoit conduits ensuite. «Je suis bien aise, me dit-il, que M. de Rosambert, qui, d'après ses propos que vous me rendez, me paroît être un petit maître dans la force du terme, ait au moins de justes idées sur l'honneur véritable. Mon jeune ami, souvenez-vous bien que, de toutes les lois de votre pays, celle qui défend le duel est la plus respectable. Dans ce siècle de lumières et de philosophie, la férocité des courages s'est beaucoup adoucie. Combien l'heureuse révolution qui s'est faite à cet égard dans les esprits a déjà épargné de sang à la nation et de larmes aux pères de famille! Quant aux femmes, il paroît, en effet, que le comte ne les estime point; si ce n'est que par air, et à l'exemple de tant de jeunes gens comme lui, qu'il affecte pour elles ce profond mépris, que peut-être il n'a pas, je le plains; je le plains davantage s'il n'a jamais connu que des femmes mésestimables. Faublas, croyez-en mon expérience, plus longue que celle du comte, qui croit à vingt-deux ans avoir beaucoup vu; croyez-en mon jugement plus exercé, mes observations plus réfléchies: si l'on rencontre dans le monde quelques femmes sans pudeur, on y voit beaucoup plus de jeunes gens sans principes. Gardez-vous d'écouter les vieilles déclamations de ces petits messieurs-là: il existe des femmes dont les chastes attraits doivent inspirer l'amour tendre et pur; dont le cœur délicat est fait pour le sentir, qui s'attirent nos hommages par leur caractère aimable, et nos respects par leurs douces vertus. On rencontre moins rarement qu'on ne le dit des amantes généreuses, des épouses sages, d'excellentes mères de famille: il y en a, mon ami, qui verseroient leur sang pour le bonheur de leurs maris et de leurs enfans; j'en ai connu qui, réunissant aux paisibles vertus de leur sexe les vertus plus mâles du nôtre, ont donné à des hommes dignes d'elles l'exemple d'un généreux dévouement, les leçons difficiles d'un courage infatigable et d'une patience à toute épreuve. Votre marquise n'est point une héroïne, ajouta-t-il en souriant; c'est une femme bien jeune, bien imprudente… Mon ami, ayez plus de raison qu'elle, terminez cette aventure dangereuse; quelle que soit la crédulité du mari, il ne faut qu'un événement imprévu pour la détruire: promettez-moi de ne plus retourner chez Mme de B…» J'hésitois, M. Duportail me pressa, d'ailleurs, en faisant l'éloge des femmes; il m'avoit rappelé ma Sophie; je finis par promettre tout ce qu'il voulut.
«Maintenant, me dit-il, j'ai des secrets importans à vous révéler; quand vous m'aurez entendu, vous sentirez qu'il faut répondre à ma grande confiance par une inviolable discrétion.»
Mon histoire offre un exemple effrayant des vicissitudes de la fortune. Il est ordinairement très commode, mais quelquefois aussi très dangereux, d'avoir un ancien nom à soutenir et de grands biens à conserver. Unique rejeton d'une famille illustre dont l'origine se perd dans la nuit des temps, je devrois occuper dans mon pays les premières charges de l'État, et je me vois condamné à languir à jamais sous un ciel étranger, dans une oisive obscurité. Le nom de Lovzinski est honorablement inscrit dans les fastes de la Pologne, et ce nom va périr en moi! Je sais que l'austère philosophie rejette ou méprise les titres vains et les richesses corruptrices; peut-être me consolerois-je, si je n'avois perdu que cela; mais, mon jeune ami, je pleure une épouse adorée, je cherche une fille chérie, et je ne reverrai jamais ma patrie. Quel courage assez endurci pourrois-je opposer à de pareilles douleurs?
Mon père, Lovzinski, encore plus distingué par ses vertus que par son rang, jouissoit à la cour de cette considération qui suit toujours la faveur du prince, et que le mérite personnel obtient quelquefois. Il donnoit à l'éducation de mes deux sœurs l'attention d'un père tendre; il s'occupoit surtout de la mienne avec le zèle d'un vieux gentilhomme jaloux de l'honneur de sa maison dont j'étois l'unique espoir, avec l'activité d'un bon citoyen qui ne désiroit rien tant que de laisser à l'État un successeur digne de lui.
Je faisois mes exercices à Varsovie; là se distinguoit entre nous, par les qualités les plus aimables, le jeune M. de P… Aux charmes d'une figure à la fois douce et noble, il joignoit les agrémens d'un esprit heureusement cultivé; l'adresse peu commune qu'il déployoit dans nos jeux guerriers, la modestie plus rare avec laquelle il paroissoit vouloir cacher son mérite à ses propres yeux, pour exalter le mérite moins recommandable de ses rivaux presque toujours vaincus; l'urbanité de ses mœurs, la douceur de son caractère, fixoient l'attention, commandoient l'estime, et le rendoient cher à cette brillante jeunesse qui partageoit nos travaux et nos plaisirs. Dire que ce fut la ressemblance des caractères et la sympathie des humeurs qui commencèrent ma liaison avec M. de P…, ce seroit me louer beaucoup; quoi qu'il en soit, nous vécûmes bientôt tous deux dans une intime familiarité.
Qu'il est heureux, mais qu'il s'écoule rapidement cet âge où l'on ignore et l'ambition qui sacrifie tout aux idées de fortune et de gloire dont elle est possédée, et l'amour dont le pouvoir suprême absorbe et concentre toutes nos facultés sur un seul objet; cet âge des plaisirs innocens et de la crédulité confiante, où le cœur, novice encore, suit librement les impulsions de sa sensibilité naissante, et se donne sans partage à l'objet de ses affections désintéressées! Alors, mon cher Faublas, alors l'amitié n'est pas un vain nom. Confident de tous les secrets de M. de P…, je n'entreprenois rien dont je ne l'instruisisse d'abord; ses conseils régloient ma conduite, les miens déterminoient ses résolutions, et, par cette douce réciprocité, notre adolescence n'avoit point de plaisirs qui ne fussent partagés, point de peines qui ne se trouvassent adoucies. Avec quel chagrin je vis arriver le moment fatal où M. de P…, forcé par les ordres paternels de quitter Varsovie, me fit ses tendres adieux! Nous nous promîmes de nous conserver, dans tous les temps, ce vif attachement qui avoit fait le bonheur de notre adolescence; je jurai témérairement que les passions d'un autre âge ne l'altéreroient jamais. Quel vide immense laissa dans mon cœur l'absence de mon ami! D'abord il me sembla que rien ne pouvoit me dédommager de sa perte; la tendresse d'un père, les caresses de mes sœurs, ne me touchoient que foiblement. Je sentis qu'il ne me restoit, pour chasser l'ennui, d'autre moyen que d'occuper mes loisirs de quelque travail utile; j'appris la langue françoise, déjà répandue dans toute l'Europe; je lus avec délices des ouvrages fameux, éternels monumens du génie, et j'admirai comment, dans un idiome aussi ingrat, avoient pu se distinguer à ce point tant de poètes célèbres, tant d'excellens écrivains justement immortalisés. Je m'appliquai sérieusement à l'étude de la géométrie, je me formai surtout à ce noble métier qui fait un héros aux dépens de cent mille malheureux, et que des hommes moins humains que vaillans ont appelé le grand art de la guerre. Plusieurs années furent employées à ces études aussi difficiles qu'approfondies; enfin, elles m'occupèrent uniquement. M. de P…, qui m'écrivoit souvent, ne recevoit plus que des réponses courtes et rares; notre correspondance languissoit négligée, lorsqu'enfin l'amour acheva de me faire oublier l'amitié.
Mon père étoit depuis longtemps lié très étroitement avec le comte Pulauski. Connu par l'austérité de ses mœurs rigides, fameux par l'inflexibilité de ses vertus vraiment républicaines, Pulauski, à la fois grand capitaine et brave soldat, avoit signalé dans plus d'une rencontre son bouillant courage et son patriotisme ardent. Nourri de la lecture des anciens, il avoit puisé dans leur histoire les grandes leçons d'un noble désintéressement, d'une inébranlable constance, d'un dévouement absolu. Comme ces héros à qui Rome idolâtre et reconnoissante éleva des autels, Pulauski eût sacrifié tous ses biens à la prospérité de son pays, il eût versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour sa défense, il eût même immolé sa fille unique, sa chère Lodoïska.
Lodoïska! qu'elle étoit belle! que je l'aimai! son nom chéri est toujours sur mes lèvres, son image adorée vit encore dans mon cœur.
Mon ami, dès que je l'eus vue, je ne vis plus qu'elle, j'abandonnai mes études, l'amitié fut entièrement oubliée, je consacrai tous mes momens à Lodoïska. Mon père et le sien n'avoient pu longtemps ignorer mon amour; ils ne m'en parloient pas, ils l'approuvoient donc? Cette idée me parut assez fondée pour que je me livrasse sans inquiétude au doux penchant qui m'entraînoit, je pris mes mesures de manière que je voyois presque tous les jours Lodoïska ou chez elle, ou chez mes sœurs qu'elle aimoit beaucoup. Deux années se passèrent ainsi.
Enfin Pulauski me tira un jour à l'écart, et me dit: «Ton père et moi nous avions fondé sur toi de grandes espérances, que ta conduite avoit d'abord justifiées; je t'ai vu longtemps employer ta jeunesse à des travaux aussi honorables qu'utiles. Aujourd'hui… (Il vit que j'allois l'interrompre, et m'en empêcha.) Que vas-tu me dire? Crois-tu m'apprendre quelque chose que j'ignore? crois-tu que j'avois besoin d'être chaque jour témoin de tes transports pour sentir combien ma Lodoïska mérite d'être aimée? C'est parce que je sais aussi bien que toi ce que vaut ma fille que tu ne l'obtiendras qu'en la méritant. Jeune homme, apprends qu'il ne suffit pas que des foiblesses soient légitimes pour être excusées; que celles d'un bon citoyen doivent tourner toutes au profit de sa patrie; que l'amour, l'amour même, ne seroit, comme toutes les viles passions, que méprisable ou dangereux, s'il n'offroit aux cœurs généreux un motif de plus qui les excitât puissamment à l'honneur. Écoute: notre monarque valétudinaire semble toucher à sa fin; sa santé, chaque jour plus chancelante, a réveillé l'ambition de nos voisins; ils se préparent sans doute à semer parmi nous les divisions; ils comptent, en forçant nos suffrages, nous donner un roi de leur choix. Des troupes étrangères ont osé se montrer sur les frontières de la Pologne; déjà deux mille gentilshommes se rassemblent pour réprimer leur insolente audace; va te joindre à cette brave jeunesse; va, et surtout, à la fin de la campagne, reviens, couvert du sang de nos ennemis, montrer à Pulauski un gendre digne de lui.»
Je n'hésitai pas un moment: mon père approuva mes résolutions; mais il ne parut consentir qu'avec peine à mon départ précipité. Il me tint longtemps pressé contre son sein, une tendre sollicitude étoit peinte dans ses regards, il ne m'adressa que de tristes adieux; le trouble de son cœur passa dans le mien, nos pleurs se confondirent sur son visage vénérable. Pulauski, présent à cette scène touchante, nous reprocha stoïquement ce qu'il appeloit une foiblesse. «Sèche tes pleurs, me dit-il, ou garde-les pour Lodoïska; ce n'est qu'à de foibles amans qui se séparent pour six mois qu'il appartient d'en répandre.» Il instruisit sa fille, en ma présence même, et de mon départ et des motifs qui me déterminoient. Lodoïska pâlit, soupira, regarda son père en rougissant, et m'assura d'une voix tremblante que ses vœux hâteroient mon retour, et que son bonheur étoit dans mes mains. Encouragé de cette sorte, quels dangers pouvois-je craindre? Je partis; mais, dans le cours de cette campagne, il ne se passa rien qui mérite d'être rapporté; les ennemis, aussi soigneux que nous d'éviter une action qui eût pu produire entre les deux nations une guerre ouverte, se contentèrent de nous fatiguer par des marches fréquentes; nous nous bornâmes à les suivre et à les observer; ils nous rencontroient partout où le pays ouvert leur eût offert un accès facile. Aux approches de la mauvaise saison, ils parurent se retirer chez eux pour y prendre leurs quartiers d'hiver, et notre petite armée, presque toute composée de gentilshommes, se sépara. Je revenois à Varsovie, plein d'impatience et de joie, je croyois que l'hymen et l'amour alloient me donner Lodoïska… Hélas! je n'avois plus de père! J'appris, en entrant dans la capitale, que, la veille même, Lovzinski étoit mort d'une apoplexie. Ainsi, je n'eus pas même la douloureuse consolation de recevoir les derniers soupirs du plus tendre des pères! je ne pus que me traîner sur sa tombe, que j'arrosai de mes pleurs.
«Ce n'est point, me dit Pulauski, peu touché de ma douleur profonde, ce n'est point par des larmes stériles qu'on honore la mémoire d'un père tel que le tien. La Pologne regrette en lui un héros citoyen, qui l'auroit utilement servie dans la circonstance critique à laquelle nous touchons. Épuisé par une maladie longue, notre monarque n'a pas quinze jours à vivre, et du choix de son successeur dépend le bonheur ou le malheur de nos concitoyens. De tous les droits que la mort de ton père te transmet, le plus beau, sans doute, est d'assister aux états où tu vas le représenter; c'est là qu'il doit revivre en toi, c'est là qu'il faut prouver un courage plus difficile que celui qui ne consiste qu'à braver la mort dans les combats. La vaillance d'un soldat n'est qu'une vertu commune; mais ceux-là ne sont pas des hommes ordinaires, qui, conservant dans les occasions pressantes un courage tranquille et déployant une activité pénétrante, découvrent les projets du puissant qui cabale, déconcertent les sourdes intrigues, affrontent les factions hardies; qui, toujours fermes, incorruptibles et justes, ne donnent leur suffrage qu'à celui qu'ils en ont jugé le plus digne, ne considèrent que le bien de leur pays; que l'or et les promesses ne peuvent séduire; que les prières ne sauroient fléchir, que les menaces n'étonnent pas. Voilà les vertus qui distinguoient ton père; voilà l'héritage vraiment précieux que tu dois t'empresser à recueillir. Le jour où nos états s'assemblent pour l'élection d'un roi est l'époque certaine à laquelle se manifestent les prétentions de plusieurs concitoyens, plus occupés de leur intérêt personnel que jaloux de la prospérité de leur patrie, et les desseins pernicieux des puissances voisines, dont la cruelle politique détruit nos forces en les divisant. Mon ami, je me trompe, ou le moment fatal approche qui va fixer à jamais les destins de mon pays menacé; ses ennemis conspirent sa ruine, ils ont préparé dans le silence une révolution qu'ils ne consommeront pas tant que mon bras pourra soutenir une épée. Veuille le Dieu protecteur de mon pays lui épargner les horreurs d'une guerre civile! Mais cette extrémité, quelque affreuse qu'elle soit, deviendra peut-être nécessaire; je me flatte qu'au moins ce ne sera qu'une crise violente, après laquelle cet État régénéré reprendra son antique splendeur. Tu seconderas mes efforts, Lovzinski; les foibles intérêts de l'amour doivent tous disparoître devant des intérêts plus sacrés: je ne puis te donner ma fille dans ces momens de deuil, où la patrie est en danger; mais je te promets que les premiers jours de la paix seront marqués par ton hymen avec Lodoïska.»
Pulauski ne parla pas en vain; je sentis quels devoirs plus essentiels j'avois désormais à remplir; mais les soins importans dont je m'occupois n'offrirent à ma douleur que d'insuffisantes distractions. Je l'avouerai sans rougir, la tristesse de mes sœurs, leur amitié compatissante, les caresses plus réservées, mais non moins douces, de mon amante, firent sur mon cœur ému plus d'impression que les conseils patriotiques de Pulauski. Je vis Lodoïska vivement touchée de ma perte irréparable, aussi affligée que moi des événemens cruels qui différoient notre union; et mes chagrins ainsi partagés se trouvèrent sensiblement adoucis.
Cependant le roi mourut, et la diète fut convoquée. Le jour même qu'elle devoit s'ouvrir, à l'instant où j'allois m'y rendre, un inconnu se présente dans mon palais et demande à me parler sans témoins. Dès que mes gens se sont retirés, il entre avec précipitation, se jette dans mes bras et m'embrasse tendrement. C'étoit M. de P…; dix années écoulées depuis notre séparation ne l'avoient pas tellement changé que je ne pusse le reconnoître; je lui témoignai la surprise et la joie que me causoit son retour inattendu. «Vous serez bien plus étonné, me dit-il, quand vous en saurez la cause. J'arrive à l'instant et vais me rendre à l'assemblée des états; est-ce trop présumer de votre amitié que de compter sur votre voix?—Sur ma voix! et pour qui?—Pour moi, mon ami.» Il vit mon étonnement. «Oui, pour moi, continua-t-il avec vivacité; il n'est pas temps de vous raconter quelle heureuse révolution s'est faite dans ma fortune et me permet de nourrir de si hautes espérances; qu'il vous suffise maintenant de savoir que du moins mon ambition est justifiée par le plus grand nombre des suffrages et qu'en vain deux foibles rivaux se préparent à me disputer la couronne à laquelle je prétends. Lovzinski, poursuivit-il en m'embrassant encore, si vous n'étiez pas mon ami, si je vous estimois moins, peut-être m'efforcerois-je de vous éblouir par de grandes promesses, peut-être vous montrerois-je quelle faveur vous attend, que d'honorables distinctions vous sont réservées, quelle noble et vaste carrière va désormais vous être ouverte; mais je n'ai pas besoin de vous séduire, et je vais vous persuader. Je le vois avec douleur, et vous le savez comme moi, depuis plusieurs années notre Pologne affoiblie ne doit son salut qu'à la mésintelligence des trois puissances qui l'environnent; et le désir de s'enrichir de nos dépouilles peut réunir en un moment nos ennemis divisés. Empêchons, s'il se peut, ce triumvirat funeste, dont le démembrement de nos provinces deviendroit l'infaillible suite. Sans doute, en des temps plus heureux, nos ancêtres ont dû maintenir la liberté des élections; il faut aujourd'hui céder à la nécessité qui nous presse. La Russie protégera nécessairement un roi qui sera son ouvrage: en recevant celui qu'elle a choisi, vous prévenez la triple alliance qui rendroit notre perte inévitable et vous vous assurez un allié puissant, que nous opposerons avec succès aux deux ennemis qui nous restent. Voilà les raisons qui m'ont déterminé; je n'abandonne une partie de mes droits que pour conserver nos droits les plus précieux; je ne veux monter sur un trône chancelant que pour l'affermir par une saine politique; je n'altère enfin la constitution de cet État que pour sauver l'État entier.»
Nous nous rendîmes à la diète; j'y votai pour M. de P… Il obtint en effet le plus grand nombre des suffrages; mais Pulauski, Zaremba et quelques autres se déclarèrent pour le prince C…: on ne put rien décider dans le tumulte de cette première assemblée.
Quand nous en sortîmes, M. de P… revint à moi; il m'invita à le suivre dans le palais que des émissaires secrets lui avoient déjà préparé dans la capitale[5]. Nous nous enfermâmes pendant plusieurs heures: alors se renouvelèrent entre nous les protestations d'une amitié toujours durable; alors j'instruisis M. de P… de mes liaisons intimes avec Pulauski et de mon amour pour Lodoïska. Il répondit à ma confiance par une confiance plus grande; il m'apprit quels événemens avoient préparé sa grandeur prochaine, il m'expliqua ses desseins secrets, et je le quittai convaincu qu'il étoit moins occupé du désir de s'élever que de celui de rendre à la Pologne son antique prospérité.
[5] La diète pour l'élection des rois de Pologne se tient à une demi-lieue de Varsovie, en pleine campagne, de l'autre côté de la Vistule, près du village de Vola.
Ainsi disposé, je volai chez mon futur beau-père, que je brûlois de ramener au parti de mon ami. Pulauski se promenoit à grands pas dans l'appartement de sa fille, qui paroissoit aussi agitée que lui. «Le voilà, dit-il à Lodoïska, dès qu'il me vit paroître, le voilà, dit-il, cet homme que j'estimois et que vous aimiez! il nous sacrifie tous deux à son aveugle amitié.» Je voulus répondre, il poursuivit: «Vous avez été lié dès l'enfance avec M. de P…, une faction puissante le porte sur le trône, vous le saviez, vous saviez ses desseins; ce matin, à la diète, vous avez voté pour lui, vous m'avez trompé; mais croyez-vous qu'on me trompe impunément?» Je le priai de m'entendre; il se contraignit pour garder un silence farouche; je lui appris comment M. de P…, que j'avois négligé depuis longtemps, m'avoit surpris par son retour imprévu. Lodoïska paroissoit charmée d'entendre ma justification. «On ne m'abuse pas comme une femme crédule, me dit Pulauski; mais, n'importe, continuez.» Je lui rendis compte du court entretien que j'avois eu avec M. de P… avant de me rendre à l'assemblée des états. «Et voilà vos projets! s'écria-t-il. M. de P… ne voit d'autre remède aux maux de ses concitoyens que leur esclavage! il le propose, un Lovzinski l'approuve! et l'on me méprise assez pour tenter de me faire entrer dans cet infâme complot! Moi, je verrois, sous le nom d'un Polonois, les Russes commander dans nos provinces! Les Russes! répéta-t-il avec fureur, ils régneroient dans mon pays! (Il vint à moi avec la plus grande impétuosité.) Perfide! tu m'as trompé, et tu trahis ta patrie! Sors de ce palais à l'instant, ou crains que je ne t'en fasse arracher.»
Je vous l'avoue, Faublas, un affront si cruel et si peu mérité me mit hors de moi-même: dans le premier transport de ma colère, je portai la main sur mon épée; plus prompt que l'éclair, Pulauski tira la sienne. Sa fille, sa fille éperdue se précipita sur moi: «Lovzinski, qu'allez-vous faire?» Aux accens de sa voix si chère, je repris ma raison égarée; mais je sentis qu'un seul instant venoit de m'enlever Lodoïska pour toujours. Elle m'avoit quitté pour se jeter dans les bras de son père; le cruel vit ma douleur amère, et se plut à l'augmenter. «Va! traître, me dit-il, va! tu la vois pour la dernière fois.»
Je retournai chez moi désespéré; les noms odieux que Pulauski m'avoit prodigués revenoient sans cesse à ma pensée; les intérêts de la Pologne et ceux de M. de P… me paroissoient si étroitement liés que je ne concevois pas comment je pouvois trahir mes concitoyens en servant mon ami; cependant il falloit l'abandonner, ou renoncer à Lodoïska: que résoudre? quel parti prendre? Je passai la nuit tout entière dans cette cruelle incertitude; et, quand le jour parut, j'allai chez Pulauski, sans savoir encore à quoi je pourrois me déterminer.
Un domestique, resté seul dans le palais, me dit que son maître étoit parti au commencement de la nuit avec Lodoïska, après avoir congédié tous ses gens. Vous jugez de mon désespoir à cette nouvelle. Je demandai à ce domestique où Pulauski étoit allé. «Je l'ignore absolument, me répondit-il; tout ce que je puis vous dire, c'est qu'hier au soir, vous sortiez à peine d'ici, quand nous entendîmes un grand bruit dans l'appartement de sa fille. Encore effrayé de la scène terrible qui venoit de se passer entre vous, j'osai m'approcher et prêter l'oreille. Lodoïska pleuroit, son père furieux l'accabloit d'injures, lui donnoit sa malédiction, et je l'entendis qui lui disoit: «Qui peut aimer un traître peut l'être aussi: ingrate, je vais vous conduire dans une maison sûre, où vous serez désormais à l'abri de la séduction.»
Pouvois-je encore douter de mon malheur? J'appelai Boleslas, un de mes serviteurs les plus fidèles; je lui ordonnai de placer autour du palais de Pulauski des espions vigilans qui pussent me rendre compte de tout ce qui s'y seroit passé, de faire suivre Pulauski partout s'il rentroit avant moi dans la capitale; et, ne désespérant pas de le rencontrer encore dans ses terres les plus prochaines, je me mis moi-même à sa poursuite.
Je parcourus tous les domaines de Pulauski, je demandai Lodoïska à tous les voyageurs que je rencontrai: ce fut inutilement. Après avoir perdu huit jours dans cette recherche pénible, je me décidai à retourner à Varsovie. Je ne fus pas médiocrement étonné de voir une armée russe campée presque sous ses murs, sur les bords de la Vistule.
Il étoit nuit quand je rentrai dans la capitale; les palais des grands étoient illuminés, un peuple immense remplissoit les rues; j'entendis les chants d'allégresse, je vis le vin couler à grands flots dans les places publiques, tout m'annonça que la Pologne avoit un roi.
Boleslas m'attendoit avec impatience. «Pulauski, me dit-il, est revenu seul dès le second jour; il n'est sorti de chez lui que pour se rendre à la diète, où, malgré ses efforts, l'ascendant de la Russie s'est manifesté chaque jour de plus en plus. Dans la dernière assemblée tenue ce matin, M. de P… réunissoit presque toutes les voix, il alloit être élu; Pulauski a prononcé le fatal veto: à l'instant vingt sabres ont été tirés. Le fier palatin de …, que Pulauski avoit peu ménagé dans l'assemblée précédente, s'est élancé le premier, et lui a porté sur la tête un coup terrible. Zaremba et quelques autres ont volé à la défense de leur ami; mais tous leurs efforts n'auroient pu le sauver, si M. de P… lui-même ne s'étoit rangé parmi eux, en criant qu'il immoleroit de sa main celui qui oseroit approcher. Les assaillants se sont retirés; cependant Pulauski perdoit son sang et ses forces; il s'est évanoui, on l'a emporté. Zaremba est sorti en jurant de le venger. Restés maîtres des délibérations, les nombreux partisans de M. de P… l'ont sur-le-champ proclamé roi. Pulauski, rapporté dans son palais, a bientôt repris connoissance. Les chirurgiens, appelés pour voir sa blessure, ont déclaré qu'elle n'étoit pas mortelle; alors, quoiqu'il ressentît de grandes douleurs, quoique plusieurs de ses amis s'opposassent à son dessein, il s'est fait porter dans sa voiture. Il étoit à peine midi quand il est sorti de Varsovie, accompagné de Mazeppa et de quelques mécontens. On le suit, et sans doute on viendra sous peu de jours vous apprendre le lieu qu'il aura choisi pour sa retraite.»
On ne pouvoit guère m'annoncer de plus mauvaises nouvelles. Mon ami étoit sur le trône; mais ma réconciliation avec Pulauski paroissoit désormais impossible, et vraisemblablement j'avois perdu Lodoïska pour toujours. Je connoissois assez son père pour craindre qu'il ne prît des résolutions extrêmes; le présent m'effrayoit, je n'osois porter mes regards sur l'avenir, et mes chagrins m'accablèrent au point que je n'allai pas même féliciter le nouveau roi.
Celui de mes gens que Boleslas avoit détaché à la poursuite de Pulauski revint le quatrième jour; il l'avoit suivi jusqu'à quinze lieues de la capitale: là, Zaremba, voyant toujours un inconnu à quelque distance de sa chaise de poste, avoit conçu des soupçons. Un peu plus loin, quatre de ses gens, cachés derrière une masure, avoient surpris mon courrier et l'avoient conduit à Pulauski. Celui-ci, le pistolet à la main, l'avoit forcé d'avouer à qui il appartenoit. «Je te renverrai à Lovzinski, lui avoit-il dit, annonce-lui de ma part qu'il n'échappera pas à ma juste vengeance.» A ces mots, on avoit bandé les yeux à mon courrier, il ne pouvoit dire où on l'avoit conduit et enfermé; mais au bout de trois jours on l'étoit venu chercher: on avoit encore pris la précaution de lui bander les yeux et de le promener pendant plusieurs heures; enfin la voiture s'étoit arrêtée, on l'en avoit fait descendre. A peine il mettoit pied à terre que ses gardes s'étoient éloignés au grand galop; il avoit détaché son bandeau et s'étoit retrouvé précisément à l'endroit où d'abord on l'avoit arrêté.
Ces nouvelles me donnèrent beaucoup d'inquiétude; les menaces de Pulauski m'effrayoient beaucoup moins pour moi que pour Lodoïska qui restoit en son pouvoir: il pouvoit, dans sa fureur, se porter contre elle aux dernières extrémités; je résolus de m'exposer à tout pour découvrir la retraite du père et la prison de la fille. Le lendemain j'instruisis mes sœurs de mon dessein, et je quittai la capitale: le seul Boleslas m'accompagnoit; je me donnai partout pour son frère. Nous parcourûmes toute la Pologne; je vis alors que l'événement ne justifioit que trop les craintes de Pulauski. Sous prétexte de faire prêter le serment de fidélité pour le nouveau roi, les Russes répandus dans nos provinces commettoient mille exactions dans les villes et désoloient les campagnes. Après avoir perdu trois mois en recherches vaines, désespéré de ne pouvoir retrouver Lodoïska, vivement touché des malheurs de ma patrie, pleurant à la fois sur elle et sur moi, j'allois retourner à Varsovie pour apprendre moi-même au nouveau roi à quels excès des étrangers se portoient dans ses États, lorsqu'une rencontre, qui sembloit devoir être pour moi très fâcheuse, me força de prendre un parti tout différent.
Les Turcs venoient de déclarer la guerre à la Russie, et les Tartares du Budziac et de la Crimée faisoient de fréquentes incursions dans la Volhynie, où je me trouvois alors. Quatre de ces brigands nous attaquèrent à la sortie d'un bois, près d'Ostropol. J'avois très imprudemment négligé de charger mes pistolets; mais je me servis de mon sabre avec tant d'adresse et de bonheur que bientôt deux d'entre eux tombèrent grièvement blessés. Boleslas occupoit le troisième, le quatrième me combattoit avec vigueur; il me fit à la cuisse une légère blessure, et reçut en même temps un coup terrible qui le renversa de son cheval. Boleslas se vit à l'instant débarrassé de son ennemi, qui, au bruit de la chute de son camarade, prit la fuite. Celui que j'avois renversé le dernier me dit en mauvais polonois: «Un aussi brave homme que toi doit être généreux; je te demande la vie; ami, au lieu de m'achever, secours-moi; crois-moi, viens m'aider à me relever, bande ma plaie.» Il demandoit quartier d'un ton si noble et si nouveau que je ne balançai pas: je descendis de cheval; Boleslas et moi nous le relevâmes, nous bandâmes sa plaie. «Tu fais bien, brave homme, me disoit le Tartare, tu fais bien.» Comme il parloit, nous vîmes s'élever autour de nous un nuage de poussière; plus de trois cents Tartares accouroient à nous ventre à terre. «Ne crains rien, me dit celui que j'avois épargné, je suis le chef de cette troupe.» Effectivement, d'un signe il arrêta ses soldats près de me massacrer; il leur dit dans leur langue quelques mots que je ne compris pas; ils ouvrirent leurs rangs pour laisser passer Boleslas et moi. «Brave homme, me dit encore leur capitaine, n'avois-je pas raison de te dire que tu faisois bien? tu m'as laissé la vie, je sauve la tienne; il est quelquefois bon d'épargner un ennemi, et même un voleur. Écoute, mon ami, en t'attaquant j'ai fait mon métier, tu as fait ton devoir en m'étrillant bien: je te pardonne, tu me pardonnes, embrassons-nous.» Il ajouta: «Le jour commence à baisser, je ne te conseille pas de voyager dans ces cantons cette nuit; ces gens-là vont aller chacun à son poste, et je ne pourrois te répondre d'eux. Tu vois ce château sur la hauteur à droite, il appartient à un certain comte Dourlinski, à qui nous en voulons beaucoup, parce qu'il est fort riche: va lui demander un asile, dis-lui que tu as blessé Titsikan, que Titsikan te poursuit. Il me connoît de nom: je lui ai déjà fait passer quelques mauvaises journées; au reste, compte que, pendant que tu seras chez lui, sa maison sera respectée; garde-toi surtout d'en sortir avant trois jours et d'y rester plus de huit: adieu.»
Ce fut avec un vrai plaisir que nous prîmes congé de Titsikan et de sa compagnie. Les avis du Tartare étoient des ordres; je dis à Boleslas: «Gagnons promptement ce château qu'il nous a montré; aussi bien je connois ce Dourlinski de nom. Pulauski m'a quelquefois parlé de lui; il n'ignore peut-être pas où Pulauski s'est retiré; il n'est pas impossible qu'avec un peu d'adresse nous le sachions de lui. Je dirai à tout hasard que c'est Pulauski qui nous envoie; cette recommandation vaudra bien celle de Titsikan: toi, Boleslas, n'oublie pas que je suis ton frère et ne me découvre pas.»
Nous arrivâmes aux fossés du château; les gens de Dourlinski nous demandèrent qui nous étions: je répondis que nous venions pour parler à leur maître de la part de Pulauski; que des brigands nous avoient attaqués et nous poursuivoient. Le pont-levis fut baissé, nous entrâmes; on nous dit que pour le moment nous ne pouvions parler à Dourlinski, mais que le lendemain, sur les dix heures, il pourroit nous donner audience. On nous demanda nos armes que nous rendîmes sans difficulté. Boleslas visita ma blessure, les chairs étoient à peine entamées. On ne tarda pas à nous servir dans la cuisine un frugal repas; nous fûmes conduits ensuite dans une chambre basse, où deux mauvais lits venoient d'être préparés; on nous y laissa sans lumière, et l'on nous y enferma.
Je ne pus fermer l'œil de la nuit. Titsikan ne m'avoit fait qu'une légère blessure, mais celle de mon cœur étoit si profonde! Au point du jour je m'impatientai dans ma prison; je voulus ouvrir les volets, ils étoient fermés à clef. Je les secoue vigoureusement, les ferrures sautent, je vois un fort beau parc; la fenêtre étoit basse, je m'élance, et me voilà dans les jardins de Dourlinski. Après m'y être promené quelques minutes, j'allai m'asseoir sur un banc de pierre placé au pied d'une tour dont je considérai quelque temps l'architecture antique. Je restois là plongé dans mes réflexions, lorsqu'une tuile tomba à mes pieds: je crus qu'elle s'étoit détachée de la couverture de ce vieux bâtiment, et, pour éviter un accident pareil, j'allai me placer à l'autre bout du banc. Quelques instans après, une seconde tuile tomba à côté de moi. Le hasard me parut surprenant; je me levai avec inquiétude, j'examinai la tour attentivement. J'aperçus, à vingt-cinq ou trente pieds de hauteur, une étroite ouverture; je ramassai les tuiles qu'on m'avoit jetées; sur la première, je déchiffrai ces mots tracés avec du plâtre: Lovzinski, c'est donc vous! vous vivez! et sur la seconde, ceux-ci: Délivrez-moi, sauvez Lodoïska.
Vous ne pouvez, mon cher Faublas, vous figurer combien de sentimens divers m'agitèrent à la fois; mon étonnement, ma joie, ma douleur, mon embarras, ne sauroient s'exprimer. J'examinois la prison de Lodoïska, je cherchois comment je pourrois l'en tirer; elle m'envoya encore une tuile; je lus: A minuit, apportez du papier, de l'encre et des plumes; demain, une heure après le soleil levé, venez chercher une lettre; éloignez-vous.
Je retournai à ma chambre, j'appelai Boleslas, qui m'aida à rentrer par la fenêtre; nous raccommodâmes le volet de notre mieux. J'appris à mon serviteur fidèle la rencontre inespérée qui mettoit fin à mes courses et redoubloit mes inquiétudes. Comment pénétrer dans cette tour? comment nous procurer des armes? Le moyen de tirer Lodoïska de sa prison? le moyen de l'enlever sous les yeux de Dourlinski, au milieu de ses gens, dans un château fortifié?
Et, en supposant que tant d'obstacles ne fussent pas insurmontables, pouvois-je tenter une entreprise aussi difficile dans le court délai que Titsikan m'avoit laissé? Titsikan ne m'avoit-il pas recommandé de rester chez Dourlinski trois jours, et de n'y pas demeurer plus de huit? Sortir de ce château avant le troisième jour ou après le huitième, n'étoit-ce pas nous exposer aux attaques des Tartares? Tirer ma chère Lodoïska de sa prison pour la livrer à des brigands, être à jamais séparé d'elle par l'esclavage ou par la mort, cela étoit horrible à penser.
Mais pourquoi étoit-elle dans une aussi affreuse prison? La lettre qu'elle m'avoit promise m'en instruiroit sans doute. Il falloit nous procurer du papier; je chargeai Boleslas de ce soin, et moi, je me préparai à soutenir devant Dourlinski le rôle délicat d'un émissaire de Pulauski.
Il étoit grand jour quand on vint nous mettre en liberté; on nous dit que Dourlinski pouvoit et vouloit nous voir. Nous nous présentâmes avec assurance; nous vîmes un homme de soixante ans à peu près, dont l'abord étoit brusque et les manières repoussantes. Il nous demanda qui nous étions. «Mon frère et moi, lui dis-je, appartenons au seigneur Pulauski; mon maître m'a chargé pour vous d'une commission secrète, mon frère m'a accompagné pour un autre objet; je dois, pour m'expliquer, être seul, je ne dois ne parler qu'à vous seul.—Eh bien, répondit Dourlinski, que ton frère s'en aille; et vous aussi, allez-vous-en, dit-il à ses gens; quant à celui-ci (il montra celui qui étoit son confident), tu trouveras bon qu'il reste, tu peux tout dire devant lui.—Pulauski m'envoie…—Je le vois bien qu'il t'envoie.—Pour vous demander…—Quoi?—(Je pris courage.) Pour vous demander des nouvelles de sa fille.—Des nouvelles de sa fille! Pulauski t'a dit…—Oui, mon maître m'a dit que Lodoïska étoit ici.» Je m'aperçus que Dourlinski pâlissoit; il regarda son confident, et me fixa longtemps en silence. «Tu m'étonnes, reprit-il enfin; pour te confier un secret de cette importance, il faut que ton maître soit bien imprudent.—Pas plus que vous, Seigneur; n'avez-vous pas aussi un confident? Les grands seroient bien à plaindre s'ils ne pouvoient donner leur confiance à personne. Pulauski m'a chargé de vous dire que Lovzinski avoit déjà parcouru une grande partie de la Pologne, et que sans doute il visiteroit vos cantons.—S'il ose venir ici, me répondit-il aussitôt avec la plus grande vivacité, je lui garde un logement qu'il occupera longtemps: le connois-tu ce Lovzinski?—Je l'ai vu souvent chez mon maître à Varsovie.—On le dit bel homme?—Il est bien fait et de ma taille à peu près.—Sa figure?—Est prévenante; c'est un…—C'est un insolent, interrompit-il avec colère; si jamais il tombe en mes mains!—Seigneur, on assure qu'il est brave.—Lui! je parie qu'il ne sait que séduire des filles! Si jamais il tombe en mes mains! (Je me contins; il ajouta d'un ton plus calme:) Il y a bien longtemps que Pulauski ne m'a écrit, où est-il à présent?—Seigneur, j'ai des ordres précis de ne pas répondre à cette question-là: tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il a, pour cacher sa retraite et pour n'écrire à personne, de grandes raisons qu'il viendra bientôt vous expliquer lui-même.»
Dourlinski parut très étonné; je crus même remarquer quelques signes de frayeur; il regarda son confident, qui sembloit aussi embarrassé que lui. «Tu dis que Pulauski viendra bientôt?…—Oui, Seigneur, sous quinzaine au plus tard.» Il regarda encore son confident; et puis, affectant tout à coup autant de sang-froid qu'il avoit montré d'embarras: «Retourne à ton maître, je suis fâché de n'avoir que de mauvaises nouvelles à lui donner; tu lui diras que Lodoïska n'est plus ici.» Je fus à mon tour fort surpris. «Quoi! Seigneur, Lodoïska…—N'est plus ici, te dis-je. Pour obliger Pulauski que j'estime, je me suis chargé, quoiqu'avec répugnance, du soin de garder sa fille dans mon château: personne que moi et lui (il me montra son confident) ne savoit qu'elle y fût. Il y a environ un mois, nous allâmes, comme à l'ordinaire, lui porter des vivres pour sa journée, il n'y avoit plus personne dans son appartement. J'ignore comment elle a fait; mais ce que je sais bien, c'est qu'elle s'est échappée; je n'ai pas entendu parler d'elle depuis; elle sera sans doute allée rejoindre Lovzinski à Varsovie, si pourtant les Tartares ne l'ont pas enlevée sur la route.»
Mon étonnement devint extrême: comment concilier ce que j'avois vu dans le jardin avec ce que Dourlinski me disoit? Il y avoit là quelque mystère que j'étois bien impatient d'approfondir; cependant je me gardai bien de faire paroître le moindre doute. «Seigneur, voilà des nouvelles bien tristes pour mon maître!—Sans doute, mais ce n'est pas ma faute.—Seigneur, j'ai une grâce à vous demander.—Voyons.—Les Tartares dévastent les environs de votre château; ils nous ont attaqués, nous leur avons échappé comme par miracle; ne nous accorderez-vous pas, à mon frère et à moi, la permission de nous reposer ici seulement deux jours?—Seulement deux jours? j'y consens. Où les a-t-on logés? demanda-t-il à son confident.—Au rez-de-chaussée, répondit celui-ci, dans une chambre basse…—Qui donne sur mes jardins? interrompit Dourlinski avec inquiétude.—Les volets ferment à clef, répondit l'autre.—N'importe, il faut les mettre ailleurs.» Ces mots me firent trembler. Le confident répliqua: «Cela n'est pas possible; mais…» Il lui dit le reste à l'oreille. «A la bonne heure, répondit le maître, et qu'on le fasse à l'instant»; et, s'adressant à moi: «Ton frère et toi, vous vous en irez après-demain; avant de partir tu me parleras, je te donnerai une lettre pour Pulauski.»
J'allai rejoindre Boleslas dans la cuisine, où il déjeunoit: il me remit une petite bouteille pleine d'encre, plusieurs plumes et quelques feuilles de papier qu'il s'étoit procurées sans peine. Je brûlois d'envie d'écrire à Lodoïska; l'embarras étoit de trouver un lieu commode, où les curieux ne pussent m'inquiéter. On avoit déjà prévenu Boleslas que nous ne rentrerions dans la chambre où nous avions passé la nuit que pour y coucher. Je m'avisai d'un stratagème qui me réussit parfaitement. Les gens de Dourlinski buvoient avec mon prétendu frère, ils me proposèrent poliment de les aider aussi à vider quelques flacons. J'avalai de bonne grâce, et coup sur coup, plusieurs verres d'un fort mauvais vin: bientôt mes jambes chancelèrent, ma langue s'embarrassa, je fis à la troupe joyeuse cent contes aussi plaisans que déraisonnables; en un mot, je jouai si bien l'ivresse que Boleslas lui-même en fut la dupe. Il trembloit que, dans ce moment où je paroissois disposé à tout dire, mon secret ne m'échappât. «Messieurs, dit-il aux buveurs étonnés, mon frère n'a pas la tête forte aujourd'hui, c'est peut-être un effet de sa blessure; ne le faisons plus ni parler ni boire; je crains que cela ne l'incommode; et même, si vous vouliez m'obliger, vous m'aideriez à le porter sur son lit.—Sur le sien? non, cela ne se peut pas, répondit l'un d'eux, mais je prêterai volontiers ma chambre.» On me prit, on m'entraîna, on me monta dans un grenier, dont un lit, une table et une chaise formoient tout l'ameublement. On m'enferma dans ce taudis. C'étoit là tout ce que je voulois; dès que je fus seul, j'écrivis à Lodoïska une lettre de plusieurs pages. Je commençois par me justifier pleinement des crimes que Pulauski m'avoit supposés; je lui racontai ensuite tout ce qui m'étoit arrivé depuis le moment de notre séparation jusqu'à celui où j'avois été reçu chez Dourlinski; je lui détaillois l'entretien que je venois d'avoir avec celui-ci, je finissois par l'assurer de l'amour le plus tendre et le plus respectueux; je lui jurois que, dès qu'elle m'auroit donné sur son sort les éclaircissemens nécessaires, je m'exposerois à tout pour finir son horrible esclavage.
Dès que ma lettre fut fermée, je me livrai à des réflexions qui me jetèrent dans une étrange perplexité. Étoit-ce bien Lodoïska qui m'avoit jeté ces tuiles dans le jardin? Pulauski auroit-il eu l'injustice de punir sa fille d'un amour que lui-même avoit approuvé? Auroit-il eu l'inhumanité de la plonger dans une affreuse prison? et, quand même la haine qu'il m'avoit jurée l'auroit aveuglé à ce point, comment Dourlinski avoit-il pu se résoudre à servir ainsi sa vengeance? Mais, d'un autre côté, depuis trois mois je ne portois, pour me déguiser mieux, que des habits grossiers; les fatigues d'un long voyage et mes chagrins m'avoient beaucoup changé; quelle autre qu'une amante avoit pu reconnoître Lovzinski dans les jardins de Dourlinski? n'avois-je pas vu d'ailleurs le nom de Lodoïska tracé sur la tuile? Dourlinski lui-même n'avouoit-il pas que Lodoïska avoit été chez lui prisonnière? Il ajoutoit, il est vrai, qu'elle s'étoit échappée; mais cela étoit-il croyable? Et pourquoi cette haine que Dourlinski m'avoit vouée à moi, sans me connoître? Pourquoi cet air d'inquiétude, quand on lui avoit dit que les émissaires de Pulauski occupoient une chambre qui donnoit sur le jardin? Pourquoi surtout cet air d'effroi, quand je lui avois annoncé la prochaine arrivée de mon prétendu maître? Tout cela étoit bien fait pour me donner de terribles inquiétudes, j'entrevoyois des choses affreuses que je ne pouvois expliquer. Depuis deux heures je me faisois sans cesse de nouvelles questions, auxquelles j'étois fort embarrassé de répondre, lorsqu'enfin Boleslas vint voir si son frère avoit recouvré la raison. Je n'eus pas de peine à le convaincre que mon ivresse avoit été feinte; nous descendîmes dans la cuisine, où nous passâmes le reste de la journée. Quelle soirée, mon cher Faublas! aucune de ma vie ne me parut si longue, pas même celles qui la suivirent.
Enfin, l'on nous conduisit dans notre chambre, où l'on nous enferma, comme la veille, sans nous laisser de lumière; il fallut encore attendre près de deux heures avant que minuit sonnât. Au premier coup de la cloche nous ouvrîmes doucement les volets et la fenêtre; je me préparois à sauter dans le jardin, mon embarras fut égal à mon désespoir quand je me vis retenu par des barreaux. «Voilà, dis-je à Boleslas, ce que le maudit confident de Dourlinski lui disoit à l'oreille; voilà ce qu'approuvoit le maître odieux, quand il répondit: A la bonne heure, et qu'on le fasse à l'instant; voilà ce qu'ils ont exécuté dans la journée; c'est pour cela que l'entrée de cette chambre nous a été interdite.—Seigneur, ils ont travaillé en dehors, me répondit Boleslas, car ils n'ont pas aperçu que ce volet avoit été forcé.—Eh! qu'ils l'aient vu ou non, m'écriai-je avec violence, que m'importe? Cette grille fatale renverse toutes mes espérances, elle assure l'esclavage de Lodoïska, elle assure ma mort.
—Oui, sans doute, elle assure ta mort», me cria-t-on en ouvrant ma porte. Dourlinski, précédé de quelques hommes armés et suivi de quelques autres qui portoient des flambeaux, Dourlinski entra le sabre à la main. «Traître, me dit-il en me lançant des regards où sa fureur étoit peinte, j'ai tout entendu, je saurai qui tu es, tu me diras ton nom, ton prétendu frère le dira; tremble! je suis de tous les ennemis de Lovzinski le plus implacable! Qu'on le fouille», dit-il à ses gens; ils se précipitèrent sur moi, j'étois sans armes, je fis une résistance inutile. Ils m'enlevèrent mes papiers et la lettre que j'avois préparée pour Lodoïska. Dourlinski donna, en la lisant, mille signes d'impatience: il y étoit peu ménagé. «Lovzinski, me dit-il avec une rage étouffée, je mérite déjà toute ta haine, bientôt je la mériterai davantage; en attendant tu resteras avec ton digne confident dans cette chambre que tu aimes.» A ces mots il sortit, on ferma la porte à double tour; il posa une sentinelle en dehors et une autre vis-à-vis des fenêtres, dans le jardin.
Vous vous figurez dans quel accablement nous restâmes plongés, Boleslas et moi. Mes malheurs étoient à leur comble, ceux de Lodoïska m'affectoient bien plus vivement: l'infortunée! quelle devoit être son inquiétude! elle attendoit Lovzinski, et Lovzinski l'abandonnoit! Mais non, Lodoïska me connoissoit trop bien, elle ne me soupçonneroit pas d'une aussi lâche perfidie. Lodoïska! elle jugeroit son amant d'après elle! Elle sentiroit que Lovzinski partageoit son sort, puisqu'il ne la secouroit pas… hélas! et la certitude de mon malheur augmenteroit encore le sien!
Telles furent dans le premier moment mes réflexions cruelles; on me laissa tout le temps d'en faire beaucoup d'autres non moins tristes. Le lendemain on nous passa par les barreaux de notre fenêtre les provisions pour notre journée. A la qualité des alimens qu'on nous fournissoit, Boleslas jugea qu'on ne chercheroit pas à nous rendre notre prison fort agréable. Boleslas, moins malheureux que moi, supportoit son sort plus courageusement; il m'offrit ma part du maigre repas qu'il alloit faire. Je ne voulois point manger, il me pressoit vainement; l'existence étoit devenue pour moi un insupportable fardeau. «Ah! vivez, me dit-il enfin en versant un torrent de larmes, vivez! si ce n'est pas pour Boleslas, que ce soit pour Lodoïska.» Ces mots firent sur moi la plus vive impression, ils ranimèrent mon courage, l'espérance rentra dans mon cœur, j'embrassai mon serviteur fidèle. «O mon ami, m'écriai-je avec transport, ô mon véritable ami! je t'ai perdu, et tes maux me touchent plus que les miens! donne, Boleslas, donne, je vivrai pour Lodoïska, je vivrai pour toi: veuille le juste Ciel me rendre bientôt ma fortune et mon rang! tu verras que ton maître n'est pas un ingrat.» Nous nous embrassâmes encore. Ah! mon cher Faublas, si vous saviez comme le malheur rapproche les hommes! comme il est doux, lorsqu'on souffre, d'entendre un autre infortuné vous adresser un mot de consolation!
Il y avoit douze jours que nous gémissions dans cette prison, lorsqu'on vint m'en tirer pour me conduire à Dourlinski. Boleslas voulut me suivre, on le repoussa durement; cependant on me permit de lui parler un moment. Je tirai de mon doigt une bague que je portois depuis plus de dix ans; je dis à Boleslas: «Cette bague me fut donnée par M. de P…, lorsque nous faisions ensemble nos exercices à Varsovie; prends-la, mon ami, conserve-la à cause de moi. Si Dourlinski consomme aujourd'hui sa trahison en me faisant assassiner, s'il te permet ensuite de sortir de ce château, va trouver ton roi, montre-lui ce bijou, rappelle-lui notre ancienne amitié, raconte-lui mes malheurs, Boleslas, il te récompensera, il fera secourir Lodoïska. Adieu, mon ami.»
On me conduisit à l'appartement de Dourlinski; dès que la porte s'entr'ouvrit, j'aperçus dans un fauteuil une femme évanouie; j'approchai, c'étoit Lodoïska! Dieu! que je la trouvai changée!… mais qu'elle étoit belle encore! «Barbare!» dis-je à Dourlinski. A la voix de son amant, Lodoïska reprit ses sens. «Ah! mon cher Lovzinski, sais-tu ce que l'infâme me propose? sais-tu à quel prix il m'offre ta liberté?—Oui, s'écria Dourlinski furieux, oui, je le veux: te voilà bien sûre qu'il est en mon pouvoir; si dans trois jours je n'obtiens rien, dans trois jours il est mort.» Je voulois me jeter aux genoux de Lodoïska; mes gardes m'en empêchèrent. «Je vous revois enfin, tous mes maux sont oubliés, Lodoïska, la mort n'a plus rien qui m'épouvante… Toi, lâche, songe que Pulauski vengera sa fille, songe que le roi vengera son ami.—Qu'on l'emmène! s'écria Dourlinski.—Ah! me dit Lodoïska, mon amour t'a perdu.» Je voulois répondre, on m'entraîna, on me reconduisit dans ma prison. Boleslas me reçut avec des transports de joie inexprimables; il m'avoua qu'il m'avoit cru perdu: je lui racontai comment ma mort n'étoit que différée. La scène dont je venois d'être témoin avoit enfin confirmé mes soupçons: il étoit clair que Pulauski ignoroit les mauvais traitemens que sa fille essuyoit; il étoit clair que Dourlinski, amoureux et jaloux, satisferoit sa passion à quelque prix que ce fût.
Cependant, des trois jours que Dourlinski avoit laissés à Lodoïska pour se déterminer, deux déjà s'étoient écoulés, nous étions au milieu de la nuit qui précédoit le troisième; je ne pouvois dormir et me promenois dans ma chambre à grands pas. Tout à coup j'entends crier: Aux armes! des hurlemens affreux s'élèvent de toutes parts autour du château, il se fait un grand mouvement dans l'intérieur; la sentinelle posée devant nos fenêtres quitte son poste; Boleslas et moi nous distinguons la voix de Dourlinski; il appelle, il encourage ses gens; nous entendons distinctement le cliquetis des armes, les plaintes des blessés, les gémissemens des mourans. Le bruit, d'abord très grand, semble diminuer; il recommence ensuite, il se prolonge, il redouble, on crie victoire! beaucoup de gens accourent et ferment les portes sur eux avec force. Tout à coup à ce vacarme affreux succède un silence effrayant; bientôt un bruissement sourd frappe nos oreilles, l'air siffle avec violence, la nuit devient moins sombre, les arbres du jardin se colorent d'une teinte jaune et rougeâtre; nous volons à la fenêtre: les flammes dévoroient le château de Dourlinski, elles gagnoient de tous côtés la chambre où nous étions, et, pour comble d'horreur, des cris perçans partoient de la tour où je savois que Lodoïska étoit enfermée.
Ici M. Duportail fut interrompu par le marquis de B…, qui, n'ayant trouvé aucun laquais dans l'antichambre, entra sans avoir été annoncé; il recula deux pas en me voyant. «Ah! ah! dit-il en saluant M. Duportail, c'est que vous avez aussi un fils?» puis s'adressant à moi: «Monsieur est apparemment le frère…—De ma sœur, oui, Monsieur.—Eh bien, vous avez une sœur fort aimable, charmante, mais charmante!—Vous êtes aussi honnête qu'indulgent, interrompit M. Duportail.—Indulgent! oh! je ne le suis pas toujours; par exemple, je suis venu pour vous faire des reproches à vous, Monsieur…—A moi! aurois-je eu le malheur…?—Oui, vous nous avez joué avant-hier un tour sanglant.—Comment, Monsieur?—Vous avez chargé ce petit Rosambert de nous enlever Mlle Duportail; la marquise comptoit bien que sa chère fille passeroit la nuit chez elle; point du tout.—J'ai craint, Monsieur, que ma fille ne vous causât beaucoup d'embarras.—Aucun, aucun, Monsieur; Mlle Duportail est charmante, ma femme raffole d'elle, je vous l'ai déjà dit. En vérité, ajouta-t-il en ricanant, je crois que la marquise aime cette enfant-là plus qu'elle ne m'aime moi-même; je suis pourtant son mari!… Au moins si vous étiez venu vous-même la chercher!—Pardon, Monsieur, j'étois incommodé, je le suis même encore beaucoup… Je sais que je dois à Mme de B… des remercîmens…—Ce n'est pas pour cela! (Pendant ce dialogue, on sent que je n'étois pas tout à fait à mon aise: le marquis me considéroit avec une attention qui m'inquiétoit.) Savez-vous bien, me dit-il enfin, que vous ressemblez beaucoup à mademoiselle votre sœur?—Monsieur, vous me flattez.—Mais c'est que cela est frappant: allez, allez, je m'y connois bien; d'abord tous mes amis conviennent que je suis physionomiste; je vous le demande à vous-même, je ne vous avois jamais vu, et je vous ai reconnu tout de suite!»

M. Duportail ne put s'empêcher de rire avec moi de la bonne foi du marquis. «Monsieur, dit-il à celui-ci, c'est que, comme vous l'avez fort bien remarqué, mon fils et ma fille se ressemblent un peu; il faut convenir qu'il y a un air de famille.—Oui, répondit le marquis en me regardant toujours, ce jeune homme est bien, fort bien; mais sa sœur est encore mieux, beaucoup mieux (il me prit par le bras). Elle est un peu plus grande, elle a l'air plus raisonnable, quoiqu'elle soit un peu espiègle; c'est bien là sa figure, mais il y a dans vos traits quelque chose de plus hardi. Vous avez moins de grâces dans le maintien, et dans toute l'habitude du corps quelque chose de plus… nerveux, de plus roide. Oh! dame, n'allez pas vous fâcher, tout cela est bien naturel; il ne faut pas qu'un garçon soit fait comme une fille! (Le flegme de M. Duportail ne put tenir contre ces derniers propos; le marquis nous vit rire, et se mit à rire de tout son cœur.) Oh! reprit-il, je vous l'ai dit, je suis grand physionomiste, moi!… Mais n'aurai-je pas le bonheur de voir la chère sœur?» M. Duportail se hâta de répondre: «Non, Monsieur, elle est allée faire ses adieux.—Ses adieux?—Oui, Monsieur, elle part demain matin pour son couvent.—Pour son couvent! à Paris?—Non,… à Soissons.—A Soissons! demain matin! cette chère enfant nous quitte!—Il le faut bien, Monsieur.—Elle fait actuellement ses visites?—Oui, Monsieur.—Et sans doute elle viendra dire adieu à sa maman?—Assurément, Monsieur, et elle doit même être actuellement chez vous.—Ah! que je suis fâché! ce matin la marquise étoit encore malade; elle a voulu sortir ce soir: je lui ai représenté qu'il faisoit froid, qu'elle s'enrhumeroit; mais les femmes veulent ce qu'elles veulent; elle est sortie: eh bien! tant pis pour elle! elle ne verra pas sa chère fille, et moi je la verrai, car elle ne tardera sûrement pas à revenir.—Elle a plusieurs visites à faire, dis-je au marquis.—Oui, ajouta M. Duportail, nous ne l'attendons que pour souper.—L'on soupe donc ici? Vous avez raison, ils ont tous la manie de ne pas manger le soir; moi, je n'aime pas à mourir de faim parce que c'est la mode. Vous soupez, vous! eh bien! je reste, je soupe avec vous: vous allez dire que j'en use bien librement; mais je suis ainsi fait, je veux qu'on agisse de même avec moi: quand vous me connoîtrez mieux, vous verrez que je suis un bon diable.»
Il n'y avoit pas moyen de reculer. M. Duportail prit son parti sur-le-champ. «Je suis fort aise, Monsieur le marquis, que vous vouliez bien être des nôtres; vous permettrez seulement que mon fils nous quitte pour une heure ou deux, il a quelques affaires pressées.—Monsieur, qu'on ne se gêne pas pour moi, qu'il nous quitte, mais qu'il revienne, car il est fort aimable, monsieur votre fils.—Vous permettrez aussi que je vous laisse un moment pour lui dire deux mots.—Faites, Monsieur, comme si je n'étois pas là.» Je saluai le marquis; il se leva précipitamment, me prit par la main, et dit à M. Duportail: «Tenez, Monsieur, vous direz tout ce que vous voudrez, ce jeune homme-là ressemble à sa sœur comme deux gouttes d'eau! Je me connois en figures, je soutiendrois cela devant l'abbé Pernetti[6].—Oui, Monsieur, répondit M. Duportail, il y a un air de famille.»
[6] M. l'abbé Pernetti a fait, sur la physionomie, un ouvrage en deux volumes, intitulé: Connoissance de l'homme moral par l'homme physique.
A ces mots, il passa avec moi dans un autre appartement. «Parbleu! me dit-il, c'est un singulier homme que votre marquis! il ne se gêne pas avec ceux qu'il aime.—Mon très cher père, il est bien vrai que le marquis est venu sans façon s'impatroniser chez nous; mais, quant à moi, j'aurois tort de m'en plaindre, je me suis mis chez lui fort à mon aise.—Quant à vous, c'est bien dit; mais laissons la plaisanterie, et voyons comment nous allons sortir de là. Si je ne considérois que lui, cela seroit bientôt fini; mais, mon ami, vous avez des ménagemens à garder à cause de sa femme… Écoutez,… retournez chez vous, faites prendre à votre laquais un habit quelconque, et qu'il vienne annoncer ici que Mlle Duportail soupe chez Mme de ***, le premier nom qui vous viendra à l'esprit.—Eh bien, après? le marquis soupera toujours avec vous, et il attendra tranquillement le retour de votre fille: c'est ainsi qu'il est fait, il vous l'a dit lui-même.—Comment donc faire?…—Comment? mon très cher père, je fais si bien la demoiselle! je vais m'habiller en femme, et votre fille viendra réellement souper avec vous. Ce sera votre fils, au contraire, qui sera retenu, et qui ne viendra pas. Il est six heures, je serai de retour à dix; j'ai le temps.—A la bonne heure; convenez pourtant que Lovzinski joue là un singulier rôle,… vous m'avez embarqué dans une aventure… Mais il n'y a plus à s'en dédire: allez vite, et revenez.»
Je courus à l'hôtel; Jasmin me dit que mon père étoit sorti, et qu'une fort jolie demoiselle m'attendoit chez moi depuis plus d'une heure. «Une jolie demoiselle, Jasmin!» Je m'élançai comme un trait dans mon appartement. «Ah! ah! Justine, c'est toi! Jasmin disoit bien que c'étoit une jolie demoiselle»; et j'embrassai Justine. «Gardez cela pour ma maîtresse! me dit-elle d'un petit air boudeur.—Pour ta maîtresse, Justine! tu la vaux bien!—Qui vous l'a dit?—Je le soupçonne; il ne tient qu'à toi que j'en sois certain», et j'embrassai Justine, et Justine me laissoit faire en répétant: «Gardez cela pour ma maîtresse. Mon Dieu! que vous êtes bien avec vos habits! ajouta-t-elle. Est-ce que vous les quitterez encore pour vous déguiser en femme?—Ce soir, pour la dernière fois, Justine; après cela je serai toujours homme… à ton service, belle enfant.—A mon service, oh! que non, au service de madame.—Au sien et au tien en même temps, Justine.—Oui-da, il vous en faut donc deux à la fois?—Je sens, ma chère, que ce n'est pas trop»; et j'embrassai Justine, et mes mains se promenoient sur une gorge fort blanche, qu'on ne défendoit presque pas. «Mais voyez donc comme il est hardi! disoit Justine. Qu'est devenue la modestie de Mlle Duportail?—Ah! Justine, ah! tu ne sais pas comme une nuit m'a changé.—Cette nuit-là avoit bien changé ma maîtresse aussi! Le lendemain, elle étoit pâle, fatiguée… Mon Dieu! en la voyant, je n'ai pas eu de peine à deviner que Mlle Duportail étoit un bien brave jeune homme!—Quand je te dis, Justine, que je n'en aurois pas trop de deux.»
Je voulus l'embrasser; pour cette fois, elle se défendit en reculant. Mon lit se trouva derrière elle, elle y tomba à la renverse, et, par un malheur auquel on s'attend peut-être, je perdis l'équilibre au même instant.
Quelques minutes après, Justine, qui ne se pressoit pas de réparer son désordre, me demanda en riant ce que je pensois de la petite espièglerie qu'elle avoit faite au marquis. «Quoi donc, mon enfant?—L'étiquette au milieu du dos; que dites-vous du tour?—Charmant! délicieux! presque aussi bon que celui que nous venons de faire à la marquise. A propos d'elle, et ma commission donc!—Ma maîtresse vous attend…—Elle m'attend! ah! j'y cours.—Là! le voilà parti! et où courez-vous?—Je n'en sais rien.—Voyez donc comme il me plantoit là!—Justine! c'est que… tu conçois…—Je conçois que vous êtes un franc libertin.—Tiens, Justine, faisons la paix; un louis d'or et un baiser.—Je prends l'un très volontiers,… et je vous donne l'autre de bon cœur. Le charmant jeune homme! joli, vif et généreux! oh! comme vous avancerez dans le monde! ah çà, partons, suivez-moi par derrière, à quelque distance et sans affectation. Vous me verrez entrer dans une boutique; à côté est une porte cochère que vous trouverez entr'ouverte, vous entrerez vite: un portier vous demandera qui vous êtes, vous répondrez: L'Amour, vous grimperez au premier étage, sur une petite porte blanche vous lirez ce mot Paphos; vous ouvrirez avec la clef que voici, et vous ne resterez pas longtemps seul.»
Avant de sortir, j'appelai Jasmin pour lui ordonner de prendre un autre habit que celui de la maison, et d'aller, de la part de M. de Saint-Luc, annoncer à M. Duportail que son fils ne reviendroit pas souper.
Cependant Justine s'impatientoit, je la suivis: elle entra chez une marchande de modes, je me précipitai dans la porte cochère. L'Amour! criai-je au portier, et d'un saut je fus à Paphos. J'ouvris, j'entrai, le lieu me parut digne du dieu qu'on y adoroit. Un petit nombre de bougies n'y répandoient qu'un jour doux, je vis des peintures charmantes, je vis des meubles aussi élégans que commodes, je remarquai surtout dans le fond d'une alcôve dorée, tapissée de glaces, un lit à ressort, dont les draps de satin noir devoient relever merveilleusement l'éclat d'une peau fine et blanche. Alors je me ressouvins que j'avois promis à M. Duportail de ne plus revoir la marquise, et l'on devine que je m'en ressouvins trop tard.
Une porte que je n'avois pas remarquée s'ouvrit tout à coup; la marquise entra. Voler dans ses bras, lui donner vingt baisers, l'emporter dans l'alcôve, la poser sur le lit mouvant, m'y plonger avec elle dans une douce extase, ce fut l'affaire d'un moment. La marquise reprit ses sens en même temps que moi. Je lui demandai comment elle se portoit. «Que dites-vous donc?» répondit-elle d'un air étonné. Je répétai: «Ma chère petite maman, comment vous portez-vous?» Elle partit d'un éclat de rire. «Je croyois avoir mal entendu: le comment vous portez-vous est excellent! mais, si j'étois incommodée, il seroit bien temps de me le demander! Croyez-vous que ce régime-ci convienne à une personne malade? Mon cher Faublas, ajouta-t-elle en m'embrassant tendrement, vous êtes bien vif.—Ma chère petite maman, c'est que je sais aujourd'hui bien des choses que j'ignorois il y a trois jours.—Craignez-vous de les oublier, fripon que vous êtes?—Oh! non.—Oh! non, répéta-t-elle en me contrefaisant, je vous crois bien, Monsieur le libertin (elle m'embrassa encore). Promettez-moi de ne vous souvenir jamais qu'avec moi de ces choses-là.—Je vous le promets, ma petite maman.—Vous jurez d'être fidèle?—Je le jure.—Toujours?—Oui, toujours.—Mais, dites-moi donc, vous avez beaucoup tardé à me venir joindre, petit ingrat.—Je n'étois pas chez moi, j'ai dîné chez M. Duportail.—Chez M. Duportail? il vous a parlé de moi?—Oui.—Vous ne lui avez pas conté les folies…?—Non, maman.»
Elle continua d'un ton très sérieux: «Vous lui avez bien dit que j'ai été, comme le marquis, trompée par les apparences?—Oui, maman.—Et que je le suis encore? poursuivit-elle d'une voix tremblante, mais en me donnant le baiser le plus tendre.—Oui, maman.—Charmant enfant! s'écria-t-elle, il faudra donc que je t'adore.—Si vous ne voulez pas être une ingrate, il le faudra.» Cette réponse me valut plusieurs caresses, et puis, un reste d'inquiétude se faisant sentir encore: «Ainsi, vous avez assuré à M. Duportail que je vous crois… fille? ajouta la marquise en rougissant.—Oui.—Vous savez donc mentir?—Est-ce que j'ai menti?—Je pense que le fripon se moque de sa maman.»
Je feignis de vouloir m'enfuir, elle me retint. «Demandez pardon tout à l'heure, Monsieur.» Je le demandai comme un homme qui étoit bien sûr de l'obtenir, le badinage s'échauffa, la paix fut signée.
«Vous n'êtes plus fâchée? dis-je à la marquise.—Bon! répondit-elle en riant, est-ce que la colère d'une amante tient contre de pareils procédés?—Petite maman, je passe avec vous des momens bien doux; savez-vous à qui j'en ai l'obligation?—Il seroit bien singulier que vous crussiez devoir de la reconnoissance à quelque autre qu'à moi!—Cela est singulier, j'en conviens; mais cela est.—Expliquez-vous, mon bon ami.—J'ignorois le bonheur que vous me prépariez, je serois encore chez M. Duportail si votre cher mari n'étoit venu faire une visite…—A M. Duportail?—Et à moi, maman.—Il vous a vu chez M. Duportail?»
Ici je racontai à ma belle maîtresse tout ce qui s'étoit passé dans la visite que le marquis nous avoit faite. Elle se contint beaucoup pour ne pas rire. «Ce pauvre marquis, me dit-elle, il a la plus maligne étoile! il semble qu'il aille exprès chercher le ridicule! Une femme est bien malheureuse, mon cher Faublas, dès qu'elle aime quelqu'un; son mari n'est plus qu'un sot.—Petite maman, vous n'êtes pas tant à plaindre! il me semble que, dans ce cas, le malheur est pour le mari.—Ah! c'est que, répondit-elle en prenant un air sérieux, on souffre toujours des humiliations qu'un mari reçoit.—On en souffre quelquefois, je le veux bien, mais aussi n'en profite-t-on jamais?…—Faublas, vous vous ferez battre… Mais, dites-moi, il faut que vous alliez souper avec le marquis, et vous n'avez pas de robe, et puis comptez-vous me quitter si tôt?—Le plus tard qu'il me sera possible, ma belle maman.—Mais vous pouvez vous habiller ici.» A ces mots elle sonna Justine. «Va, lui dit-elle, chercher une de mes robes, il faut que nous habillions mademoiselle.» Je fermai la porte sur Justine, qui me donna un petit soufflet; la marquise ne s'en aperçut pas; je retournai près d'elle.
«Petite maman, êtes-vous bien sûre que votre femme de chambre ne jasera pas?—Oui, mon ami, je lui donnerai, pour se taire, beaucoup plus d'argent qu'on ne lui en donneroit pour parler. Je ne pouvois vous recevoir chez moi; il falloit renoncer au plaisir de vous voir ou me décider à faire une imprudence: mon cher Faublas, je n'ai pas balancé… Charmant enfant! ce n'est pas la première folie que tu me fais faire.» Elle prit ma main qu'elle baisa, et dont elle se couvrit les yeux. «Petite maman, vous ne me voulez plus voir?—Ah! toujours et partout, s'écria-t-elle, ou bien il eût fallu ne te voir jamais.» Ma main, qui tout à l'heure me cachoit ses yeux, maintenant étoit pressée sur son cœur, son cœur ému palpitoit, ses longues paupières se remplissoient de larmes, et sa bouche charmante, approchée de la mienne, demandoit un baiser. Elle en reçut mille, un feu dévorant me brûloit; je crus qu'il étoit partagé, mais mon amante, plus heureuse, plongée dans l'ivresse d'un tendre épanchement, goûtoit les inexprimables douceurs des plaisirs qui viennent de l'âme. Elle refusa des jouissances moins ravissantes, quoique délicieuses. «Ne plus te voir, reprit-elle, ce seroit ne plus exister, et je n'existe que depuis quelques jours. Une imprudence! ajouta-t-elle bientôt en promenant sur tous les objets qui nous environnoient ses regards étonnés; ah! n'en ai-je fait qu'une? ah! combien j'en dois risquer encore, si j'en juge par celles qu'en si peu de temps tu m'as obligée de commettre!—Chère maman, je me permets une question peut-être bien indiscrète, mais vous excitez ma vive curiosité. Chez qui sommes-nous donc ici?» Cette question tira la marquise de l'extase où elle étoit. «Chez qui nous sommes? chez… chez une de mes amies.—Cette amie-là aime…» Mme de B…, tout à fait remise, se hâta de m'interrompre: «Oui, Faublas, elle aime, vous avez dit le mot, elle aime!… C'est l'amour qui a fait ce lieu charmant; c'est pour son amant…—Et pour le vôtre, ma petite maman.—Oui, mon bon ami, elle a bien voulu me prêter ce boudoir pour ce soir.—Cette porte par laquelle vous êtes entrée…?—Donne dans ses appartemens.—Maman, encore une question.—Voyons.—Comment vous portez-vous?» Elle me regarda d'un air étonné et riant. «Oui, continuai-je, plaisanterie à part, vous étiez malade avant-hier… M. de Rosambert…—Ne me parlez pas de lui; M. de Rosambert est un indigne homme, capable de me faire à moi mille noirceurs et à vous mille mensonges. Qu'il vous trouve disposé à le croire, il vous affirmera confidemment qu'il a eu tout l'univers. Encore s'il n'étoit que fat, on pourroit le lui pardonner; mais ses odieux procédés pour moi, quand même je les aurois mérités, seroient toujours inexcusables.—Il est vrai qu'il nous a bien tourmentés avant-hier.—Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Laissons cela cependant… Quand je te vois, mon bon ami, je ne songe plus à ce que j'ai souffert pour toi… Qu'il est bien dans ses habits d'homme!… qu'il est joli!… qu'il est charmant! Mais quel dommage, ajouta-t-elle en se levant d'un air léger, il faut quitter tout cela. Allons, Monsieur de Faublas, faites place à Mlle Duportail.» A ces mots, elle défit d'un coup de main tous les boutons de ma veste. Je me vengeai sur un fichu perfide, que j'avois déjà beaucoup dérangé et que j'enlevai tout à fait. Elle continua l'attaque, je me plaisois à la vengeance; nous ôtions tout sans rien rétablir. Je montrai à la marquise demi-nue l'alcôve fortunée, et cette fois elle s'y laissa conduire.
On grattoit doucement à la porte; c'étoit Justine. Il faut lui rendre justice, pour cette fois elle avoit fait promptement sa commission. Quoique peu décemment vêtu, j'allois, sans y songer, ouvrir à la femme de chambre: la marquise tira un cordon, des rideaux se fermèrent sur nous, la porte s'ouvrit. «Madame, voici tout ce qu'il faut, vous aiderai-je à l'habiller?—Non, Justine, je m'en charge; mais tu la coifferas, je te sonnerai.» Justine sortit; nous nous amusâmes quelque temps encore à contempler les tableaux rians et multipliés que nous offroient les glaces dont nous étions environnés. «Allons, me dit la marquise en m'embrassant, il faut que j'habille ma fille.» Je voulus marquer l'instant de la retraite par une dernière victoire. «Non, mon bon ami, ajouta-t-elle, il ne faut abuser de rien.»
Ma toilette commença; tandis que la marquise s'en occupoit sérieusement, je m'amusois à toute autre chose. «Voyez s'il finira, disoit ma belle maîtresse: allons, songez qu'il faut être sage, vous voilà demoiselle.» J'étois affublé d'un jupon et d'un corset. «Ma petite maman, il faut d'abord que Justine me coiffe, ensuite elle finira de m'habiller.» J'allois sonner. «Qu'il est étourdi! ne voyez-vous pas dans quel état vous m'avez mise? ne faut-il pas que je m'habille aussi?» J'offris mes services à la marquise; je faisois tout de travers. «Petite maman, il faut plus de temps pour réparer que pour détruire.—Oh! oui, je le vois bien; quelle femme de chambre j'ai là! elle est encore plus curieuse que maladroite.»
Enfin nous sonnâmes Justine. «Petite, il faut coiffer cette enfant.—Oui, Madame; mais ne faudra-t-il pas que j'arrange vos cheveux aussi?—Pourquoi donc? suis-je décoiffée?—Madame, il me semble que oui.» La marquise ouvrit une armoire, on y fourra mes habits d'homme. «Demain matin, me dit-on, un commissionnaire discret vous reportera tout cela chez vous.» Dans une autre armoire, plus profonde, se trouvoit une table de toilette, qu'on roula jusqu'à moi, et voilà Justine exerçant ses petits doigts légers.
La marquise, en se plaçant auprès de moi, me dit: «Mademoiselle Duportail, permettez-moi de vous faire ma cour.—Oui, oui, interrompit Justine, en attendant que M. de Faublas vous fasse encore la sienne.—Que dit donc cette écervelée? répondit la marquise.—Elle dit que je vous aime bien.—Dit-elle vrai, Faublas?—En doutez-vous, maman?» Et je lui baisai la main. Cela déplut à Justine, apparemment. «Diables de cheveux! dit-elle en donnant un coup de peigne vigoureux, comme ils sont mêlés!—Aïe!… Justine, tu me fais mal!—Ne faites pas attention, Monsieur; songez à votre affaire, madame vous parle.—Petite, je ne dis mot, je regarde Mlle Duportail. Tu la fais bien jolie!—C'est pour qu'elle plaise davantage à Madame.—Petite, je crois qu'au fond cela t'amuse; Mlle Duportail ne te déplaît pas?—Madame, j'aime encore mieux M. de Faublas.—Elle est de bonne foi, au moins.—De très bonne foi, Madame, demandez-lui plutôt à lui-même.—Moi! Justine, je n'en sais rien.—Vous mentez, Monsieur!—Comment! je mens?—Oui, Monsieur, vous savez bien que, quand il faut faire quelque chose pour vous, je suis toujours prête… Madame m'envoie chez vous, zest, je pars.—Oui, interrompit la marquise, mais tu ne reviens pas.—Madame, aujourd'hui ce n'est pas ma faute, il m'a fait attendre (ici Justine me chatouilla doucement le col, en tournant une boucle).—C'est qu'il n'est pas pressé quand il faut venir me voir!—Ah! petite maman, je ne suis heureux qu'auprès de vous.» J'embrassai la marquise qui faisoit mine de s'en défendre. Justine trouva le badinage trop long, elle me pinça rudement: la douleur m'arracha un cri. «Prenez donc garde à ce que vous faites, dit la marquise à Justine avec un peu d'humeur.—Mais, Madame, aussi, il ne peut pas se tenir un moment tranquille!»
Il y eut quelques instans de silence. Ma belle maîtresse avoit une de mes mains dans les siennes, l'espiègle soubrette occupa l'autre en me faisant tenir un bout du ruban qui devoit nouer mes cheveux, et, saisissant le moment, elle m'appliqua un peu de pommade sur la figure. «Justine! lui dis-je.—Petite! dit la marquise.—Madame, je n'emploie qu'une main, que ne se défend-il avec l'autre?» et puis, feignant que la houppe lui étoit échappée, elle me jeta de la poudre sur les yeux. «Petite! vous êtes bien folle!… je ne vous enverrai plus chez lui.—Bon! Madame, est-ce qu'il est dangereux? je n'ai pas peur de lui.—Mais, Justine, c'est que tu ne sais pas comme il est vif!—Oh! que si, Madame.—Tu le sais, petite?—Oui, Madame. Madame se souvient du soir qu'elle a couché chez nous, cette belle demoiselle?—Eh bien?—J'ai offert de la déshabiller, madame n'a pas voulu.—Sans doute, elle avoit un air si modeste, si timide! qui n'en auroit été la dupe? Je ne sais pas comment j'ai pu lui pardonner.—C'est que madame est si bonne!… Madame, je disois donc que vous n'aviez pas voulu. Mlle Duportail se déshabilloit derrière les rideaux, je passai par hasard près d'elle au moment où, ayant ôté son dernier jupon, elle s'élançoit dans le lit.—Enfin?—Enfin, Madame, cette drôle de demoiselle sauta si vite, si singulièrement, que…—Eh bien! achève donc, dis-je à Justine.—Ah! mais je n'ose.—Finis donc, dit la marquise, en se cachant le visage avec son éventail.—Elle sauta si singulièrement et avec si peu de précaution que je m'aperçus…—Quoi, Justine? interrompit la marquise d'un ton presque sérieux, vous aperçûtes?…—Que c'étoit un jeune homme; oui, Madame.—Comment! et vous ne m'avez pas avertie?—Bon, Madame! et le pouvois-je? vos femmes dans votre appartement! le marquis près d'y entrer! cela auroit fait un beau vacarme!… et puis madame le savoit peut-être.» A ces derniers mots la marquise pâlit. «Vous me manquez, Mademoiselle; sachez que, si je veux bien m'oublier, je ne veux pas qu'on s'oublie!» Le ton dont ces paroles furent prononcées fit trembler la pauvre Justine; elle s'excusa de son mieux. «Madame, je plaisantois.—Je le crois, Mademoiselle; si je pensois que vous eussiez parlé sérieusement, je vous chasserois dès ce soir.» Justine se mit à pleurer. Je tâchai d'apaiser la marquise. «Convenez, me dit celle-ci, qu'elle m'a dit une impertinence!… Comment! oser supposer, oser me dire en face, et devant vous, que je savois…?» Elle rougit beaucoup, me prit la main et me la serra doucement. «Mon cher Faublas, mon bon ami, vous savez comment tout cela s'est passé! vous savez si ma foiblesse est excusable! votre déguisement trompe tout le monde. Je vois au bal une jeune demoiselle jolie, pleine d'esprit, pour qui je me sens beaucoup d'inclination; elle soupe chez moi, elle y couche; tout le monde se retire,… l'aimable demoiselle est dans mon lit, à côté de moi… Il se trouve que c'est un charmant jeune homme!… Jusqu'ici le hasard, ou plutôt l'amour, a tout fait. Après cela j'ai sans doute été bien foible; mais quelle femme à ma place auroit résisté? Le lendemain je m'applaudis du hasard qui a fait mon bonheur et qui l'assure. Faublas, vous connoissez le marquis, on m'a mariée malgré moi, on m'a sacrifiée; quelle femme excusera-t-on, si l'on me juge à la rigueur?» Je vis la marquise près de pleurer; j'essayai de la consoler par le baiser le plus tendre, je voulus parler. «Un moment, me dit-elle, un moment, mon ami. Le lendemain je confie à mademoiselle mon étonnante aventure, je lui dis tout, tout, Faublas!… elle a le secret de ma vie, mon secret le plus cher! Elle paroît me plaindre, m'aimer, point du tout; elle abuse de ma confiance, elle suppose une horreur, elle me dit en face…»
Justine fondoit en larmes; elle tomba aux genoux de sa maîtresse, elle lui demanda vingt fois pardon. Je joignis mes instances aux siennes, car j'étois vivement ému. La marquise fut attendrie. «Allez, dit-elle, allez; je vous pardonne, Justine, oui, je vous pardonne.» Justine baisa la main de sa maîtresse et s'excusa de nouveau. «C'est assez, lui répondit-on, c'est assez; je suis calmée, je suis contente. Relevez-vous, Justine, et n'oubliez jamais que, si votre maîtresse a des foiblesses, il ne faut pas lui supposer des vices; que, loin de chercher à la trouver plus coupable, vous devez l'excuser ou la plaindre; et qu'enfin vous ne pouvez, sans vous rendre indigne de ses bontés, lui manquer de fidélité et de respect. Allons, petite, ajouta-t-elle avec beaucoup de douceur, ne pleure plus, relève-toi; je te dis que je te pardonne, finis cette coiffure, et qu'il ne soit plus question de cela.»
Justine reprit son ouvrage en me lorgnant d'un air confus. La marquise me regardoit languissamment, nous gardions tous trois le silence, ma toilette n'en alla que plus vite, j'eus deux femmes de chambre au lieu d'une. Il étoit neuf heures, il fallut se séparer, nous nous donnâmes le baiser d'adieu. «Allez, friponne, me dit la marquise, et ménagez mon mari; demain je vous donnerai de mes nouvelles.» Je descendis, un fiacre étoit à la porte; comme j'y montois, deux jeunes gens passèrent, ils me regardèrent de très près, et se permirent quelques plaisanteries plus grossières que galantes. J'en fus surpris: la maison d'où je sortois pouvoit-elle être suspecte? c'étoit celle d'une amie de la marquise. Ma mise n'étoit pas non plus celle d'une fille! Pourquoi donc ces messieurs s'égayoient-ils sur mon compte? C'est qu'apparemment il leur avoit paru étrange de voir une femme bien parée et sans domestiques monter seule dans un fiacre à neuf heures du soir.
A mesure que mon phaéton avançoit, mes réflexions prirent un autre cours et changèrent d'objet. J'étois seul, je pensai à ma Sophie. Je ne lui avois fait dans la matinée qu'une courte visite; dans la soirée je ne donnois qu'un moment à son souvenir; mais, si le lecteur veut m'excuser, qu'il songe aux doux plaisirs que vient de m'offrir une femme charmante, voluptueuse et belle; qu'il sache que Justine a la plus jolie petite figure chiffonnée; qu'il se souvienne surtout que Faublas commence son noviciat et n'a guère que seize ans.
J'arrivai chez M. Duportail. Le marquis, en me faisant de profondes révérences, commença par me demander si j'avois vu sa femme. Répondre non, c'étoit bien mentir, il fallut m'y déterminer pourtant. «Non, Monsieur le marquis…—Je le savois bien! j'en étois sûr!» M. Duportail l'interrompit. «Ma fille, vous vous êtes fait longtemps attendre; nous allons nous mettre à table.—Sans mon frère?—Il m'a fait dire qu'il soupoit en ville.—Comment! la veille de mon départ!—Belle demoiselle, vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un frère.—Monsieur, je crois l'avoir dit à madame la marquise.—Elle ne m'en a pas parlé.—Bon!—Je vous donne ma parole d'honneur qu'elle ne m'en a pas parlé!—Monsieur, je vous crois.—Ah! c'est que cela tire à conséquence! Monsieur votre père croiroit que je fais le connoisseur, et que je ne le suis pas.—Comment donc?—Comment, Mademoiselle? vous ne croiriez jamais ce qui m'est arrivé! En entrant ici, j'ai reconnu monsieur votre frère, que je n'avois jamais vu.—Oh! bah!—Demandez à monsieur votre père.—A la bonne heure, Monsieur, vous l'avez reconnu; mais madame la marquise…—Ne m'en a pas parlé, je vous le jure.—Bon!—Je vous en donne ma parole d'honneur.—C'est donc M. de Rosambert?—Il ne m'en a pas parlé non plus.—Je crois pourtant l'avoir entendu vous dire à peu près…—Pas un mot qui ressemble à cela, je vous le proteste.» Et le marquis se fâchoit presque. «C'est donc moi qui me suis trompée! en ce cas, Monsieur, il faut que vous soyez grand physionomiste.—Oh! ça, c'est vrai, répondit-il avec une joie extrême, personne ne se connoît en physionomie comme moi.»
M. Duportail s'amusoit de la conversation, et de peur qu'elle ne finît trop tôt: «Il faut convenir aussi, dit-il au marquis, qu'il y a un air de famille.—J'en conviens, répliqua celui-ci, j'en conviens; mais c'est justement cet air de famille qu'il faut saisir, qu'il faut distinguer dans les traits; c'est là ce qui constitue les vrais connoisseurs! Entre père, mère, frères et sœurs, il y a toujours un air de famille.—Toujours, m'écriai-je, toujours! vous croyez, Monsieur?—Si je le crois? mais j'en suis sûr. Quelquefois cet air-là est enveloppé dans le maintien, dans les manières, dans les regards,… enveloppé, vous dis-je, enveloppé de sorte qu'il n'est pas aisé de l'apercevoir. Eh bien! un homme habile le cherche,… le débrouille… Vous concevez?—De sorte que, si, après m'avoir vue, mais avant d'avoir vu mon père, mon père que voici, vous l'aviez par hasard rencontré au milieu de vingt personnes…?—Lui? dans mille je l'aurois reconnu!» M. Duportail et moi nous nous mîmes à rire. Le marquis se leva, quitta la table, alla à M. Duportail, lui prit la tête d'une main, et, promenant un doigt sur le visage de mon prétendu père: «Ne riez donc pas, Monsieur, ne riez donc pas. Tenez, Mademoiselle, voyez-vous ce trait-là, qui prend ici, qui passe par là, qui revient ensuite…? Revient-il?… non, il ne revient pas; il reste là. Eh bien! tenez (il venoit à moi).—Monsieur, je ne veux pas qu'on me touche. (Il s'arrêta et promena son doigt, mais sans le poser sur mon visage.)—Eh bien! Mademoiselle, ce même trait, le voilà, là, ici, et encore là,… là; voyez-vous?—Eh! Monsieur, comment voulez-vous que je voie?—Vous riez!… il ne faut pas rire, cela est sérieux… Vous voyez bien, vous, Monsieur?—Très bien.—Outre cela, Monsieur, il y a dans l'ensemble,… dans la configuration du corps, certaines nuances… de ressemblance,… certains rapports secrets,… occultes…—Occultes! répétai-je, occultes!—Oui, oui, occultes. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'occultes? cela n'est pas étonnant, une demoiselle… Je disois donc, Monsieur, qu'il y a des ressemblances occultes… Non, ce n'est pas ressemblances que j'avois dit, c'est un autre mot… plus… là… mieux… Ah! dame, je ne sais plus où j'en étois, on m'a interrompu.—Monsieur, vous aviez dit des rapports occultes.—Ah! oui, des rapports! des rapports! et je vais vous faire concevoir cela à vous, Monsieur, qui êtes raisonnable.—Comment! Monsieur le marquis, vous m'injuriez, je crois!—Non, ma belle demoiselle, vous ne pouvez pas savoir tout ce que monsieur votre père sait.—Ah! dans ce sens-là…—Oui, dans ce sens-là, ma belle demoiselle; mais, de grâce, laissez-moi expliquer à monsieur… Monsieur, les pères et les mères, dans la… procréation des individus, font des êtres qui ressemblent,… qui ont des rapports occultes avec les êtres qui les ont procréés, parce que la mère, de son côté, et le père, du sien…—Chut! chut! je vous entends, interrompit M. Duportail.—Oh! elle ne comprend pas cela, répondit le marquis, elle est trop jeune… Cela est pourtant clair, ce que je vous explique; mais cela est clair pour vous. Ces choses-là, Monsieur, sont physiques; elles ont été physiquement prouvées par des… par de grands physiciens, qui entendoient très bien ces parties-là.
—Monsieur le marquis, pourquoi donc parler bas?—J'ai fini, Mademoiselle, j'ai fini; monsieur votre père est au fait.—Vous vous connoissez en physionomie, Monsieur le marquis; mais vous connoissez-vous aussi en étoffes? Que dites-vous de cette robe-là?—Elle est très jolie, très jolie. Je crois que la marquise en a une pareille,… oui, toute pareille.—De la même étoffe, de la même couleur?—De la même étoffe, je ne sais pas; mais, pour la couleur, c'est absolument la même: elle est très jolie, elle vous va au mieux.» Il partit de là pour me faire des complimens à sa manière, tandis que M. Duportail, devinant à qui la robe appartenoit, me regardoit d'un air mécontent, et sembloit me reprocher d'avoir sitôt oublié la parole que je lui avois donnée.
Nous sortions de table, quand mon véritable père, M. de Faublas, qui m'avoit promis de me venir chercher, arriva. Son étonnement fut extrême de retrouver chez M. Duportail son fils encore travesti et le marquis de B… «Encore? dit-il en me regardant d'un air sévère; et vous, Monsieur Duportail, vous avez la bonté…—Eh! bonsoir, mon ami, ne reconnoissez-vous pas M. le marquis de B…? Il m'a fait l'honneur de me venir demander à souper pour faire ses adieux à ma fille qui part demain.—Qui part demain? répliqua le baron en saluant froidement le marquis.—Oui, mon ami, elle retourne à son couvent; ne le savez-vous pas?—Eh! non, dit le baron avec impatience, eh! non, je ne le sais pas.—Eh bien, mon ami, je vous le dis, elle part.—Oui, Monsieur, interrompit le marquis en s'adressant à mon père, elle part; j'en ai bien du chagrin, et ma femme en sera très fâchée.—Et moi, Monsieur, répondit le baron, j'en suis bien aise. Il est temps que cela finisse», ajouta-t-il en me regardant. M. Duportail craignit qu'il ne s'emportât; il le tira à part. «Qu'est-ce donc que cet homme-là? me dit alors le marquis; ne l'ai-je pas vu ici l'autre jour?—Justement.—Je l'ai reconnu tout d'un coup; quand une fois j'ai vu une figure, elle est là. Mais cet homme-là me déplaît, il a toujours l'air fâché. Est-ce un de vos parens?—Point du tout.—Oh! je l'aurois gagé qu'il n'étoit point de la famille; il n'y a pas entre vos figures la moindre ressemblance: la vôtre est toujours gaie, la sienne est toujours sombre, à moins qu'un ris platonique, non, sartonique… est-ce sartonique ou sard… enfin vous comprenez: je veux dire que, lorsqu'il ne vous regarde pas de travers, cet homme-là, il vous rit au nez.—Ne faites pas attention à cela, c'est un philosophe.—Un philosophe? reprit le marquis d'un air effrayé, je ne m'étonne plus. Un philosophe! ah! je m'en vais.» M. Duportail et le baron s'entretenoient ensemble et nous tournoient le dos. Le marquis alla dire adieu à M. Duportail. «Ne vous dérangez pas, dit-il au baron qui se retourna pour le saluer; Monsieur, ne vous dérangez pas, je n'aime pas les philosophes, moi, et je suis fort aise que vous ne soyez pas de la famille; un philosophe! un philosophe!» répéta-t-il en s'enfuyant.
Quand il fut parti, mon père et M. Duportail recommencèrent à causer tout bas. Je m'endormis au coin du feu, un songe heureux me présenta l'image de ma Sophie. «Faublas, cria le baron, allons-nous-en.—Voir ma jolie cousine? lui dis-je encore tout étourdi.—Sa jolie cousine! voyez s'il ne dort pas tout debout.» M. Duportail rioit, il me dit: «Allez-vous-en, mon ami, allez dormir chez vous, je crois que vous en avez besoin; nous nous reverrons: je vous dois encore des reproches et le récit de mes malheurs; nous nous reverrons.»
En rentrant, je demandai M. Person; il venoit de se coucher; j'en fis autant, et je fis bien: jamais on ne dormit plus profondément aux harangues fraternelles de nos francs-maçons, aux lectures publiques du musée moderne, aux rares plaidoyers des D…, des D…, des D… L…, et de tant d'autres grands orateurs inscrits sur le fameux tableau.
A mon réveil, je sonnai Jasmin pour le prévenir qu'on me rapporteroit dans la matinée mes habits que j'avois laissés la veille chez un ami. Ensuite je fis appeler M. Person; je lui demandai comment se portoient Adélaïde et Mlle de Pontis. «Vous les avez vues hier, me répondit-il.—Et vous aussi, Monsieur Person, vous les avez vues, et même vous leur avez dit que j'avois fait une connoissance au bal.—Eh bien! Monsieur, quel mal?—Et quelle nécessité, Monsieur? Dites à ma sœur vos secrets, à la bonne heure; mais les miens, je vous prie de les respecter.—En vérité, Monsieur, vous le prenez sur un ton,… depuis quelques jours on ne vous reconnoît plus… Je me plaindrai à monsieur votre père.—Et moi, Monsieur, à ma sœur. (Je le vis pâlir.) Croyez-moi, soyons bons amis; mon père désire que je sorte avec vous; eh bien, finissez votre toilette, et allons au couvent.»
Nous partions, quand Rosambert arriva. Dès qu'il sut où nous allions, il me pria de lui permettre de nous accompagner. «Depuis quatre mois, me dit-il, vous m'avez promis de me faire connoître votre aimable sœur.—Rosambert, je vais vous tenir parole, et vous allez voir une demoiselle que vous serez forcé d'estimer.—Mon ami, distinguons: je suis très convaincu que Mlle de Faublas est dans le cas de l'exception, mais je rétorquerai sur vous le terrible argument dont vous êtes armé contre moi: une exception ne détruit pas la règle, elle la prouve.—Tout comme il vous plaira; je vous préviens que vous allez voir une demoiselle de quatorze ans et demi, innocente, ingénue jusqu'à la simplicité: cependant elle est aussi grande qu'on peut l'être à son âge, et elle ne manque ni d'esprit ni d'éducation.»
Person fut plus heureux que moi: ma sœur vint au parloir, ma Sophie n'y vint pas. Après les révérences et les complimens d'usage, après quelques minutes d'une conversation générale, je ne pus dissimuler mon inquiétude. «Adélaïde, dites-moi donc ce qu'a ma jolie cousine?—Oh! mon frère, il faut que son mal soit bien amer, car elle le cache et elle s'en occupe toute la journée. Je ne reconnois plus ma bonne amie; autrefois elle étoit étourdie, gaie, folle, comme moi; maintenant je la vois triste, rêveuse, inquiète. Nous la trouvons toujours presque aussi douce, aussi caressante; mais elle est rarement avec nous. Dans nos heures de récréation, elle jouoit, elle couroit au jardin avec nos compagnes; à présent, mon frère, elle cherche un petit coin pour s'y promener toute seule. Oh! elle est malade! elle est vraiment malade! elle mange peu, elle ne dort pas, elle ne rit plus; et moi, mon frère, et moi, qu'elle aimoit tant, elle a l'air de me craindre! oui, en vérité, je l'ai remarqué, elle fuit tout le monde; mais c'est moi surtout qu'elle évite! Hier je la vois entrer dans une petite allée couverte au bout du jardin; j'arrive à pas de loup, je la trouve s'essuyant les yeux. «Ma bonne amie, dis-moi donc où tu as mal…» Elle me regarde d'un air… d'un air… mais c'est que je n'ai vu personne avoir cet air-là… Enfin elle me répond: «Adélaïde, tu ne le devines pas! ah! que tu es heureuse! mais que je suis à plaindre!» Et puis elle rougit, elle soupire, elle pleure. Je tâche de la consoler; plus je lui parle, plus elle se chagrine. Je l'embrasse, elle me fixe longtemps et paroît tranquille; tout d'un coup elle met sa main sur mes yeux, et elle me dit: «Adélaïde, cache ton visage! oh! cache-le! il est trop… il me fait mal! Laisse-moi, va-t'en un moment, laisse-moi seule»; et elle se remet à pleurer. Moi qui vois que son mal augmente, je lui dis: «Sophie…»
A ce nom de Sophie, Rosambert se pencha à mon oreille: «La jolie cousine, c'est Sophie; c'est cette Sophie que j'ai blasphémée! ah! pardon.» Ma sœur reprit.
«Je lui dis: «Sophie, attends un moment, je vais chercher ta gouvernante…» Alors elle se remet, elle s'essuie les yeux, elle me prie de ne rien dire: je suis obligée de le lui promettre. Mais au fond cela n'est pas raisonnable: vouloir être malade, et ne pas vouloir que sa gouvernante le sache!—Ma chère Adélaïde, pourquoi n'est-elle pas venue au parloir avec vous aujourd'hui?—C'est qu'elle est si distraite! si préoccupée! elle vous aimoit presque autant que moi autrefois…—Et maintenant?—Je crois qu'elle ne vous aime plus. Tout à l'heure je lui ai dit que vous étiez là… «Le jeune cousin!» s'est-elle écriée d'un air content; elle venoit, elle s'est arrêtée. «Non, je n'irai pas, m'a-t-elle dit, je ne veux pas, je ne peux pas,… dites-lui de ma part que…» Elle paroissoit chercher, j'attendois qu'elle s'expliquât. «Mon Dieu! ne savez-vous pas ce qu'il faut lui dire? a-t-elle ajouté avec un peu d'humeur,… ce qu'on dit en pareil cas! les complimens d'usage!» Et elle m'a quittée assez brusquement.»
Je m'enivrois du plaisir d'entendre ma sœur ingénue me peindre avec l'innocence d'un enfant les tendres agitations, les douces peines de Sophie. Rosambert, encore plus étonné que je n'étois ravi, prêtoit une oreille attentive, et le petit M. Person, nous regardant tous trois, paroissoit en même temps inquiet et charmé.
«Adélaïde, vous croyez donc que Sophie ne m'aime plus?—Mon frère, j'en suis presque sûre; tout ce qui se rapporte à vous lui donne de l'humeur, et moi j'en suis quelquefois la victime.—Comment?—Oui; l'autre jour, monsieur que voilà (montrant M. Person) nous apprit que vous aviez passé la nuit tout entière chez Mme la marquise de B…; eh bien, quand monsieur fut parti, dès que nous fûmes seules, Sophie me dit d'un ton très sérieux: «Votre frère n'a pas couché à l'hôtel! il n'est pas rangé, votre frère! cela n'est pas bien…» Votre frère! elle me tutoie ordinairement. Votre frère! Quand même vous seriez dérangé, Faublas, doit-elle se fâcher contre moi? Votre frère!… Le jour d'après, je crois, vous avez été au bal masqué. M. Person nous l'est venu dire: car il nous dit tout, M. Person. Dès que nous avons été seules, Sophie m'a dit: «Votre frère s'amuse au bal, et nous nous ennuyons ici!—Point du tout, lui ai-je répondu, on ne s'ennuie point avec sa bonne amie.—Ah! oui, a-t-elle répliqué, ah! oui, avec sa bonne amie, cela est vrai.» Cependant, mon frère, voyez cette singularité; un moment après elle a répété tristement: «Il s'amuse au bal, et nous nous ennuyons ici!…» Nous nous ennuyons! eh mais, quand cela seroit vrai, cela n'est pas poli, elle ne doit pas le dire!… Oh! si elle n'étoit pas malade, je lui en voudrois beaucoup. Je me rappelle encore un trait: hier vous nous avez dit que Mme de B… étoit jolie. Le soir j'ai poursuivi Sophie, et je l'ai forcée de se promener avec moi. «Votre frère, m'a-t-elle dit, car à présent c'est toujours votre frère,… il trouve cette marquise jolie, il est sans doute amoureux d'elle!» J'ai répondu: «Ma bonne amie, cela ne se peut pas, cette Mme de B… est mariée.» Elle m'a pris la main, et elle m'a dit: «Adélaïde, ah! que tu es heureuse!» Il y avoit dans son regard, dans son sourire, du dédain, de la pitié. Est-ce honnête cela?… ah! que tu es heureuse!… eh mais, sûrement, je suis heureuse, je me porte bien, moi!
—Mais, Adélaïde, tout ce que vous me dites là ne prouve pas que ma jolie cousine ne m'aime plus: elle peut être un peu fâchée; mais tous les jours on boude les gens qu'on aime.—Oh! sans doute, s'il n'y avoit que cela.—Et qu'y a-t-il donc encore?—Eh bien, autrefois elle m'entretenoit sans cesse de vous, elle étoit joyeuse de vous voir; à présent elle me parle encore de mon frère, mais c'est si rarement et d'un ton toujours si sérieux! Hier, ne l'avez-vous pas remarqué? elle n'a pas dit un mot, pas un seul mot, pendant que vous étiez là. Allez, allez, mon frère, quand on aime les gens, on leur parle, je vous assure que ma bonne amie ne vous aime plus.»
Ici Rosambert se mêla de la conversation, qui changea d'objet. On parla danse, musique, histoire et géographie. Ma sœur, qui venoit de causer comme une fille de dix ans, raisonna alors comme une femme de vingt. Le comte, à chaque instant plus surpris, sembloit ne pas s'apercevoir que les heures s'écouloient, quoique M. Person eût pris la peine de l'en avertir plusieurs fois. Enfin le son d'une cloche qui appeloit les pensionnaires au réfectoire nous obligea de nous retirer.
«Je vous avoue, me dit le comte, que j'ai peine à croire ce que j'ai vu. Comment peut-on allier l'ignorance et le savoir, la modestie et la beauté, l'ingénuité de l'enfance et la raison de l'âge mûr? enfin, permettez-moi de le dire, une innocence aussi extrême avec un physique aussi précoce? Je croyois cette réunion impossible; mon ami, votre sœur est le chef-d'œuvre de la nature et de l'éducation.—Rosambert, ce chef-d'œuvre est le fruit de quatorze ans de soins et de bonheur; il fut produit par le concours le plus rare des circonstances les plus heureuses. Le baron de Faublas a d'abord reconnu que l'éducation d'une fille étoit pour un militaire un fardeau trop pesant: ma mère, que nos regrets honorent tous les jours, ma vertueuse mère s'est trouvée digne d'en être chargée. Le hasard aussi l'a bien secondée: il s'est rencontré pour sa fille des domestiques qui obéissoient et ne raisonnoient pas; une gouvernante qui ne contoit pas d'histoires galantes et ne lisoit pas de romans; des maîtres qui ne s'occupoient avec leur élève que de sa leçon; une société de gens attentifs qui ne se permettoient jamais un geste suspect, un mot équivoque; et, ce qui n'est pas le moins essentiel et le plus commun, un directeur qui, dans son confessionnal, écoutoit et ne questionnoit pas. Enfin, mon ami, il n'y a pas six mois qu'Adélaïde est au couvent.—Six mois! Ah! dans un espace de temps beaucoup plus court, combien de demoiselles qu'on dit bien élevées acquièrent là de grandes lumières, et reçoivent même certaines leçons qui avancent beaucoup une jeune fille!—C'est ici, Rosambert, qu'il faut encore admirer le bonheur d'Adélaïde! Vive, folâtre, enjouée avec toutes ses compagnes, elle n'en a distingué qu'une, une aussi délicate, aussi honnête, aussi sage qu'elle,… une un peu plus éclairée peut-être, parce que depuis quelque temps l'amour…—Je vous entends, c'est la jolie cousine.—Oui, mon ami. Sophie, non moins vertueuse qu'Adélaïde, quoique sensible un peu plus tôt, Sophie est devenue l'unique amie de ma sœur. Ces deux cœurs si purs se sont pour ainsi dire sentis attirés, confondus. Adélaïde, privée de sa mère, n'a plus pensé, n'a plus vécu que par Sophie; leur amitié, aussi délicate que vive, les a sauvées des dangers dont vous me parlez et auxquels je conçois que doivent être exposées, dans l'enceinte où elles se trouvent rassemblées, pressées, pour ainsi dire, tant de jeunes filles ardentes, inquiètes, curieuses, que le temps, l'heure, les lieux, invitent continuellement à des liaisons qui, devenant très intimes, peuvent bien n'être pas toujours désintéressées. Depuis quelque temps, j'ai troublé l'union des deux amies; il m'est permis de croire que je suis devenu l'heureux objet des plus chères affections de ma jolie cousine. Adélaïde, à qui l'amour (je regardois M. Person) n'a pas encore montré son vainqueur, a porté sur Sophie sa sensibilité tout entière, et l'amertume de ses plaintes nous a prouvé l'excès de son amitié…—Et vous a assuré en même temps de votre bonheur. En vérité, Faublas, je vous félicite si Sophie est aussi aimable, aussi belle qu'Adélaïde.—Plus belle, mon ami, plus belle encore!—Cela me paroît difficile.—Oh! plus belle!… Vous la verrez. Plus belle! imaginez…—Chut! chut! doucement; comme il s'échauffe!… Dites-moi donc, l'homme à sentimens! puisque vous aviez une si charmante maîtresse, pourquoi m'avez-vous soufflé la mienne? Puisque M. de Faublas aimoit tant le parloir, pourquoi Mlle Duportail a-t-elle couché chez la marquise? Comment donc arrangez vous tout cela?—Mais, Rosambert, cela n'est pas difficile…—Ni désagréable, je le conçois.—Vous riez! écoutez donc, mon ami. Vous savez comment les choses se sont passées entre la marquise et moi.—Oui, oui, à peu près.—Mais, rieur éternel, écoutez-moi. Élevé à peu près comme ma sœur, je n'étois guère moins ignorant qu'elle il y a huit jours. Je n'ai pas pris Mme de B…: c'est elle qui s'est donnée,… je suis excusable.—Allons, passe pour le bal paré; mais, au moins, vous étiez le maître de ne pas retourner chez elle. Le bal masqué! hem! qu'en dites-vous?—Je dis qu'on m'y avoit attiré… Je n'ai guère que seize ans, moi! mes sens sont neufs.—Ah! Sophie, pauvre Sophie!—Ne la plaignez pas, je l'adore! Mais, Rosambert, je sais bien qu'il n'y a que des nœuds légitimes qui puissent m'assurer sa possession.—Cela doit être au moins.—Eh bien, en attendant que l'hymen nous unisse, je respecterai toujours ma Sophie…—C'est ce que l'on saura par la suite.—Cependant mon célibat me paroîtra dur.—Je le crois!—Ma vivacité m'emportera quelquefois.—Sans doute.—Je ferai peut-être quelque infidélité à ma jolie cousine…—Cela est plus que probable.—Mais, dès qu'un heureux mariage…—Ah! oui.—Alors, ma Sophie, je n'aimerai que toi…—Cela n'est pas si sûr.—Je t'aimerai toute ma vie.—Celui-là me paroît fort!»
Rosambert me quitta. Jasmin, à qui je demandai, en rentrant, si l'on avoit rapporté mes habits, me dit qu'il n'avoit vu personne; j'attendis jusqu'au soir le commissionnaire, qui ne vint pas. J'étois inquiet, parce que j'avois laissé dans mes poches un portefeuille qui contenoit deux lettres: l'une m'avoit été envoyée de province par un vieux domestique de mon père; le bonhomme me souhaitoit une bonne année. J'aurois été fâché de perdre l'autre: c'étoit celle que la marquise m'avoit écrite quelques jours auparavant; elle étoit, comme on sait, adressée à Mlle Duportail, et je voulois la conserver.
Les habits me furent rapportés le lendemain matin; mais je cherchai vainement dans les poches, le portefeuille ne s'y trouvoit plus. Mme Dutour vint me faire oublier mon inquiétude en me remettant une lettre de la marquise. J'ouvris avec empressement, je lus:
Ce soir, mon bon ami, à sept heures précises, trouvez-vous à la porte de mon hôtel; vous pourrez suivre avec assurance la personne qui, après avoir soulevé le chapeau dont vous vous serez couvert les yeux, vous nommera l'Adonis. Je ne puis vous en écrire davantage, depuis le matin je suis obsédée; on me fatigue des détails de la science physionomique; ce n'est pas celle-là que je me soucie d'approfondir. O mon ami, vous possédez si bien l'art de plaire que, quand on vous connoît, on ne sait plus qu'aimer, on ne veut plus savoir que cela.

Cette lettre étoit si flatteuse, l'invitation qu'elle contenoit étoit si séduisante, que je ne balançai pas. J'assurai la Dutour que je ne manquerois pas de me rendre au lieu indiqué. Cependant, quand la messagère fut partie, je sentis quelque irrésolution. Ne devois-je pas désormais, uniquement occupé de Sophie, éviter toute occasion de revoir sa trop dangereuse rivale?… Mais pourquoi m'imposerois-je cette loi cruelle sans nécessité? Avois-je déclaré mon amour à Sophie? Sophie m'avoit-elle avoué le sien? avoit-elle acquis le droit d'exiger de moi ce sacrifice? D'ailleurs, à le bien prendre, ce que j'allois faire ne pouvoit pas s'appeler une infidélité! je ne m'embarquois pas dans une intrigue nouvelle! Puisque j'avois passé la nuit avec la marquise, puisque je l'avois revue depuis dans ce galant boudoir, quel inconvénient de lui faire encore une visite? Cela ne faisoit jamais que trois rendez-vous au lieu de deux; le crime étoit-il dans le nombre? Et puis ma jolie cousine ne seroit pas instruite de celui-là… Enfin, ma parole étoit engagée! le lecteur voit bien que je ne pouvois me dispenser d'aller à ce rendez-vous.
Je ne me fis pas attendre; Justine aussi ne me laissa pas morfondre à la porte, elle souleva mon chapeau. «Venez, bel Adonis.» Je la suivis à petits pas. Cependant le suisse, quoique à demi ivre, entendit quelque bruit et demanda qui c'étoit. «C'est moi! c'est moi! répondit Justine.—Oui, reprit l'autre, c'est vous! mais ce jeune gaillard?—Eh bien, c'est mon cousin.» Le suisse étoit en gaieté, il se mit à fredonner: «Voilà mon cousin l'Allure, mon cousin, voilà mon cousin l'Allure.»
Cependant Justine me conduisoit au fond de la cour; nous enfilâmes un escalier dérobé; on conçoit que la jolie soubrette fut embrassée plusieurs fois avant que nous fussions au premier étage. Alors elle me fit signe d'être plus sage et m'ouvrit une petite porte, je me trouvai dans le boudoir de la marquise. «Entrez, me dit Justine, entrez dans la chambre à coucher, vous seriez mal ici»; elle sortit, et ferma la porte sur elle.
J'entrai dans la chambre à coucher; ma belle maîtresse vint à moi. «Ah! maman, c'est donc ici que pour la seconde fois…» Elle m'interrompit: «Mon Dieu! je crois entendre le marquis! le voilà revenu pour toute la soirée! sauvez-vous, partez!» D'un saut je regagnai le boudoir; mais je ne songeai pas à tirer sur moi la porte de la chambre à coucher, elle resta entr'ouverte; et, pour comble de malheur, cette étourdie de Justine avoit fermé à double tour l'autre porte qui conduisoit à l'escalier dérobé. La marquise, qui ne pouvoit deviner que la retraite me fût fermée, s'étoit assise tranquillement. Déjà le marquis étoit entré dans son appartement et s'y promenoit d'un air effaré. Je tremblois qu'il ne m'aperçût dans le boudoir, il n'y avoit pas moyen d'en sortir: comment faire? Je me jetai sous l'ottomane, et dans une situation très incommode j'entendis une conversation fort singulière, qui eut un dénouement plus singulier encore.
«Vous voilà de retour de bonne heure, Monsieur?—Oui, Madame.—Je ne vous attendois pas sitôt.—Cela se peut bien, Madame.—Vous paroissez agité, Monsieur, qu'avez-vous donc?—Ce que j'ai, Madame, ce que j'ai!… j'ai que… je suis furieux.—Modérez-vous, Monsieur… Peut-on savoir…?—J'ai que… il n'y a plus de mœurs nulle part… les femmes!…—Monsieur, la remarque est honnête, et l'application heureuse!—Madame, c'est que je n'aime pas qu'on me joue!… et, quand on me joue, je m'en aperçois bien vite!—Comment! Monsieur, des reproches! des injures! cela s'adresseroit-il… Vous vous expliquerez sans doute?—Oui, Madame, je m'expliquerai, et vous allez être convaincue.—Convaincue!… de quoi, Monsieur?—De quoi? de quoi? un moment donc, Madame, vous ne me laissez pas le temps de respirer!… Madame, vous avez reçu chez vous, logé chez vous, couché avec vous Mlle Duportail?» La marquise avec fermeté: «Eh bien, Monsieur?—Eh bien, Madame, savez-vous ce que c'est que Mlle Duportail?—Je le sais… comme vous, Monsieur; elle m'a été présentée par M. de Rosambert; son père est un honnête gentilhomme, chez qui vous avez soupé encore avant-hier.—Il ne s'agit pas de cela, Madame. Savez-vous ce que c'est que Mlle Duportail?—Je vous le répète, Monsieur, je sais comme vous que Mlle Duportail est une fille bien née, bien élevée, fort aimable.—Il ne s'agit pas de cela, Madame.—Eh! Monsieur, de quoi s'agit-il donc? avez-vous juré de pousser ma patience à bout?—Un moment donc, Madame. Mlle Duportail n'est point une fille…» La marquise très vivement: «N'est point une fille!…—N'est point une fille bien née, Madame; c'est une fille d'une espèce… de ces filles qui… là… vous m'entendez?—Je vous assure que non, Monsieur.—Je m'explique pourtant bien; c'est une fille qui… dont… que… enfin suffit, vous y êtes?—Oh! point du tout, Monsieur, je vous assure.—C'est que je voudrois vous gazer cela… Madame, c'est une p….., vous comprenez?—Mlle Duportail une… Pardon, Monsieur, mais je n'y tiens pas, il faut que je rie.» En effet, la marquise se mit à rire de toutes ses forces. «Riez, riez, Madame… Tenez, connoissez-vous cette lettre-là?—Oui, c'est celle que j'ai écrite à Mlle Duportail, le lendemain du jour qu'elle a couché chez moi.—Justement, Madame. Et celle-ci, la connoissez-vous?—Non, Monsieur.—Regardez-la, Madame, vous voyez bien l'adresse: A Monsieur, Monsieur le chevalier de Faublas; et lisez le dedans: Mon cher maître, j'ai l'honneur de prendre la liberté d'oser vous interrompre, pour vous souhaiter que cette année qui commence nous soit belle et bonne, etc. J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect, mon cher maître, etc.» C'est une lettre de bonne année d'un domestique à son maître, qui est ce M. de Faublas. Eh bien, Madame, ces deux lettres étoient dans le portefeuille que voici.—Enfin, Monsieur?—Madame, et le portefeuille, vous ne devineriez jamais où je l'ai trouvé?—Dites, dites, Monsieur.—Je l'ai trouvé dans un endroit où… là…—Eh! Monsieur, dites tout de suite le mot; vous seriez toujours obligé d'en venir là, ainsi…—Eh bien, Madame, je l'ai trouvé dans un mauvais lieu.—Dans un mauvais lieu!—Oui, Madame.—Où vous aviez affaire, Monsieur?—Où la curiosité m'a conduit. Tenez, je vais vous conter cela. Une femme a fait courir depuis quelques jours des billets imprimés, par lesquels elle donne avis aux amateurs qu'elle peut leur offrir de charmans boudoirs qu'elle louera à tant par heure; moi, j'ai été voir cela par curiosité, uniquement par curiosité, comme je vous le disois tout à l'heure.—Quel jour y avez-vous été, Monsieur?—Hier, l'après-dînée, Madame. Les boudoirs sont en effet charmans!… Il y en a un surtout au premier étage… il est vraiment joli! on y voit des tableaux, des estampes, des glaces, une alcôve, un lit… ah! c'est le lit surtout! figurez-vous que ce diable de lit est à ressorts!… ah! c'est très plaisant! tenez, il faut quelque jour que je vous fasse voir cela.—Un mari et sa femme en partie fine! répondit la marquise, cela seroit beau.»
J'entendis quelque bruit; la marquise se défendoit, le marquis l'embrassa. Leur conversation, qui dans les commencemens m'avoit inquiété, m'amusoit alors au point que je sentois moins la gêne de ma situation. Le marquis reprit ainsi:
«Mais c'est que rien n'y manque; il y a dans ce boudoir, au premier étage, une porte qui communique chez une marchande de modes qui loge à côté… cela est fort bien imaginé… Vous entendez qu'une femme comme il faut a l'air d'être chez sa marchande de modes; point du tout, elle monte l'escalier, et puis on vous en plante à un pauvre mari!… Mais écoutez-moi, Madame: dans ce boudoir j'ai ouvert une petite armoire, et dans cette armoire j'ai trouvé ce portefeuille! Ainsi il est clair que Mlle Duportail a été là avec ce M. de Faublas, et cela est très vilain à elle, et très malhonnête à M. de Rosambert, qui la connoissoit, de nous l'avoir présentée! et très imprudent à son père de la laisser sortir, accompagnée seulement d'une femme de chambre! et je n'en ai pas été la dupe! il y a dans sa figure… Vous savez comme je suis physionomiste!… elle est jolie sa figure, mais il y a quelque chose dans les traits qui annonce un sang… Cette fille-là a du tempérament, et je l'ai bien vu!… Vous souvenez-vous de ce soir que Rosambert lui dit qu'il y avoit des circonstances… hein! des circonstances! vous n'aviez pas remarqué cela, vous! Moi, je vous ai relevé le mot! ah! on ne m'attrape pas! et tenez, le même jour… Venez, venez, Madame…»
La marquise, qui me croyoit parti, se laissa conduire à son boudoir; le marquis continua.
«Elle étoit ici, dans ce boudoir,… là. Vous, vous étiez couchée sur cette ottomane… Je suis arrivé… Madame, elle avoit le teint animé, les yeux brillans, un air!… oh! je vous le dis, cette fille a un tempérament de feu! Vous savez que je m'y connois; mais laissez-moi faire, j'y mettrai bon ordre.—Comment! Monsieur, vous y mettrez bon ordre?…—Oui, oui, Madame; d'abord je dirai à Rosambert ce que je pense de son procédé; il y a peut-être été avec elle, Rosambert! ensuite je verrai M. Duportail, et je l'instruirai de la conduite de sa fille.—Quoi! Monsieur, vous ferez à M. de Rosambert une mauvaise querelle?—Madame, Madame, Rosambert savoit ce qui en étoit, il étoit jaloux de moi comme un tigre.—De vous, Monsieur?—Oui, Madame, de moi, parce que la petite avoit l'air de me préférer,… elle me faisoit même des avances, et c'est en cela qu'elle m'a joué, elle! car elle avoit alors ce M. de Faublas. Je saurai ce que c'est que ce M. de Faublas, et je verrai M. Duportail.—Quoi! Monsieur, vous pourriez aller dire à un père…?—Oui, Madame, c'est un service à lui rendre; je le verrai, je l'instruirai de tout.—J'espère, Monsieur, que vous n'en ferez rien.—Je le ferai, Madame.—Monsieur, si vous avez quelque considération pour moi, vous laisserez tout cela tomber de soi-même.—Point, point, je saurai…—Monsieur, je vous le demande en grâce.—Non, non, Madame.—Vous m'éclairez, Monsieur, je vois le motif de l'intérêt si pressant que vous prenez à ce qui regarde Mlle Duportail… Je vous connois trop bien pour être la dupe de cette austérité de mœurs dont vous vous parez aujourd'hui; vous êtes fâché, non pas de ce que Mlle Duportail a été dans un lieu suspect, mais de ce qu'elle y a été avec un autre que vous.—Oh! Madame!—Et quand j'accueillois chez moi une demoiselle que je croyois honnête, vous aviez des desseins sur elle!—Madame!—Et vous osez venir vous plaindre à moi-même d'avoir été joué! c'étoit moi, c'étoit moi seule qu'on jouoit.»
Elle se laissa tomber sur l'ottomane; son mari jeta un cri, et puis il embrassa la marquise en lui disant: «Si vous saviez comme je vous aime!—Si vous m'aimiez, Monsieur, vous auriez plus de considération pour moi, plus de respect pour vous-même, plus de ménagement pour un enfant peut-être moins à blâmer qu'à plaindre… Que faites-vous donc, Monsieur? Laissez-moi. Si vous m'aimiez, vous n'iriez pas apprendre à un père malheureux les égaremens de sa fille; vous n'iriez pas conter cette aventure à M. de Rosambert, qui en rira, qui se moquera de vous, et qui dira partout que j'ai reçu chez moi une fille à intrigue!… Mais, Monsieur, finissez donc; ce que vous faites là ne ressemble à rien.—Madame, je vous aime.—Il suffit bien de le dire! il faut le prouver.—Mais depuis trois ou quatre jours, mon cœur, vous ne voulez jamais que je vous le prouve.—Ce ne sont pas de ces preuves-là que je vous demande, Monsieur… Mais, Monsieur, finissez donc.—Allons, Madame! allons, mon cœur!—En vérité, Monsieur, cela est d'un ridicule!—Ah! nous sommes seuls.—Il vaudroit mieux qu'il y eût du monde! cela seroit plus décent! Mais finissez donc, n'avons-nous pas toujours le temps de faire ces choses-là?… Finissez donc… Quoi! des gens mariés!… à votre âge!… dans un boudoir!… sur une ottomane!… comme deux amans!… et quand j'ai lieu de vous en vouloir, encore!—Eh bien, mon ange, je ne dirai rien à Rosambert, rien à M. Duportail.—Vous me le promettez bien?—Oh! je vous en donne ma parole…—Eh bien, un moment; rendez-moi le portefeuille, laissez-le-moi.—Oh! de tout mon cœur, le voilà. (Il y eut un moment de silence.)—En vérité, Monsieur, dit la marquise d'une voix presque éteinte, vous l'avez voulu, mais cela est bien ridicule.»
Je les entendis bégayer, soupirer, se pâmer tous deux; on ne peut se figurer ce que je souffrois sous l'ottomane pendant cette étrange scène; j'aurois étranglé les acteurs de mes mains; et, dans l'excès de mon dépit, j'étois tenté de me découvrir, de reprocher à la marquise cette infidélité d'un nouveau genre, et de rendre au marquis l'amère mystification qu'il me faisoit essuyer sans le savoir. Justine vint terminer mes irrésolutions; elle ouvrit tout à coup la porte de l'escalier dérobé. La marquise jeta un cri; le marquis se sauva dans la chambre à coucher pour y réparer son désordre. Justine, apercevant un mari au lieu d'un amant, demeura stupéfaite, et la marquise ne fut pas moins étonnée qu'elle en me voyant sortir de dessous l'ottomane. Je remerciai tout bas la femme de chambre. «Grand merci, Justine, tu m'as rendu service, j'étois fort mal dessous, tandis que madame étoit dessus très à son aise.» La marquise, interdite et tremblante, n'osa ni me répondre, ni me retenir: son mari étoit si près de là! probablement il alloit rentrer dès qu'il seroit plus décemment vêtu. Justine se rangea pour me laisser passer. Je descendis l'escalier dérobé, sans lumière, au risque de me rompre vingt fois le col; je traversai la cour rapidement, et je sortis de l'hôtel en maudissant ses maîtres.
Le lendemain j'étois encore au lit quand Jasmin m'annonça Justine et se retira discrètement. «Mon enfant, je songeois à toi.—Oh! Monsieur, laissez-moi; cette fois-ci vous ne m'y prendrez pas, je veux commencer par ma commission. Savez-vous que j'ai été encore bien grondée hier? vous nous avez fait une belle peur! vous n'étiez pas encore au bas de l'escalier quand le marquis est rentré dans le boudoir. «Voyez cette sotte, a-t-il dit, qui entre ici comme un coup de pistolet!» Dès qu'il nous a quittées, madame, désolée de l'aventure, m'a dit qu'elle ne concevoit pas pourquoi vous vous étiez caché sous l'ottomane. J'ai été forcée de lui avouer que j'avois, sans y songer, fermé la porte à double tour. Elle m'a fait une scène! et puis ce matin elle m'a remis cette lettre pour vous.—Fort bien, ma petite Justine, voilà ta commission faite, car je n'ouvrirai pas la lettre.—Vous ne l'ouvrirez pas, Monsieur?—Non; je suis fâché contre ta maîtresse.—Vous avez tort.—Mais je ne suis pas fâché contre toi, Justine.—Et vous avez raison… Finissez… Mais, tenez, je le veux bien, à condition que vous lirez la lettre.—Oh! qu'une maîtresse est heureuse d'avoir une fille comme toi! eh bien, oui, je lirai.»
Justine remplit de si bonne grâce les conditions du traité qu'il y auroit eu de ma part de la perfidie à ne pas tenir parole: j'ouvris la lettre.
Que notre aventure d'hier m'a peinée, mon bon ami! Cette scène, qui n'eût été que bizarre si, comme je le croyois, vous n'en aviez pas été le témoin, est devenue, par votre présence, aussi désagréable pour moi que mortifiante pour vous. Quels mots vous avez dits en partant, ingrat! vous ne savez pas le mal que vous m'avez fait! Revenez à moi, mon bon ami, revenez à celle qui vous aime; trouvez-vous à midi au lieu qu'on vous désignera. Là, je n'aurai pas de peine à me justifier; là, quand mon amant sera bien convaincu de son injustice, il me trouvera prête à lui pardonner sa vivacité.
«Monsieur, reprit Justine dès que j'eus fini ma lecture, madame vous attendra à midi au boudoir de l'autre jour… vous savez bien?… où nous vous avons habillé.—Oui, Justine, et où tu as tant pleuré! Si tu savois comme j'ai souffert pour toi! Mais aussi, friponne, tu ne te contentes pas de faire des malices, tu en dis!—Ne me parlez pas de cela, j'en suis encore toute honteuse… Finissez donc,… donnez-moi votre réponse pour ma maîtresse.—Ma réponse, Justine, est que je n'irai pas au rendez-vous.—Vous n'irez pas?—Non, Justine.—Quoi! vous donnerez ce chagrin-là à ma maîtresse?—Oui, mon enfant.—Mais vous allez me faire gronder.—Je me charge de te consoler d'avance.—Vous êtes bien décidé?—Très décidé, Justine.—Eh bien, en ce cas, faites un bout de lettre,… finissez donc… (elle m'embrassa). Écrivez un mot pour ma maîtresse.—Non, mon enfant, je n'écrirai pas.—Laissez-moi… Mais tenez, je le veux bien encore, à condition que vous écrirez.—Ah! Justine, je le répète, qu'une maîtresse est heureuse d'avoir une fille comme toi! eh bien, oui, j'écrirai.»
J'écrivis en effet:
Je ne sais, Madame, si l'aventure d'hier vous a beaucoup peinée; mais, à la manière dont vous avez rempli votre emploi sur l'ottomane, j'ai lieu de croire qu'il ne vous paroissoit pas très pénible. Quand on a un mari aimable, galant et tendrement aimé, Madame, on doit s'en tenir là. Je suis avec le plus vif regret, etc.
O ma jolie cousine, oh! combien, en songeant à vous, je m'applaudis de l'effort généreux que je venois de faire! oh! qu'il me fut doux de penser qu'enfin je vous avois sacrifié un rendez-vous, et qu'à l'heure même où la marquise avoit cru me revoir chez son amie, je jouirois près de vous du bonheur de vous admirer!
Hélas! elle ne vint pas au parloir. «Ah! ma sœur, pourquoi votre amie n'est-elle pas avec vous?—Je vous disois bien qu'elle étoit malade! Hier encore elle a pleuré toute la journée; de la nuit elle n'a fermé l'œil, la fièvre s'est déclarée ce matin.—La fièvre! Sophie a la fièvre! Sophie est en danger!—Ne parlez pas si haut, mon frère, je ne sais pas s'il y a du danger, mais elle souffre; elle a le teint pâle, les yeux rouges, la tête penchée, la respiration lente, la parole brève et entrecoupée; j'ai cru même surprendre quelques momens de délire. Ce matin, son visage s'est enflammé tout à coup, ses yeux sont devenus vifs et brillans; elle a prononcé très vite et très bas quelques mots que je n'ai pu entendre, mais bientôt elle est retombée dans un accablement plus profond. «Non, non, a-t-elle dit, cela n'est pas possible,… je ne le puis, je ne le dois pas… Jamais il ne le saura.» J'ai vu des larmes couler de ses yeux. Elle a ajouté d'un ton douloureux: «Comme je me suis trompée! J'en mourrai, j'en mourrai; le cruel! l'ingrat!» J'ai pris sa main, elle a serré la mienne, et puis elle m'a redit ce qu'elle me répète sans cesse: «Adélaïde! Adélaïde! ah! que tu es heureuse!» Sa gouvernante rentroit, Sophie m'a encore conjurée de ne lui rien dire. Cependant, mon frère, il faudra que j'avertisse Mme Munich (c'étoit le nom de la gouvernante de Sophie), parce que je crains pour ma bonne amie; qu'en pensez-vous?—Adélaïde, lui avez-vous dit que j'étois ici?—Oui, mais j'avois bien raison de vous soutenir hier qu'elle ne vous aimoit plus, elle me l'a dit elle-même.—Sophie vous a dit…—Oui, Monsieur, elle me l'a dit, et elle m'a chargée de vous le dire. Hier, avant souper, je lui racontois que vous aviez amené avec vous un jeune monsieur fort aimable; elle a demandé son nom, j'ai répondu: «Le comte de Rosambert.—Rosambert? a-t-elle répété avec étonnement, Rosambert? C'est celui qui a mené votre frère chez la marquise de B…! Ce n'est pas un jeune homme honnête. Votre frère en fait son ami, il gâtera tout à fait votre frère… Adélaïde, il commence à se déranger, votre frère.—Ah! ma bonne amie, je lui en ai fait des reproches, et je lui ai même dit que tu ne l'aimes plus.—Vous lui avez dit que je ne l'aime plus!—Oui, ma bonne amie; mais il n'a pas voulu me croire, et il s'est mis à rire, et M. de Rosambert a ri aussi…—Ces messieurs se sont mis à rire! m'a répliqué Sophie d'un ton fâché; votre frère a ri, et n'a pas voulu vous croire! Adélaïde, quand revient-il, votre frère?—Demain, ma bonne amie.—Eh bien! dites-lui qu'il est vrai que j'ai eu de l'amitié pour lui, mais que je n'en ai plus, plus du tout; et qu'afin de l'en convaincre, je ne le reverrai de ma vie.» Elle m'a quittée, et puis un moment après elle est revenue me dire en riant: «Oui, ma chère Adélaïde, tu as raison; je n'aime pas ton frère, je ne l'aime pas. Ne manque pas de le lui dire demain.» Elle rioit; et cependant je vous assure, Faublas, que tout de suite elle s'est mise à pleurer.»
Tandis qu'Adélaïde me parloit, mon cœur étoit pénétré de douleur et de joie!
«Il faut, reprit ma sœur, il faut que je vous fasse part d'une singulière idée qui m'étoit venue dans l'esprit, je ne sais comment, je ne sais pourquoi. En voyant ma bonne amie rire et pleurer en même temps, je ne puis m'empêcher de craindre qu'elle ne soit un peu folle; cependant il y a là dedans quelque mystère que je ne pénètre pas. Sûrement quelqu'un lui donne du chagrin… Mon frère, j'ai vraiment eu peur que ce ne fût vous. Pourquoi le hait-elle à présent? me suis-je dit. Pourquoi ne veut-elle plus le voir? Seroit-ce lui qu'elle appelle ingrat et cruel?… Vous sentez bien, Faublas, qu'en y réfléchissant un peu, je me suis convaincue que cette idée n'étoit pas raisonnable… Mon frère, un ingrat! un cruel! cela ne se peut pas. Et puis, quel mal a-t-il fait à ma bonne amie? quel mal auroit-il pu lui faire?
—Adélaïde! m'écriai-je, ma chère Adélaïde!
—Comment! vous pleurez? me dit-elle; seriez-vous fâché contre moi? Je vous assure que j'ai pensé tout cela malgré moi, et que je ne vous l'ai pas dit pour vous offenser.—Je le sais bien, ma chère sœur, je le sais bien; c'est la maladie de ta bonne amie qui me fait pleurer.—Mon frère, pensez-vous qu'elle puisse devenir sérieuse? Pensez-vous que je doive avertir la gouvernante de Sophie?—Non, Adélaïde, non, ne l'avertis pas. Ta bonne amie a la fièvre, comme tu dis bien; et je connois un remède qui la guérira. Adélaïde, je vous apporterai demain matin la recette écrite sur un morceau de papier soigneusement cacheté; vous ne montrerez ce papier à personne: vous le donnerez à Sophie, quand Mme Munich ne sera pas avec elle; il est essentiel que Mme Munich ne voie pas ce papier. Vous m'entendez bien?—Oui, oui, soyez tranquille. Ah! que je vous aurai d'obligations, si vous guérissez ma bonne amie!—Adélaïde, dites à ma jolie cousine que je crois connoître son mal, que je le partage, et que j'espère lui rendre sa tranquillité. Lui direz-vous bien cela, ma sœur?—Ah! mot pour mot! vous connoissez son mal, vous le partagez, vous le guérirez, mon frère; je lui dirai même que vous avez pleuré. Mais ne manquez pas de venir demain, demain apportez la recette, et, en attendant, ne négligez rien pour que son succès soit entier; gardez-vous de ne vous en rapporter qu'à vous seul, vous n'êtes pas médecin, mon frère: courez aujourd'hui chez les plus célèbres d'entre eux, voyez, interrogez, consultez. La maladie n'est pas ordinaire; jamais je n'en ai vu de semblable, et je tremble qu'elle ne devienne infiniment dangereuse. Bon Dieu! si, en voulant détruire le mal, vous alliez le rendre incurable! Mon frère, il faut que la guérison soit radicale, et prompte aussi, bien prompte! Hâtez-vous, hâtez-vous pour Sophie qui souffre, qui dépérit, qui brûle; pour moi qui suis si malheureuse de sa peine, et, tenez, pour vous-même, mon frère, car ma bonne amie, dès qu'elle se portera bien, vous aimera sans doute autant qu'elle vous aimoit autrefois.»
Revenu chez moi, je ne m'occupai que des discours d'Adélaïde, que des peines de Sophie. Malheureusement mon père donnoit à dîner ce jour-là. Il fallut d'abord tenir table, et faire ensuite un maudit brelan, qui me retint jusqu'à plus de minuit. Quel tourment, quand on aime bien, quand on se croit aimé, quand on veut écrire à sa maîtresse, quel tourment d'être obligé de jouer toute la soirée! Je ne le souhaite pas à mon plus cruel ennemi.
On devine que je dormis peu cette nuit. Le lendemain, je passai dans un petit cabinet pratiqué au fond de ma chambre à coucher; j'avois là quelques livres d'étude, dont mon commode gouverneur ne m'ennuyoit pas souvent. Je me mis à mon secrétaire. J'écrivis une première lettre, que je déchirai; j'en fis une seconde, pleine de ratures, qu'il falloit bien corriger; et je prie le lecteur de ne pas dire que j'aurois dû recommencer encore la troisième, que voici:
Ma jolie cousine,
Il est enfin venu ce moment tant souhaité où je puis librement vous ouvrir mon cœur, solliciter de votre tendresse un aveu bien doux, et peut-être assurer ainsi notre bonheur commun.
Ah! Sophie, Sophie! si vous saviez ce que j'éprouvai le premier jour que je vous vis! Comme ma vue se troubla! comme mon cœur fut agité! Mon amour n'a fait qu'augmenter depuis: un feu dévorant circule aujourd'hui dans mes veines… Sophie, je n'existe plus que par toi!
J'en étois là, quand Jasmin, entrant brusquement, m'annonça le vicomte de Florville. «Le vicomte de Florville! je ne le connois pas. Dites que je n'y suis pas.—Monsieur, il est dans votre chambre à coucher.—Comment! vous laisseriez donc entrer toute la terre?—Monsieur, il a forcé la porte.—Au diable le vicomte de Florville!»
Tremblant que cet inconnu si peu civil ne vînt jusque dans mon cabinet, et que d'un coup d'œil profane il ne parcourût ce papier dépositaire de mes plus secrets sentimens, je me précipitai dans ma chambre à coucher. Un cri de surprise et de joie m'échappa: ce prétendu vicomte, c'étoit la marquise de B…! Mon premier mouvement fut de pousser Jasmin dehors; le second, de verrouiller la porte; le troisième, d'embrasser le charmant cavalier; le quatrième!… Les esprits pénétrans l'ont déjà deviné.
La marquise, toujours étonnée de ma vivacité, dès qu'elle eut repris ses esprits, me dit: «Vous êtes un bien singulier jeune homme, ne vous lasserez-vous jamais de prendre ainsi le roman par la queue? Il n'y a que vous dans le monde capable de commencer un raccommodement par où il doit finir.—Eh bien, maman, prenez qu'il n'y ait rien de fait, voyons, disputons-nous.—Oui, afin de nous raccommoder encore, n'est-il pas vrai, petit libertin?—Ah! ma chère maman, je n'ai pas une idée que vous ne compreniez d'abord.—Hier pourtant vous ne m'avez pas comprise, ingrat que vous êtes!—Hier, je boudois encore.—Et de quoi, s'il vous plaît? Pouvois-je soupçonner que vous fussiez sous cette ottomane? N'étoit-il pas essentiel, pour vous et pour moi, de retirer ce portefeuille des mains du marquis?—Tout cela est vrai, maman; mais le dépit…—Le dépit! Vous avez du dépit! vous, pour qui j'oublie mes devoirs,… toutes les bienséances,… le soin même de ma réputation; et de quel ton répondez-vous à la lettre la plus tendre? (Elle tira la mienne de sa poche.) Tenez, ingrat, relisez-la, votre lettre; relisez-la de sang-froid, si vous pouvez. Quelle cruelle ironie! quel persiflage amer! Et cependant je vous pardonne! et cependant je viens vous chercher! Je me conduis avec autant de foiblesse et d'imprudence qu'un enfant de douze ans… Faublas! Faublas! il faut que le charme soit bien fort!… il faut… que vous m'ayez ensorcelée!—Petite maman!—Eh bien?—Grondez-moi fort, parce que nous nous raccommoderons.—Comment! fripon, vous n'avouerez seulement pas que vous avez eu tort? Vous ne me demanderez pas pardon?—Si fait!… oh! que vous êtes belle!… oh! que je vous demande pardon!»
Les gens qui ont de l'esprit, et même ceux qui n'en ont pas, devineront encore qu'ici la marquise et moi nous nous raccommodâmes.
On croit que nous allons recommencer à nous quereller; point du tout. Voici l'instant des petites caresses et des complimens tendres. «Mon Dieu! Florville! que vous êtes séduisant dans ce joli négligé! que ce frac anglais vous va bien!—Mon ami, je l'ai fait faire hier tout exprès. Il est, si je ne me suis pas trompée, de la même étoffe et de la même couleur que ce charmant habit d'amazone dans lequel l'amour, qui vouloit ma défaite, te fit paroître à mes yeux pour la première fois. Devenue chevalier de Mlle Duportail, j'ai senti qu'il me convenoit de prendre ses couleurs. (Je la serrai dans mes bras.)—Et moi, désormais l'esclave du vicomte de Florville, je me plairai toujours à porter ses chaînes. Maman, quelle douce réciprocité!—Mon ami, l'amour est un enfant qui s'amuse de ces métamorphoses. Il fit de Mlle Duportail une vierge folle, il fait de la marquise de B… un jeune homme imprudent. Ah! puisse le vicomte de Florville te paroître aussi aimable que Mlle Duportail me sembla jolie!…—Aussi aimable?… ah! bien davantage!—Oh! non, répondit-elle en se mirant avec complaisance, en me considérant avec tendresse; oh! non. Vous êtes mieux, mon ami, plus grand, plus dégagé. Il y a dans votre air quelque chose de hardi, de martial…—Oui, maman, et, si j'en crois un grand physionomiste, quelque chose de plus nerveux…—Faublas, laissez là monsieur le marquis,… n'est-ce pas assez du mauvais tour que nous lui jouons?… Enfin, je ne suis pas venue ici pour m'occuper de lui… Oh çà, mon ami, dis-moi sans flatterie comment tu me trouves.—Bien, plus que bien. Je n'aurois pas de peine à vous dire comment vous êtes mieux; mais puisque absolument, homme ou femme, il faut qu'on s'habille, ah! je défie que, d'une manière ou de l'autre, personne soit jamais aussi jolie que vous.—Voilà bien le langage d'un amant! toujours enthousiaste, toujours exagéré!… Mon cher Faublas, quelle femme sera plus heureuse que moi, si tu me vois toujours des mêmes veux?…—Oh! maman, toute ma vie!»
Je la tenois dans mes bras; elle m'échappa pour aller prendre une épée qu'elle aperçut sur un fauteuil. En ajustant le ceinturon, elle me dit: «J'ai un joli cheval anglois que je monte quelquefois, nous touchons au printemps, j'aime beaucoup à me promener à cheval dans les environs de Paris: voudrez-vous bien m'accompagner quelquefois, Faublas?… Veux-tu, mon ami, t'égarer de temps en temps dans les bois avec le vicomte de Florville?—Mais on nous verra.—Non, le marquis est souvent obligé d'aller à la cour.—Eh bien, maman, quel jour?—Laissez donc paroître la verdure.»
En me parlant, elle avoit tiré mon épée, et, s'escrimant en face de moi: «En garde, Chevalier! me dit-elle.—Je ne sais pas si le vicomte est redoutable, mais ce que je sais bien, c'est que ce n'est pas ainsi que je dois me battre avec la marquise. Ose-t-elle accepter une autre espèce de combat?» Elle vola dans mes bras. «Ah! Faublas, me dit-elle en riant; ah! s'il n'y en avoit pas de plus meurtriers…—Maman, ce ne seroit plus parmi les hommes qu'on chercheroit des héros.»
Je venois de mettre la marquise hors d'état de me battre, et bien m'en prit.
Ma belle maîtresse me donna encore deux heures que nous employâmes passablement bien. «Si je n'écoutois que mon cœur, me dit-elle enfin, je resterois ici toute la journée; mais voici l'heure à laquelle je dois rejoindre Justine dans un endroit, et mes gens dans un autre.» Nous nous dîmes adieu, je reconduisis poliment le vicomte de Florville. Déjà sortis de mon appartement, nous allions descendre l'escalier, lorsqu'à travers les rampes je distinguai, dans le vestibule, Rosambert qui se disposoit à monter. J'en avertis la marquise. «Rentrons promptement, me dit-elle, je vais me cacher dans quelque coin de votre appartement, vous le renverrez vite.» A ces mots, sans me donner le temps de la réflexion, elle rentra, traversa ma chambre à coucher comme une folle, et se jeta dans mon cabinet.
Rosambert entra: «Bonjour, mon ami, comment se porte Adélaïde? comment se porte la jolie cousine?—Chut! chut! ne me parlez pas de cela, mon père est là.—Où?—Dans ce cabinet.—Dans ce cabinet! votre père?—Oui.—Et que fait-il là?—Il examine des livres.—Comment, vos livres! Mais non, il n'est pas dans ce cabinet, car, tenez, le voilà qui entre… Il y a de la marquise dans tout ceci… Et pourquoi ne pas me dire tout bonnement que vous êtes en affaire? Adieu, Faublas, à demain.» Il passa devant mon père, et le salua: «Monsieur, vous avez quelque chose à dire à monsieur votre fils: je vous laisse…»
Cependant le baron me regardoit d'un air sévère et se promenoit à grands pas. Impatient de savoir ce que m'annonçoit cet abord sinistre, je lui demandai respectueusement pourquoi il m'avoit fait l'honneur de monter chez moi. «Vous le saurez tout à l'heure, Monsieur.» Un domestique parut. «Va-t-il venir? cria le baron.—Le voilà, Monsieur», et mon cher gouverneur entra.
Le baron lui dit: «Monsieur, ne vous ai-je pas chargé de la conduite et de l'éducation de mon fils?—Oui, sans doute…—Eh bien, Monsieur, l'une est très négligée, et l'autre très mauvaise.—Monsieur, ce n'est pas ma faute; monsieur votre fils n'aime pas l'étude…—C'est là le moindre mal, interrompit le baron; mais comment ne suis-je pas instruit de ce qui se passe chez moi? Pourquoi ne m'avertissez-vous pas des désordres de mon fils?—Monsieur, quant à ce qui se passe chez vous, je ne puis répondre que de ce que je vois; au dehors je ne puis répondre de rien. Monsieur votre fils, quand il sort, souffre rarement que je l'accompagne, et…» (Un regard que je jetai sur M. Person l'avertit qu'il en avoit assez dit.) Le baron reprit: «Monsieur, je n'ai qu'un mot à vous dire: si ce jeune homme se conduit toujours aussi mal, je me verrai forcé de lui choisir un autre instituteur. Laissez-nous, je vous prie.»
Lorsque M. Person fut sorti, le baron prit un fauteuil et me fit signe de m'asseoir. «Pardon, mon père, mais j'ai affaire.—Je le sais, Monsieur, et c'est précisément pour que cette affaire ne s'achève pas que je viens vous parler.—Mon père,… encore une fois pardon; mais il faut que je sorte…—Non, Monsieur, vous resterez, asseyez-vous.» Il fallut bien s'asseoir, j'étois sur les épines. Le baron commença.
«Se peut-il que Faublas ait de sang-froid médité des horreurs? Se peut-il qu'il veuille abuser la simple innocence et préparer des pièges à la vertu?—Moi, mon père?—Oui, vous. Je viens du couvent, je sais tout.
«Si mon fils, encore trop jeune pour sentir que plus une conquête est aisée, moins elle est flatteuse; qu'il faut se garder de confondre une intrigue avec une passion; que l'amour du plaisir ne fut jamais de l'amour…—Mon père, daignez parler moins haut.—Si mon fils, trop enivré de ce qu'on ne peut appeler qu'une bonne fortune…—Plus bas, je vous en supplie.—Trop charmé de la découverte d'un sens nouveau et de la possession d'une femme qui n'est pas sans attraits; si mon fils dans les bras de la marquise de B…—C'en est trop, de grâce, mon père.—Avoit oublié son père, son état, ses devoirs, je l'aurois plaint, mais je l'aurois excusé; je lui aurois donné les conseils d'un ami; je lui aurois dit: «Plus la marquise…»—Mon père, si vous saviez…—Plus la marquise est belle, et plus elle est dangereuse. Examine avec moi la conduite de cette femme dont tu es épris. Au premier coup d'œil ta figure la décide: elle te prend en une soirée…—Je vous conjure de ménager…—Pour satisfaire sa folle passion, elle expose sa vie et la tienne. Qu'elle doit être vive, ardente, emportée celle…—Mon Dieu!—Celle qui sacrifie à la soif du plaisir son repos, son honneur, l'estime publique!…—Ah! mon père! Ah! Monsieur!—Je le répète, mon ami: plus la marquise est belle, plus elle est dangereuse! Tu croiras dans ses bras que la nature a des ressources inépuisables…»
Désolé de ne pouvoir m'expliquer, bien convaincu que le baron ne se tairoit pas, je me déterminai à attendre patiemment la fin de cette remontrance, que dans une autre occasion je n'aurois peut-être pas trouvée trop longue. Le coude gauche posé sur le bras de mon fauteuil, je mordois ma main de dépit, et mon pied droit, toujours en mouvement, battoit la mesure sur le parquet. Mon père cependant continuoit.
«Tu l'énerveras, la nature, au moment de la puberté, dans cet âge critique où, travaillant au développement des organes, elle a besoin de toutes ses forces pour achever son ouvrage. Je sais bien que l'excès des plaisirs produira la satiété; mais le dégoût viendra trop tard peut-être, mais déjà tu pleureras ta santé détruite, ta mémoire perdue, ton imagination flétrie, toutes tes facultés altérées. Infortuné! tu deviendras à la fleur de ton âge la proie des noirs chagrins, des infirmités repoussantes; et, dans les horreurs d'une vieillesse prématurée, tu gémiras d'être obligé de supporter le fardeau de la vie… O mon ami, redoute ces malheurs plus communs qu'on ne pense; jouis du présent, mais songe à l'avenir; use de ta jeunesse, mais garde des consolations pour l'âge mûr.
«Cependant, ajouta le baron, mon fils, peu touché de mes représentations paternelles, auroit donné, en m'écoutant, mille signes d'impatience; il se seroit dandiné sur son fauteuil; il m'auroit interrompu cent fois: je n'aurois pas eu l'air de m'en apercevoir. Plus effrayé de ses dangers que sensible à mes injures, j'aurois continué tranquillement, je lui aurois dit: «La marquise de B…»
On conçoit ce que je souffrois depuis un quart d'heure. Je ne pus contenir davantage mon impatience longtemps concentrée. «Eh! mon père, m'écriai-je, n'auriez-vous pas pu lui dire tout cela un autre jour?» Le baron étoit naturellement violent, il se leva furieux. Craignant l'effet d'un premier transport, je me sauvai dans le cabinet, dont je poussai la porte sur moi.
J'y trouvai la marquise dans une situation bien pénible. Les bras appuyés sur le devant de mon secrétaire, elle tenoit avec ses mains ses oreilles bouchées, et lisoit, en sanglotant, un papier posé devant elle. Je m'approchai de ma belle maîtresse. «Oh! Madame, combien je suis désolé!…» La marquise me regarda d'un air égaré: «Cruel enfant! quelles fautes tu m'as fait faire!—Parlez donc plus bas.—Mais quel châtiment j'en reçois!—De grâce, parlez plus bas.—Ton père…, ton indigne père,… il ose…—Mon amie, vous allez vous perdre!—Mais tu es cent fois plus cruel que lui. Tiens. Regarde cet écrit funeste,… vois ces caractères perfides… Mes pleurs les ont effacés. (Elle me montroit la lettre commencée pour Sophie.)
—Faublas, cria le baron, ouvrez cette porte. Vous n'êtes pas seul dans ce cabinet?—Pardonnez-moi, mon père.—J'entends quelqu'un vous parler. Ouvrez cette porte.—Mon père, je ne le puis.—Je le veux; ne me laissez pas appeler mes gens.» La marquise se leva brusquement. «Faublas, dites-lui que vous êtes avec un de vos amis qui demande la permission de sortir.—De sortir!—Oui, reprit-elle avec désespoir; quelque honte qu'il y ait à sortir, il y en aura moins qu'à rester.—Mon père, je suis avec un de mes amis qui demande la liberté de sortir.—Avec un de vos amis?—Oui, mon père.—Eh! que ne me disiez-vous plus tôt qu'il y avoit quelqu'un dans ce cabinet? Ouvrez, ouvrez, ne craignez rien: je suis tranquille. Votre ami peut sortir.
—Conduisez-moi», me dit la marquise. Elle se couvrit le visage avec ses mains: j'ouvris la porte, nous entrâmes dans la chambre à coucher; nous allions gagner la porte opposée qui conduisoit à l'escalier. Mon père, étonné des précautions que l'inconnu prenoit pour se cacher, se jeta sur notre passage; il dit à ma malheureuse amie: «Monsieur, je ne vous demande pas qui vous êtes; mais vous permettrez au moins que j'aie l'honneur de vous voir.—Mon père, je vous conjure pour mon ami de ne pas exiger…—Que signifie donc ce mystère? interrompit le baron. Quel est donc ce jeune homme qui se cache chez vous, et qui craint qu'on ne le voie en face? Je prétends le savoir à l'instant…—Mon père, je vous le dirai; je vous donne ma parole d'honneur que je vous le dirai.—Non, non. Monsieur ne sortira pas que je ne le sache…» La marquise se jeta dans un fauteuil, le visage toujours couvert de ses mains. «Monsieur, vous avez des droits sur un fils; mais sur moi, je ne le croyois pas.» Le baron, entendant le son clair d'une voix féminine, soupçonna enfin la vérité. «Quoi! s'écria-t-il, il se pourroit… Oh! que je suis fâché!… que j'ai de regrets!… que d'excuses!… Mon fils, vous devez sentir que votre père, jaloux de vous rendre à vos devoirs, s'est permis sur le compte de Mme la marquise de B… des expressions trop fortes que le baron de Faublas désavoue. Mon fils, reconduisez votre ami.»
La marquise, dès que nous fûmes dans l'escalier, donna un libre cours à ses larmes. «Que je suis cruellement punie de mon imprudence!» disoit-elle. Je voulus hasarder quelques mots de consolation. «Laissez-moi! Votre barbare père est moins barbare que vous!»
Nous étions dans le vestibule. J'ordonnai qu'on allât promptement chercher un fiacre, et, en attendant qu'il arrivât, je fis entrer la marquise dans la loge du suisse. Il n'y avoit qu'un instant que nous y étions, lorsqu'un homme présenta sa figure par le vagislas[7] entr'ouvert, et demanda si le baron étoit chez lui. La marquise se cacha le visage dans ses mains; je me jetai devant elle pour la couvrir de mon corps; mais tout cela ne put se faire assez promptement. M. Duportail (car c'étoit lui) eut le temps de jeter un coup d'œil sur la marquise. «Monsieur, le baron est chez moi; si vous voulez prendre la peine d'y monter, je vous rejoins dans un moment.—Oui! oui!» me répondit M. Duportail en souriant.
[7] Vagislas. C'est le nom qu'on donne à la vitre que les portiers ouvrent et ferment à volonté.
On vint nous dire que la voiture étoit à la porte. La marquise monta promptement; je voulus m'y placer un moment auprès d'elle. «Non, non, Monsieur, je ne le souffrirai pas.» La douleur dont je voyois son cœur serré passa dans le mien. Je laissai tomber quelques larmes sur une de ses mains que j'avois saisie, et qu'elle ne retiroit pas. «Ah! vous vous croyez auprès de Sophie!» Je voulus encore entrer dans le carrosse, elle retira sa main et me repoussa. «Monsieur, si, malgré les discours de votre père, il vous reste encore quelque estime, quelque considération pour moi, je vous prie de descendre et de me laisser.—Hélas! ne vous reverrai-je donc plus?» Elle ne me répondit pas; mais ses larmes recommencèrent à couler avec plus d'abondance. «Ma chère maman, quand pourrai-je vous revoir? Dans quel lieu me permettrez-vous…?—Ingrat! je suis trop sûre que vous ne m'aimez pas; mais vous devez me plaindre au moins… Laissez-moi… Remontez chez vous, le baron vous y attend.» Elle dit au cocher de la conduire chez Mme ***, marchande de modes, rue ***. Il fallut bien me décider à la quitter.
Je retrouvai dans l'escalier M. Duportail qui m'y attendoit. «Mon ami, si je suis aussi bon physionomiste que le marquis de B…, ce si joli garçon que vous quittez, c'est sa belle moitié!… Mais qu'avez-vous donc? vous pleurez!» Je ne sais où M. Person s'étoit fourré, nous le vîmes tout à coup derrière nous; il me dit d'un ton suffisant: «Je savois bien, Monsieur, que tout cela finiroit mal; vous ne faites aucun cas de mes avis.—Vos avis, Monsieur, faites-m'en grâce… En vérité, c'est précisément le maître d'école de La Fontaine; je me noie, et il me sermonne!—Mais qu'est-ce donc que tout cela? reprit M. Duportail.—Montez, montez chez moi, vous allez le savoir; mon père m'a fait une scène!»
En entrant, M. Duportail demanda au baron ce qu'il y avoit. «Ce qu'il y a?» répondit mon père. Je l'interrompis. «Ce qu'il y a, Monsieur Duportail, ce qu'il y a!… Tenez, Mme de B… étoit dans ce cabinet: mon père entre ici, il s'assied là, il me fait des représentations, sans doute très justes, très paternelles; mais la marquise entendoit tout, et mon père la traitoit!… Ah! vous n'en avez pas d'idée! Moi, de peur de compromettre une femme… honnête,… oui, honnête, quoi qu'on en puisse dire, je n'osois m'expliquer; mais mon père connoît le profond respect que je lui porte, jamais je ne m'en suis écarté… Eh bien, il est témoin que je souffre, que je m'impatiente, que je lui manque… Monsieur, il ne sent pas qu'il y a là-dessous quelque chose qui n'est pas naturel! Il continue toujours! Il ne veut rien deviner!—Jeune homme, répliqua le baron, votre excuse est dans vos pleurs; je vous pardonne les reproches que vous osez me faire, à cause de la douleur dont vous paroissez oppressé; mais plus vous semblez aimer la marquise…—Mon père…—Monsieur! Mme de B… n'est plus là: pourquoi donc m'interrompez-vous?… Plus vous semblez aimer la marquise, et plus je suis mécontent de vous. Si votre cœur est préoccupé de cette passion, c'est donc avec froideur que vous avez médité la perte d'une fille vertueuse, d'une enfant respectable, de Sophie? Vous n'êtes donc qu'un vil séducteur?—Mon père, entre Sophie et moi il n'y a d'autre séducteur que l'amour.—Vous n'aimez donc pas la marquise?—Mon père…—Monsieur, que vous soyez ou que vous ne soyez pas véritablement attaché à Mme de B…, vous concevez que je m'en soucie peu; mais ce qui m'importe, c'est que mon fils ne soit pas indigne de moi.—Ah! Baron! interrompit M. Duportail.—Je ne dis rien de trop fort, mon ami. Apprenez des choses qui vont vous étonner. Ce matin, je vais au couvent; je trouve Adélaïde dans les larmes. Ma fille, ma chère fille, dont vous connoissez l'aimable candeur, m'apprend que sa bonne amie est malade, et que son frère tarde bien à apporter l'infaillible remède qu'il a promis pour Sophie. Je la presse de s'expliquer: elle me rend le compte le plus exact des symptômes et des effets de cette maladie que vous devinez, que Monsieur connoît, qu'il a causée, qu'il se plaît à nourrir, qu'il voudroit augmenter. Monsieur abuse de quelques dons naturels pour séduire une enfant trop sensible; il prend sur son esprit un empire absolu; il prépare par degrés son déshonneur.—Son déshonneur! le déshonneur de Sophie?—Oui, jeune insensé, je connois les passions…—Mon père, si vous les connoissez, vous savez que vous déchirez mon cœur!—Mon fils, modérez cette impétuosité qui m'offense… Oui, je connois les passions; oui, cette enfant que vous respectez aujourd'hui, demain peut-être vous la déshonorerez, si elle a la foiblesse d'y consentir… (Il s'adressa à M. Duportail.) La recette que Monsieur destine à sa jolie cousine sera enfermée dans un papier soigneusement cacheté, qu'il ne faut pas que Mme Munich voie… Vous comprenez, mon ami… Ainsi tout est prêt, la correspondance va s'entamer: Sophie, la pauvre Sophie, déjà séduite par les yeux, va l'être bientôt par son cœur. Elle fut trompée par une belle figure, signe ordinaire d'une belle âme; elle va l'être par les charmes non moins perfides d'une éloquence apprêtée; on va, dans des lettres étudiées, affecter avec elle le langage du sentiment; Sophie, attaquée de tous les côtés à la fois, tombera sans défense dans les piéges qu'on lui aura tendus… Et cependant son séducteur n'a pas dix-sept ans! Et dans un âge encore si tendre il montre déjà les goûts funestes, il emploie les odieux talens de ces hommes aussi lâches que dépravés qui, ne craignant pas de porter dans les familles la discorde et la désolation, se font un barbare plaisir d'entendre les gémissemens de la beauté malheureuse, contemplent en s'en applaudissant l'opprobre et les anxiétés de l'innocence avilie. Voilà ce qu'auront produit les dons naturels que je me plaisois à voir en lui, dont j'étois peut-être fier en secret; voilà comment se réaliseront les grandes espérances que j'avois conçues!—Mon père, croyez que j'adore Sophie…» (Le baron, sans m'écouter, s'adressant toujours à M. Duportail:) «Et savez-vous par quelles mains Monsieur compte faire passer ses lettres corruptrices? Savez-vous à qui il confie l'honnête emploi de servir ses détestables projets?… A la vertu la plus pure et la plus confiante, à l'innocente Adélaïde, à ma chère fille, à sa sœur!—Mon père, ne me condamnez pas sans m'entendre. Vous doutez de mes sentimens pour Sophie! Eh bien, daignez nous unir; donnez-la-moi pour épouse.—Et vous disposez ainsi de Sophie et de vous! Les parens de Mlle de Pontis vous connoissent-ils? sont-ils connus de vous? Savez-vous si cet hymen leur convient? Savez-vous s'il me convient à moi? Croyez-vous que je veuille vous marier à votre âge? A peine sorti de l'enfance, vous prétendez à l'honneur d'être père de famille!—Oui; et je sens qu'il vous seroit aussi aisé de consentir à mon mariage qu'il m'est impossible de renoncer à mon amour pour Sophie.—Monsieur, vous y renoncerez pourtant. Je vous défends d'aller au couvent sans moi ou sans mon expresse permission, et je vous déclare que, si vous ne changez pas de conduite, une maison de force me répondra de vous.—Ah! si, au lieu de marier les jeunes gens qui s'aiment, on les renfermoit, mon père, je ne serois pas au monde, et vous seriez en prison.»
Le baron n'entendit pas ma réponse ou feignit de ne pas l'entendre. Il sortit; je retins M. Duportail qui se disposoit à le suivre. Je le priai de vouloir bien être médiateur entre mon père et moi, et d'engager surtout le baron à révoquer l'ordre cruel qui m'interdisoit les visites au couvent. Il m'observa que les précautions dont mon père usoit étoient assez raisonnables. «Raisonnables! voilà comme parlent toujours les gens indifférens! Leur grand mot, c'est la raison! Monsieur, quand vous adoriez Lodoïska, quand l'injuste Pulauski vous priva du bonheur de la voir, vous ne trouvâtes pas ses précautions raisonnables.—Mais, mon jeune ami, remarquez donc la différence…—Il n'y en a aucune, Monsieur, il n'y en a pas. En France, comme en Pologne, un amant digne de ce nom ne voit, ne connoît, ne respire que ce qu'il aime; le plus grand malheur qu'il imagine, c'est celui d'être séparé de l'objet adoré. Les précautions de mon père vous paroissent raisonnables; moi, je les trouve cruelles, je ferai tout ce que je pourrai pour les rendre inutiles. Sophie apprendra mon amour; elle l'apprendra malgré mon père; elle en sera bien aise, et, malgré lui, malgré vous, malgré toute la terre, nous finirons par nous marier, Monsieur, je vous le déclare, et vous pouvez le dire au baron.—Je n'en ferai rien, mon ami, je ne veux pas aigrir votre père, je ne veux pas vous chagriner. Dans ce moment-ci vous avez la tête un peu exaltée, je vous laisse faire des réflexions sages, et dès demain, sans doute, vous serez plus raisonnable.—Raisonnable! oui, raisonnable! je m'y attendois bien.»
Resté seul, je ne songeai qu'aux moyens d'éluder la défense du baron ou de la rendre vaine. Censeur austère, qui me blâmez de mon indocilité, je vous plains. Si de vos maîtresses la première ou la plus chérie ne vous fit jamais faire de fautes, ah! c'est que vous n'avez jamais beaucoup aimé.
En y songeant mûrement, je vis que ma situation, quelque pénible qu'elle dût me paroître, n'étoit pas désespérée. Rosambert, compatissant aux peines de son ami, m'aideroit sans doute; Jasmin m'étoit entièrement dévoué; et je croyois connoître assez mon petit gouverneur pour être sûr qu'avec de l'or je ferois de lui tout ce que je voudrois. M. Duportail paroissoit vouloir rester neutre, je n'aurois que mon père à combattre. Mon père, occupé de son intrigue avec cette belle demoiselle de l'Opéra, sortoit tous les soirs; il ne pouvoit donc pas me veiller de très près. Voilà les réflexions sages que je faisois: ce n'étoient pas celles que M. Duportail m'avoit conseillées; mais je ne le trahissois pas, je l'avois prévenu.
Cependant il ne falloit pas dans les premiers jours heurter le baron de front; je devois prudemment m'interdire, pendant quelque temps, les visites au couvent; mais comment faire passer une lettre à Sophie? Cette lettre étoit si pressée, si nécessaire! Qui la porteroit à ma jolie cousine? Je ne voyois aucun expédient pour me tirer de cet embarras. Parmi les ressources que je m'étois ménagées, je n'avois pas calculé celles qui me restoient dans l'amitié d'Adélaïde.
Une vieille femme m'apporte un billet; je l'ouvre: il est signé de Faublas! Ah! ma chère sœur! Je baise l'écriture et je lis:
Je crains bien d'avoir commis tout à l'heure une indiscrétion; mon frère, j'ai appris à mon père que vous m'aviez promis un remède qui guériroit ma bonne amie: il s'est fâché; il a dit que c'étoit du poison que vous prépariez pour Sophie!… Du poison!… Mon frère, en vérité, je ne l'ai pas cru, quoique ce fût le baron qui l'assurât.
J'ai conté tout cela à ma bonne amie, qui attendoit impatiemment la recette en question. «Adélaïde, m'a-t-elle dit, vous avez eu tort d'en parler au baron… Ce remède de votre frère n'est peut-être pas bien bon; mais enfin nous aurions vu ce que c'est.» Au reste, mon frère, soyez tranquille; elle ne croit pas plus que moi que vous ayez voulu l'empoisonner.
Comme j'ai vu qu'elle mouroit d'envie d'avoir la recette, je lui ai conseillé de vous l'envoyer demander. Elle m'a encore répété ces mots qui me chagrinent: «Adélaïde! Adélaïde! ah! que tu es heureuse!»
Cependant je suis sûre qu'elle seroit bien aise d'avoir la recette. Envoyez-la-moi tout de suite, mon frère, je la lui remettrai, et je vous assure que je ne parlerai de rien à personne.
Donnez trois livres à la femme porteuse du billet: elle m'a dit qu'elle ne jasoit jamais quand on lui donnoit un petit écu. Votre sœur, etc.
Adélaïde de Faublas.
P.-S. Tâchez de me venir voir.
Transporté de joie, je vais à la vieille: «Madame, voilà six francs, parce que je vais vous charger d'une réponse que je vous prie d'attendre.»
Je rentre dans mon cabinet, je me mets à mon secrétaire: la lettre commencée pour Sophie est devant moi; je la vois encore mouillée de larmes… Hélas! ces pleurs, c'est la marquise qui les a versés! Quels discours elle a entendus! Quelle lettre elle a lue!… Pauvre vicomte de Florville! que de chagrins mon père et moi nous t'avons donnés!… En me disant cela, je baise le papier sur lequel la marquise a tant gémi, et le sentiment que j'éprouve alors, s'il est moins vif que l'amour, est cependant plus tendre que la pitié.
Je reviens à moi, je songe à Sophie. Ce papier, détrempé en plusieurs endroits, n'est pas présentable; il faut recommencer la lettre trois fois écrite… Et pourquoi donc recommencer? Au nom, au seul nom de ma jolie cousine, je sens déjà mes paupières s'humecter; je vais sangloter en lui écrivant! Sophie saura-t-elle que deux personnes ont pleuré sur le même papier? Moi-même pourrois-je, entre ces larmes confondues, distinguer celles qui seront venues de la marquise de B… et celles qui m'auront appartenu?… Ces réflexions me déterminent; je ne recommence pas, je continue:
… Sophie, je n'existe plus que par toi! et cependant tu te plains! tu gémis! tu m'accuses d'ingratitude et de cruauté! Tu crois, tu peux croire qu'il existe au monde une femme, une seule femme comparable à toi! une femme qu'on puisse aimer quand on connoît Sophie!
O ma jolie cousine! avec quel transport j'ai reçu la nouvelle de votre tendresse pour moi! Mais quelle douleur j'ai ressentie en apprenant qu'un noir chagrin consumoit vos beaux jours, altéroit vos charmes naissans, menaçoit votre vie!… Votre vie!… Ah! Sophie, si Faublas vous perdoit, il vous suivroit au tombeau!
Ma sœur, qui m'a dévoilé, sans le vouloir, les plus secrets sentimens de votre âme, ma sœur m'a annoncé de votre part une éternelle séparation… Elle m'a dit que vous ne me reverriez de la vie… Ma Sophie! s'il étoit vrai, elle ne dureroit pas longtemps cette vie qui me deviendrait insupportable; et vous-même! vous-même!… Mais livrons-nous à des idées plus douces, un avenir plus heureux nous attend. Qu'il me soit permis d'espérer que ma jolie cousine sera bientôt mon épouse, et que, tous deux réunis, nous ne cesserons jamais d'être amans. Je suis, avec autant de respect que d'amour, votre jeune cousin, le chevalier de Faublas.
Cette lettre cachetée, il en fallut faire une autre.
Que vous avez bien fait de m'écrire, ma chère Adélaïde! Je suis privé du bonheur de vous voir: le baron me défend de sortir, le baron m'a fait une scène!… Il ne falloit pas lui parler de Sophie.
Remettez promptement à ma jolie cousine le billet que je lui adresse, et que je joins au vôtre; ne le lui remettez que quand elle sera seule, et surtout ne parlez de cela à qui que ce soit. Adieu, ma chère sœur, etc.
Je mis ces deux billets sous une même enveloppe, et je confiai le tout à la discrétion de la vieille.
Dès le même soir je voulus travailler à former la grande confédération que j'avois méditée. Mon père venoit de sortir: je demandai M. Person; il étoit allé promener aussi. Il ne rentra qu'un peu tard, et vint à moi d'un air triomphant: «Monsieur, vous avez entendu ce matin monsieur votre père; il m'a remis sur vous un absolu pouvoir.—Monsieur Person, vous m'en voyez ravi. Je suis en effet trop heureux d'avoir un gouverneur tel que vous, un gouverneur complaisant, honnête, indulgent surtout.—Monsieur, je savois bien qu'un jour vous me rendriez justice.—Un gouverneur plein de politesse et d'aménité…—Vous me flattez, Monsieur.—Un gouverneur qui sent bien qu'un enfant de seize ans ne peut être aussi raisonnable qu'un homme de trente-cinq…—Assurément.—Un gouverneur qui connoît le cœur humain…—Cela est vrai.—Et qui excuse, dans son élève, un doux penchant que lui-même il éprouve.—Je ne comprends pas trop…—Asseyez-vous, Monsieur Person; nous avons à traiter ensemble une matière fort délicate, qui mérite toute votre attention… Parmi tant de qualités qui brillent en vous, et dont j'aurois pu faire une énumération plus longue, si je n'avois craint de blesser votre modestie; parmi tant de qualités, il faut vous le dire franchement, Monsieur Person, j'ai cru m'apercevoir qu'il vous en manquoit une, qu'on dit fort importante, mais que je regarde comme assez inutile, moi! celle de savoir enseigner.—Monsieur, mais…—Je ne dis pas cela pour vous mortifier. Je suis très persuadé que ce n'est pas l'érudition qui vous manque; mais on voit tous les jours des gens, aussi malheureux qu'habiles, qui enseignent très mal ce qu'ils savent très bien. Vous êtes dans ce cas-là, Monsieur Person; et, à cet égard, pour me servir des expressions dont usoit le fameux cardinal de Retz en parlant du grand Condé, vous ne remplissez pas votre mérite.—Oh! Monsieur, la citation…—N'est pas tout à fait juste, je le sens bien. Vous n'êtes point conquérant, vous! vous n'avez pas une armée à conduire! Mais aussi, former le cœur d'un adolescent; étudier ses goûts pour les combattre ou les diriger; amortir ou modifier ses passions, quand on n'a pu les prévenir; polir ses manières gauches et orner son esprit inculte, croyez-vous que cela soit une chose si facile?—Non, sûrement; je sais que ma profession offre de grandes difficultés.—Eh bien! Monsieur, les parens n'entendent pas cela. Ils cherchent un gouverneur qui ait tous les talens et toutes les vertus! et ils croient que cela se trouve! C'est un homme qu'ils payent, et c'est un dieu qu'il leur faudroit! Mais revenons à ce qui nous touche… J'ai encore remarqué, Monsieur Person, que votre attachement singulier pour tout ce qui porte le nom de Faublas vous a mené trop loin.—Comment?…—Oui, cette extrême affection que vous portez à la famille en général, vous ne l'avez pas également reversée sur chacun de ses membres!—Je n'entends pas.—Tenez, vous avez pour ma sœur des airs de prédilection!… Le baron appelleroit cela de l'amour… La difficulté que vous éprouvez à enseigner, il la nommeroit ineptie. Ce que je vous dis est exact: si j'instruisois le baron de ces petits détails-là, vous ne resteriez pas vingt-quatre heures dans cet hôtel. Ce seroit un grand malheur pour moi, Monsieur Person, et un plus grand malheur pour vous. Je sais bien qu'on me chercheroit vite un autre instituteur; mais, comme nous le disions tout à l'heure, il n'y a pas d'homme parfait sur la terre. En supposant que le nouveau venu se trouvât plus propre que vous à m'instruire, les premiers jours il me donneroit avec distraction des leçons que je recevrois avec ennui; et au diable les livres, dès que je l'aurois surpris bâillant avec moi dessus! Cependant mon nouveau Mentor participeroit aux foiblesses de l'humanité, il auroit des défauts ou des passions que je connoîtrois vite, parce que je serois intéressé à les étudier. Animé des mêmes motifs, il pénétreroit mes goûts avec le même discernement. La première semaine, nous nous serions observés comme deux ennemis qui se craignent; au bout de huit jours, nous nous traiterions comme deux amis également intéressés à se ménager. Cependant vous, Monsieur Person, vous ne trouveriez peut-être pas à faire ce que vous appelez une éducation. Je sais que beaucoup de petits abbés qui ont moins de mérite que vous trouvent des élèves, et même les conservent; mais tant d'autres aussi végètent sans emploi! Vous seriez peut-être réduit à recommencer le rudiment et la grammaire avec les enfans gâtés d'un notaire-marguillier, d'un marchand presque échevin, ou de quelque gros employé, tous gens trop fiers pour envoyer messieurs leurs fils à l'Université. Et, prenez-y garde, les gens d'affaires, qui savent calculer, veulent toujours accorder leur intérêt avec leur vanité: ils vous diront très bien que Restaut tout entier ne vaut pas une page de Barrême; et, si vous n'apprenez à vos petits bourgeois qu'à parler leur langue, si vous ne possédez pas à fond la science des chiffres, le maître d'arithmétique sera beaucoup mieux payé que vous. Je veux vous épargner ces désagrémens-là, Monsieur. Je sens qu'il seroit dur pour le gouverneur d'un noble de devenir le précepteur d'un roturier: je ne prétends pas changer votre condition, mais la rendre meilleure; au lieu de diminuer vos émolumens, je vais les augmenter.—Monsieur, je suis très sensible… J'ai toujours bien dit que chez vous les qualités du cœur…—Oh! les qualités du cœur! Oui, mon cher gouverneur, j'ai un cœur extrêmement bon, extrêmement sensible… Vous savez que j'adore Sophie! Mon père veut m'empêcher de la voir.—Mais, au fond, a-t-il tort?—Comment! Monsieur, s'il a tort! vous me demandez s'il a tort! Mais vous n'avez donc pas compris ce que je vous ai dit?—Pas très bien.—Je vais m'expliquer clairement. Si vous m'êtes contraire, je déclare au baron tout ce que je sais sur votre compte: on vous congédie, on me donne un autre gouverneur. Si vous voulez me servir… Monsieur Person, vous savez quelle somme le baron me donne par an pour mes menus plaisirs; je vous en livre la moitié, et voilà un acompte (je lui présentai six louis).—De l'argent! Monsieur, fi donc! Me prenez-vous pour un valet?—Ne vous fâchez pas; je n'ai pas voulu vous offenser, j'ai cru… (Je remis les six louis dans ma bourse.)—Monsieur, j'ai beaucoup d'amitié pour vous, et ce n'est pas l'intérêt… Vous l'aimez donc bien fort, Mlle de Pontis?—Plus que je ne saurois vous le dire!—Et que voulez-vous que je fasse à cela, moi?—Je vous demande seulement de prendre autant de peine pour détourner l'attention du baron que vous en auriez pris à me tourmenter.—Monsieur, vous n'avez sur Mlle de Pontis que des vues honnêtes,… légitimes?—Je serois un monstre si j'en avois d'autres! Foi de gentilhomme! Sophie sera ma femme.—En ce cas, je ne vois pas d'inconvénient…—Il n'y en a pas!—Je n'en vois aucun, Monsieur: pour une chose si simple, vous me proposez de l'argent!—Recevez mes excuses.—De l'argent! fi donc! Quelques présens, passe… J'ai demeuré deux ans chez M. L…; il me faisoit de temps en temps quelques cadeaux. Ses enfans m'en faisoient de leur côté, tout cela s'arrangeoit assez bien. Un présent s'accepte.—Ainsi, Monsieur Person, voilà qui est dit, je puis compter sur vous?—Assurément.—Écoutez donc, mon cher gouverneur, j'ai une observation à vous faire. Si ce que vous sentez pour Adélaïde est un effet de l'amour, ne croyez pas que je l'approuve, au moins. Celui dont je brûle pour Sophie est innocent et pur comme elle. Celui que vous éprouveriez pour ma sœur!… Monsieur Person, prenez-y garde!… Je suis très convaincu que la vertu d'Adélaïde la défendroit contre les entreprises d'un suborneur; mais ces entreprises mêmes seroient un affront!… un affront que tout le sang du coupable n'expieroit que foiblement!—Monsieur, soyez tranquille.—Je le suis.—Monsieur, comptez sur moi.—Mon cher gouverneur, j'y compte.»
Person sortoit; il revint pour me dire que dans l'après-dîner il avoit été au couvent de la part du baron. «Au couvent! Pourquoi faire?—Pour défendre expressément à Mlle Adélaïde de paroître au parloir, quand vous irez seul la demander.—Vous l'avez vue, Adélaïde?—Oui, Monsieur.—Elle ne vous a rien dit?—Ah! qu'elle étoit bien fâchée de cette défense!—Rien de plus?—Rien du tout.—Et Sophie? Avez-vous demandé comment elle se portoit?—Beaucoup mieux depuis midi.—Et à quelle heure avez-vous été au couvent?—A cinq heures à peu près, il y a environ quatre heures.—Bien, fort bien.» Person s'en alla.
Beaucoup mieux depuis midi! C'est l'heure à peu près à laquelle elle a reçu ma lettre. Sophie! ma chère Sophie! ne te hâteras-tu pas de me répondre? Adélaïde, tu dois être bien contente! ta bonne amie est déjà guérie. Et, dans les transports de joie que me causoit la nouvelle d'une cure aussi prompte, je me mis à faire des sauts, des gambades, au bruit desquels accourut Jasmin; j'achevois un superbe entrechat quand il ouvrit la porte: «Monsieur, je vous demande excuse; j'entendois un vacarme! j'étois inquiet.—Jasmin, allez tout de suite chez le comte de Rosambert, et priez-le de passer ici demain matin, sans faute.»
Rosambert n'y manqua pas. De tous les événemens de la veille je ne lui racontai que ceux qui se rapportoient à Sophie; il me rappela en riant que ce n'étoit pas la jolie cousine qui étoit dans mon cabinet. Je voulus éluder; le comte me pressa si vivement qu'il fallut tout avouer. «C'est une femme bien étonnante que la marquise de B…, me dit-il alors. Personne ne sait comme elle commencer agréablement une intrigue, la filer vite, brusquer le dénouement qui ne lui déplaît pas, et que même on peut croire nécessaire à sa constitution. Personne ne possède mieux le grand art de retenir l'amant heureux, de supplanter une rivale dangereuse, ou, quand la chose est impossible, de tenir du moins la balance incertaine. Cette femme-là sait varier les plaisirs, de manière qu'avec elle, et pour elle, un amour de six mois est un amour nouveau. Un amour de six mois à la cour! vous concevez que c'est un vieillard décrépit: eh bien, la marquise rajeunit ce vieillard-là! car, quoiqu'elle m'ait quitté brusquement, je lui rends justice: elle n'est pas volage. Je crois même lui avoir surpris quelques éclairs de sensibilité; au fond il se pourroit qu'elle eût le cœur tendre. Son génie intrigant s'est développé à la cour dans tous les genres. Peut-être que, si elle fût née simple bourgeoise, au lieu d'être femme galante, elle eût été tout bonnement femme sensible. Je vous répète qu'elle n'est pas ce qu'on appelle volage. Je l'avois depuis six semaines, je l'aurois peut-être gardée trois mois encore; mais votre déguisement a tout dérangé. Un novice à instruire, un fat à corriger (il se montroit lui-même en riant), un mari presque jaloux à duper si plaisamment! des obstacles de toute espèce à surmonter!… elle n'a pu résister à ces idées-là. Oui, quoique vous soyez d'une figure charmante, je parierois que c'est surtout la difficulté de l'entreprise qui a déterminé Mme de B… D'abord la marquise a pris à tâche de ne pas suivre la route battue. Prendre cette semaine, avec distraction, un amant qu'on renverra maussadement la semaine prochaine, rompre et nouer des engagemens uniformes: voilà l'éternelle occupation de nos femmes de qualité! Le personnage change, mais jamais la conduite de l'intrigue; on dit, on fait sans cesse la même chose. C'est toujours une déclaration à recevoir, un aveu à faire, quelques billets à écrire, deux ou trois tête-à-tête à ranger, une rupture à consommer. Tout cela répété devient d'une monotonie assommante. La marquise, au contraire, n'est pas fâchée que le même cavalier lui reste, pourvu que le manège varie. Ce n'est pas par le nombre de ses amans qu'elle s'affiche, c'est par la singularité de ses aventures. Une scène ne lui paroît piquante que quand elle n'est pas ordinaire: elle ose tout pour la produire; elle se plaît à braver les hasards et à lutter contre les événemens. Aussi le sentiment de sa force l'emporte-t-il quelquefois trop loin. Quelquefois il arrive que toute son adresse ne peut lui épargner les désagrémens d'une démarche trop imprudente. Dans son aventure avec nous, par exemple, voilà deux terribles scènes qu'elle a essuyées. La première,… c'est moi qui l'en ai tourmentée, et en conscience je la lui devois. Hier elle est venue très inconséquemment chercher ici la seconde, et le hasard peut-être lui garde la troisième; mais n'importe! La marquise, toujours supérieure aux petites mortifications, accoutumée à considérer froidement, sous tous les rapports, les événemens les plus fâcheux, la marquise tirera de ses malheurs mêmes un avantage contre ses ennemis, contre sa rivale et contre vous.—Contre sa rivale! Ah! Rosambert, Sophie sera toujours préférée!… Mais que dites-vous de ma jolie cousine, qui ne répond pas?—Attendez donc qu'elle ait dormi. Ne vous souvenez-vous pas qu'il y a huit jours qu'elle n'a fermé l'œil? Votre lettre l'a doucement bercée… Mais laissez-la donc goûter son bonheur. Savez-vous de quoi nous devons nous occuper?—Non.—Il faut aller acheter quelque bijou pour le cher gouverneur: il vous a dit qu'un présent s'acceptoit.—Vraiment oui; mais si je sors et qu'il me vienne une lettre de Sophie?—On fera attendre la vieille messagère.—Eh bien, allons donc vite.—Vous oubliez votre chapeau.—Vous avez raison», répliquai-je d'un air distrait, et j'allai m'asseoir. Rosambert me prit par le bras: «Où diable êtes-vous? A quoi rêvez-vous?—Je songeois à ce pauvre vicomte de Florville. Qu'elle doit être affligée, la marquise! Rosambert, croyez-vous qu'elle m'écrira?—Nous parlons de la marquise à présent?—Oui, mon ami… Mais ne riez donc pas; répondez-moi.—Eh bien, mon cher Faublas, je crois qu'elle ne vous écrira pas.—Vous croyez?—Cela est très vraisemblable. La marquise s'est déjà consultée sur votre situation présente et sur la sienne. En femme bien apprise, elle a sans doute compris que vous ne pourriez vous dispenser de venir à elle; elle n'ira point à vous. Elle vous attendra, soyez sûr qu'elle vous attendra.»
Je sonnai Jasmin: «Mon ami, tu connois l'hôtel du marquis de B…; tu connois Justine, prends un habit bourgeois, va demander Justine, et tu lui diras que tu viens de ma part savoir comment se porte madame la marquise.» Rosambert, qui rioit de toutes ses forces, me dit: «Ah! c'est que vous croyez qu'il ne seroit pas poli de la faire trop attendre? Mais dites-moi, vous désiriez une lettre de Sophie?—Sans doute. Jasmin, nous allons à deux pas; tu ne sortiras que quand nous serons rentrés. Jasmin, de la discrétion! Je compte sur toi: on nous fait la guerre; l'ennemi est là-bas: en garde! mon ami, en garde!—Oh! Monsieur, dans toutes mes maisons j'ai toujours été du parti des enfans contre les pères.—Bien, mon ami; sois sûr que je te récompenserai quand je serai marié avec elle.—Marié avec madame la marquise! Monsieur!» Rosambert rioit: «Venez, venez, mon ami, me dit-il, vous n'y êtes plus.»
J'achetai une bague assez belle; mais, quand il fut question de nous en aller, je ne pus jamais arracher Rosambert de la boutique. La bijoutière étoit jolie.
A mon retour, Jasmin me remit une lettre. La vieille n'avoit pas voulu seulement s'asseoir, parce qu'on lui avoit défendu d'attendre une réponse.
Qu'on juge de ma douleur en lisant ce qui suit:
Si je n'avois vu mon nom vingt fois répété dans votre lettre, Monsieur, je n'aurois jamais pu croire qu'elle me fût adressée. Je ne m'imaginois pas que quelques mots échappés sans conséquence, recueillis au hasard par ma bonne amie, dussent être interprétés par son frère d'une manière si étonnante! Je n'imaginois pas que mon jeune cousin, qui se disoit mon ami, dût me traiter jamais d'une façon si injurieuse.
Qui vous a dit que je vous aimois, Monsieur? Adélaïde? Elle n'en sait rien. Qui vous a dit que ces mots: cruel, ingrat, je ne le reverrai de ma vie, vous fussent adressés? Qui vous a dit que je mourois de chagrin parce que vous ne m'aimiez pas? Si cela étoit, Monsieur, il n'y auroit que moi qui pût le savoir: vous l'ai-je jamais dit, moi, Monsieur?
Et vous avez l'air d'être sûr de votre fait! vous aimez quelqu'un, et vous me dites que vous m'aimez parce que vous croyez que je vous aime? Vous pensez donc me faire une grâce, quand vous me demandez mon cœur et ma main? Monsieur, si je suis assez malheureuse pour n'inspirer jamais que de la compassion, je serai du moins assez sage pour ne pas aimer, ou assez discrète pour cacher mon amour; et certainement jamais l'amant d'une autre ne sera le mien.
Maintenant c'est à vous et pour vous que je dis ces mots: «Je ne vous reverrai jamais.» Ma famille vaut bien la vôtre, Monsieur; et vous devez me savoir quelque gré de ne pas pousser plus loin le ressentiment de l'outrage que vous n'avez pas craint de me faire.
Cette fatale lettre n'étoit pas signée. Le chagrin dont elle me pénétra est plus facile à imaginer qu'à décrire. Sophie ne m'aimoit pas! Sophie ne vouloit plus me voir! Je tombai dans un accablement profond, dont je ne sortis que pour verser un torrent de larmes: si du moins Rosambert étoit là, il m'aideroit de ses conseils, il me donneroit quelque consolation.
Je me levai brusquement, j'essuyai mes yeux, je volai chez la bijoutière. Elle n'étoit plus au comptoir! Rosambert n'étoit plus dans la boutique! Je parus si fâché de ce contre-temps qu'une demoiselle de magasin eut pitié de moi. Elle me dit que, si je voulois entrer au café de la Régence, qu'elle me montra à dix pas de là, elle iroit avertir le comte, qui n'étoit pas loin, et qui ne manqueroit pas de me rejoindre dans une demi-heure au plus tard.
J'entrai dans ce café de la Régence. Je n'y vis que des gens profondément occupés à préparer un échec et mat. Hélas! ils étoient moins recueillis, moins rêveurs, moins tristes que moi. Je m'assis d'abord près d'une table, mais, l'agitation que j'éprouvois ne me permettant pas de rester en place, bientôt je me promenai à grands pas dans le café silencieux. Bientôt aussi l'un des joueurs, haussant la voix, levant la tête et frottant ses mains, dit d'un ton fier: «Au roi!—Grand Dieu! s'écria l'autre, la dame forcée! la partie perdue! Une partie superbe!… Oui, oui, Monsieur, frottez vos mains! Vous vous croyez un Turenne! Savez-vous à qui vous devez l'obligation de ce beau coup? (Il se tourna de mon côté.) A monsieur. Oui, à monsieur. Maudits soient les amoureux!» Étonné de la manière vive dont on m'apostrophoit, j'observai au joueur mécontent que je ne comprenois pas… «Vous ne comprenez pas! Eh bien! regardez-y; un échec à la découverte!—Eh bien! Monsieur! qu'a de commun cet échec…—Comment! ce qu'il a de commun! Il y a une heure, Monsieur, que vous tournez autour de moi. «Et ma chère Sophie par-ci, et ma jolie cousine par-là…» Moi, j'entends ces fadaises, et je fais des fautes d'écolier… Monsieur, quand on est amoureux, on ne vient pas au café de la Régence.» J'allois répliquer; il continua avec violence: «Un échec à la découverte, il faut couvrir le roi; seul moyen de sauver… On profite des distractions que ce monsieur me donne!… Un misérable coup de mazette! Un homme comme moi!» (Il se retourna vers moi.) «Monsieur, une fois pour toutes, sachez que toutes les cousines du monde ne valent pas la dame qu'on me force… Elle est forcée! Il n'y a pas de ressource… Au diable soient la bégueule et son doucereux amant!»
De toutes les exclamations du joueur, la dernière fut celle qui me piqua le plus. Emporté par ma vivacité, je m'avançai brusquement; mais, chemin faisant, je rencontrai sur la table voisine un échiquier qui débordoit: mes boutons l'accrochèrent, il tomba; les pièces roulèrent de tous côtés. Voilà pour moi deux adversaires nouveaux. L'un me dit: «Monsieur, prenez-vous quelquefois garde à ce que vous faites?» l'autre s'écrie: «Monsieur, vous m'enlevez une partie!…—Vous? vous aviez perdu, interrompt son adversaire.—J'avois gagné, Monsieur.—Cette partie-là, je l'aurois jouée contre Verdoni!—Et moi, contre Philidor.—Eh! Messieurs, ne me rompez pas la tête! je vais la payer, votre partie!—La payer! vous n'êtes pas assez riche.—Que jouez-vous donc?—L'honneur.—Oui, Monsieur, l'honneur. Je suis venu en poste tout exprès pour répondre au défi de monsieur,… de monsieur qui croit n'avoir pas d'égal! Sans vous je lui donnois une leçon!—Une leçon! eh mais, vous êtes fort heureux que l'étourderie de monsieur vous ait sauvé: je forçois la dame en dix-huit coups!—Et vous n'alliez pas jusqu'au onzième, en moins de dix vous étiez mat.—Mat! mat! C'est pourtant vous, Monsieur, qui êtes cause que l'on m'insulte!… Apprenez, Monsieur, que dans le café de la Régence on ne doit pas courir.» (Alors un autre joueur se leva:) «Eh! Messieurs, dans le café de la Régence on ne doit pas crier, on ne doit pas parler. Quel train vous faites!»
D'autres encore se mêlèrent de la querelle; et, comme j'étois l'auteur de tout le mal, chacun me gourmandoit; je ne savois plus à qui répondre, quand Rosambert entra. Il eut beaucoup de peine à me tirer de là: nous nous sauvâmes au Palais-Royal.
Je pris Rosambert à l'écart; je lui montrai la lettre de Sophie. «Et voilà ce qui vous afflige? me dit-il après l'avoir lue… Mais vous devriez baiser cent fois cette lettre-là!—Ah! Rosambert, est-ce donc le moment de plaisanter?—Je ne plaisante pas, mon ami, vous êtes adoré.—Mais vous n'avez donc pas lu?—J'ai lu, et je vous répète que vous êtes adoré.—Rosambert, nous sommes mal ici, revenez chez moi.»
En chemin, le comte me dit: «Sophie a cessé ses visites au parloir à l'époque de votre liaison avec Mme de B… C'est à cette époque aussi que les insomnies ont commencé; c'est alors qu'elle a eu ce que mademoiselle votre sœur appelle la fièvre. Elle a désiré la recette, elle l'a demandée indirectement. Il y a plus, le remède avoit fait un excellent effet, puisqu'hier, à midi, Mlle de Pontis se portoit mieux. Il faut donc conclure de tout cela que, dans l'après-dînée d'hier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au couvent. N'en doutez pas, mon ami, cette lettre est l'effet d'une ruse du baron, ou d'une naïveté d'Adélaïde, ou d'une indiscrétion de M. Person. Au reste, le ton de cette épître prouve que vous êtes aimé. Un aveu tacite est même échappé à la jeune personne. Elle vous fait de terribles reproches! Vous avez cru qu'elle vous aimoit! elle ne peut supporter cette idée; mais elle ne dit nulle part qu'elle ne vous aime pas.»
Tout ce que Rosambert me disoit me paroissoit fort raisonnable; cependant mon cœur étoit oppressé. Les amans espèrent follement, ils s'alarment de même.
«Savez-vous bien, reprit le comte, qu'elle est assez bien tournée, sa douce épître? Oh! la jolie cousine ne vous aura pas écrit dix fois que vous trouverez son style tout à fait formé!—Rosambert, que vous êtes cruel avec votre gaieté!»
Jasmin rentroit chez moi en même temps que nous, il me dit qu'il venoit de chez madame la marquise. «Eh bien, Monsieur, j'ai parlé à Mlle Justine; elle m'a fait attendre assez longtemps, et elle est enfin revenue me dire que madame étoit très sensible à votre attention; que madame s'étoit sentie fort incommodée hier en rentrant, que le docteur lui avoit trouvé un peu de fièvre ce matin.—Voyez, Rosambert, voyez comme je suis malheureux! elles ont toutes deux la fièvre en même temps! Celle que j'adore ne veut plus me voir!…—Et je ne verrai pas aujourd'hui celle qui m'amuse! ajouta le comte en me contrefaisant. Pauvre jeune homme! que je le plains!… Mon cher Faublas, consolez-vous. Pour guérir les maux que vous avez causés, vous serez tout seul plus docteur que tous les docteurs de la faculté. Mais, quoique la maladie de la jolie cousine soit à peu près celle de l'aimable marquise, je prévois cependant qu'il y aura quelque différence dans le traitement. On cherchera dans les yeux de la jolie demoiselle s'il n'y a pas quelque reste d'émotion; on prendra sa main pour tâter le pouls qui pourroit être un peu élevé; peut-être même qu'il faudra voir si sa bouche n'a rien perdu de sa fraîcheur… Mais pour la belle dame! oh! l'examen sera plus long, plus sérieux! Vous serez obligé de la considérer de plus près, et plus généralement… de la tête aux pieds! mon ami!… Je crois même que la méthode de ce M. Mesmer… Oui, Chevalier, oui, un peu de magnétisme!—De grâce! trêve de plaisanterie! Rosambert, occupez-vous avec moi de Sophie… Tâchons d'abord de découvrir ce qui m'a valu cette cruelle lettre; voyons ensuite par quels moyens je pourrois avoir une entrevue, une explication avec ma jolie cousine.—Très volontiers, mon cher Faublas; commençons par appeler M. Person.»
Mon père entra comme Rosambert sonnoit. Il répondit froidement aux politesses du comte, et m'annonça, d'un ton assez brusque, que j'allois sortir avec lui. «Les chevaux sont mis», ajouta-t-il, et, se tournant du côté de Rosambert: «Pardon, Monsieur, mais l'heure me presse.—Demain matin, de bonne heure», me dit le comte en nous quittant. Je suivis le baron avec inquiétude.
Il me conduisit chez M. Duportail. Lovzinski m'attendoit pour achever de m'apprendre les aventures de sa vie les plus secrètes; et, de peur que le marquis de B… ou quelque autre importun ne vînt encore nous interrompre, il ordonna qu'on refusât la porte à tout le monde. Dès que nous eûmes dîné, il continua ainsi le récit de ses infortunes.
Imprimé par Jouaust et Sigaux
POUR LA
PETITE BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE
M DCCC LXXXIV
PETITE BIBLIOTHÈQUE ARTISTIQUE
Tirage in-16 sur papier de Hollande, plus 25 chine et 25 whatman.—Tirage en GRAND PAPIER (in-8o), à 170 pap. de Hollande, 20 chine, 20 whatman.
| HEPTAMÉRON de la Reine de Navarre.—DÉCAMÉRON de Boccace, grav. de Flameng. | Épuisés. |
| CENT NOUVELLES NOUVELLES, dessins de J. Garnier, grav. par Lalauze ou reprod. par l'héliogravure. 10 fasc. | 50 fr. |
| MANON LESCAUT, grav. d'Hédouin. 2 vol. | 25 fr. |
| GULLIVER (Voyages de), grav. de Lalauze. 4 vol. | 40 fr. |
| VOYAGE SENTIMENTAL, grav. d'Hédouin. | 25 fr. |
| RABELAIS, les Cinq Livres, grav. de Boilvin. | 60 fr. |
| PERRAULT (Contes de), grav. de Lalauze. 2 vol. | 30 fr. |
| CONTES RÉMOIS, du Comte de Chevigné, dessins de J. Worms, grav. par Rajon. | 20 fr. |
| VOYAGE AUTOUR DE MA CHAMBRE, de X. de Maistre, grav. d'Hédouin. | 20 fr. |
| ROMANS DE VOLTAIRE, grav. de Laguillermie. 5 fascicules. | 45 fr. |
| ROBINSON CRUSOÉ, grav. de Mouilleron. 4 vol. | 40 fr. |
| PAUL ET VIRGINIE, grav. de Laguillermie. | 20 fr. |
| GIL BLAS, grav. de Los Rios. 4 vol. | 45 fr. |
| CHANSONS DE NADAUD, grav. d'Ed. Morin. 3 vol. | 40 fr. |
| PHYSIOLOGIE DU GOUT, grav. de Lalauze. 2 vol. | 60 fr. |
| LE DIABLE BOITEUX, grav. de Lalauze. 2 vol. | 30 fr. |
| ROMAN COMIQUE, grav. de Flameng. 3 vol. | 35 fr. |
| CONFESSIONS de Rousseau, grav. d'Hédouin, 4 vol. | 50 fr. |
| MILLE ET UNE NUITS, grav. de Lalauze. 10 vol. | 90 fr. |
| LES DAMES GALANTES, dessins d'Ed. de Beaumont, gravés par Boilvin. 3 vol. | 40 fr. |
| LES FACÉTIEUSES NUITS DE STRAPAROLE, dessins de J. Garnier, gravés par Champollion. 4 vol. | 45 fr. |
| BEAUMARCHAIS: Mariage de Figaro, Barbier de Séville. Dessins d'Arcos, gravés par Monziès, 2 vol. | 32 fr. |
| DIABLE AMOUREUX, grav. de Lalauze. 1 vol. | 20 fr. |
| CONTES D'HOFFMANN, grav. de Lalauze. 2 vol. | 36 fr. |
Nota.—Les prix indiqués sont ceux du format in-16. S'adresser à la librairie pour les autres exemplaires.
End of the Project Gutenberg EBook of Les amours du chevalier de Faublas,
tome 1/5, by Jean-Baptiste Louvet de Couvray
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK AMOURS DU CHEVALIER DE FAUBLAS, TOME 1 ***
***** This file should be named 61920-h.htm or 61920-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/1/9/2/61920/
Produced by Laurent Vogel and the Online Distributed
Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was
produced from images generously made available by The
Internet Archive/Canadian Libraries)
Updated editions will replace the previous one--the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive
specific permission. If you do not charge anything for copies of this
eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook
for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
performances and research. They may be modified and printed and given
away--you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks
not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the
trademark license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg-tm License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project
Gutenberg-tm electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the
person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph
1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the
Foundation" or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg-tm name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg-tm work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country outside the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work
on which the phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the
phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no
restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it
under the terms of the Project Gutenberg License included with this
eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the
United States, you'll have to check the laws of the country where you
are located before using this ebook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase "Project
Gutenberg" associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format
other than "Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg-tm web site
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original "Plain
Vanilla ASCII" or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works
provided that
* You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation."
* You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm
works.
* You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
* You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and The
Project Gutenberg Trademark LLC, the owner of the Project Gutenberg-tm
trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg-tm collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain "Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg-tm
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg-tm work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at
www.gutenberg.org
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is in Fairbanks, Alaska, with the
mailing address: PO Box 750175, Fairbanks, AK 99775, but its
volunteers and employees are scattered throughout numerous
locations. Its business office is located at 809 North 1500 West, Salt
Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up to
date contact information can be found at the Foundation's web site and
official page at www.gutenberg.org/contact
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular
state visit www.gutenberg.org/donate
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.